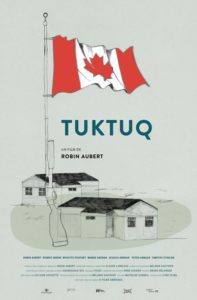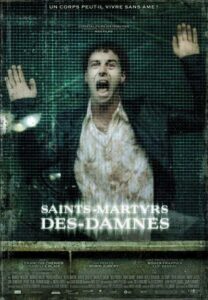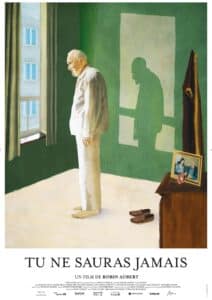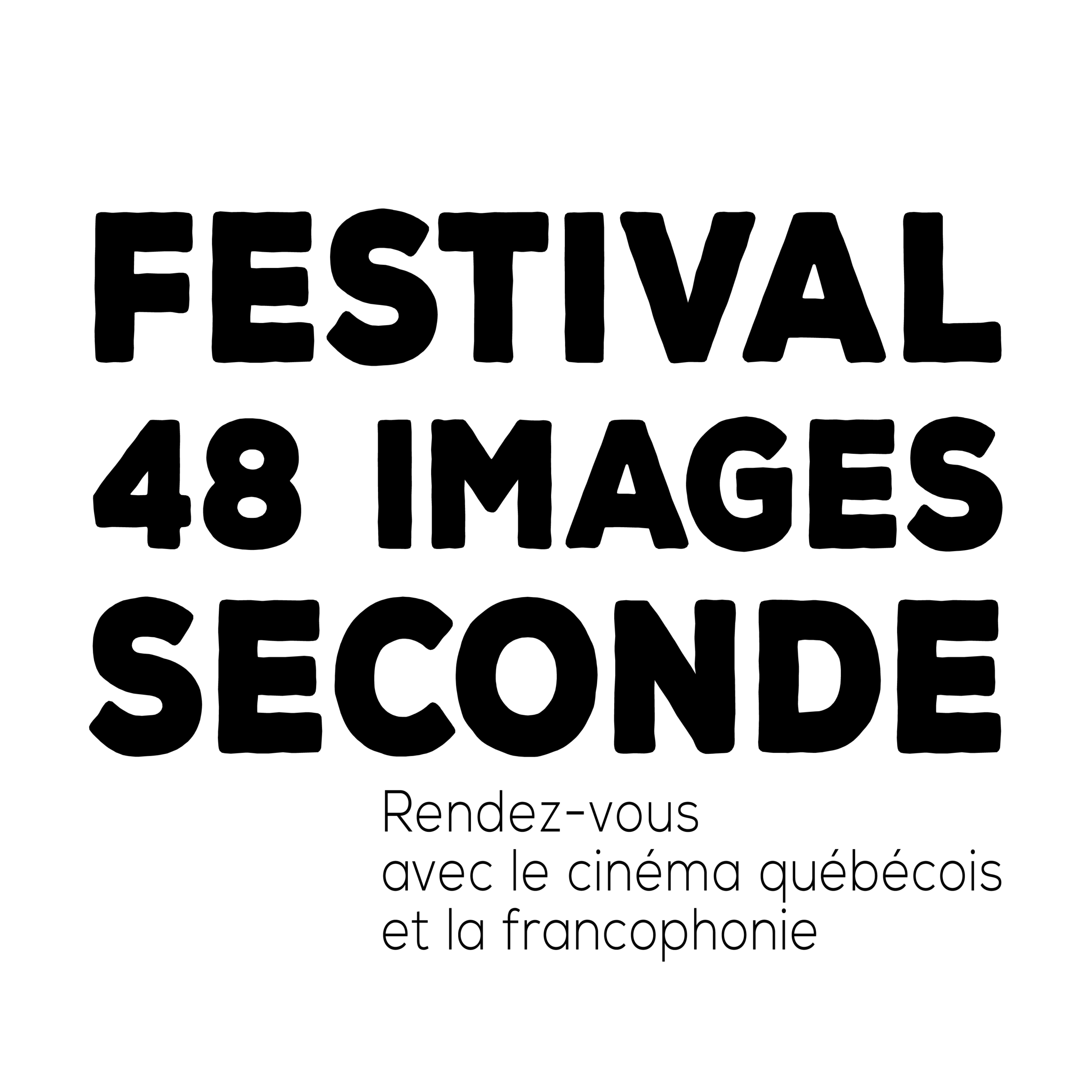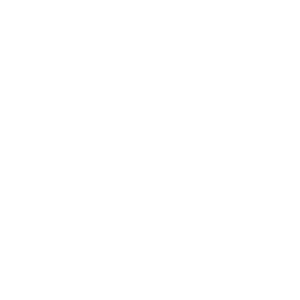- Partagez
- prev
- next
Entrevue de Mon cinéma québécois en France
La solitude ne reste jamais très longtemps : entretien avec Robin Aubert, réalisateur des Affamés
Il y a à peine un an, seuls les français accros à l’horreur et au dvd ayant eu la chance de tomber sur son premier long-métrage, connaissaient le nom de Robin Aubert. Ainsi que les heureux spectateurs du festival 48 images seconde 2017 de Florac, pas forcément pressés de croiser l’œil noir et le sourcil broussailleux du « Victo-Corleone » de Karl Lemieux. Puis Netflix est arrivé et la rumeur s’est propagée. Virale… Les geeks et autres cinéphages de genre se sont alors divisés, parfois entre-dévorés, sur le paletot des Affamés. Sang neuf pour les uns, touchés comme notre vigie Olivier Rossignot par un lyrisme modeste et évanescent. « Pas comme d’habitude » pour les autres, et même plus singulièrement, produit étiqueté Netflix, donc automatiquement suspect pour le cinéphile entré en résistance, ce qui conduira même Vincent Malausa ( fatigué d’aligner les articles intelligents sur des monstres sacrés, des genres ou des cinéastes ressuscités après vingt ou trente ans de placard ? ) à l’étiqueter « nanar » dans un billet injuste et aussi généreux qu’une note de service de l’Administration. Autrement dit, un film louche, avec accent, réalisé par un quasi-inconnu qui ferait mieux de le rester plutôt que de vendre son âme à Satan.
Chez les amateurs de cinéma québécois, on rigole doucement car on a compris que le bonhomme n’est pas tombé de la dernière pluie… même si à Florac, c’est justement en ciré kaki dégoulinant que Robin Aubert débarquait, essoré comme un kayakiste au printemps ! Pas grave vu que l’olibrius se fiche du glamour comme du gotha. Par contre, chaque critique de spectateur le touche, justement parce que Robin Aubert ne se moque ni du genre, ni du spectateur. Il a juste le bon goût de surprendre là où on ne s’y attendait pas, de film en film, parfois de séquence en séquence. Magnétique, il a su aimanter la curiosité du public du festival 48 image seconde, certains effectuant ainsi leur premier baptême horrifique. Ce soir là, on a pu constater que le succès tournait même à la célébration. Si le film part de la communauté, il est aussi logique qu’il lui revienne. Les sceptiques pourront s’amuser à le confronter à l’irlandais The Cured apparu en festivals récemment – au demeurant un excellent film de genre – qui lui préfère individualiser les causes et les effets pour mieux punir jusqu’au dernier responsable.
S’il y eut bien un point qui mit tout le monde d’accord, en plus d’un sens de l’humour bien trempé hérité d’une première carrière de comique avec les Chick’n Swell, ce sont les qualités humaines de l’auteur originaire de Ham-Nord, et notamment cette intégrité qui lui vaut de ne jamais oublier son bled du centre Québec et d’honorer le parler à tailler à la machette de ses habitants. S’il est sans doute un moraliste, Robin Aubert n’a aucune leçon à administrer. Tuktuq ( 2016 ) ne vient pas pour accuser les générations précédentes de génocide mais déjà raconter la prise de conscience d’un individu, lui-même… Ce beau rêve éveillé n’en déchire pas moins le voile de l’indifférence. Sobre et puissante émanation du cinéma du réel se frottant à la fiction pour mieux dépeindre une situation tristement réaliste, Tuktuq raconte la spoliation toujours à l’œuvre chez les colonisateurs des peuples premiers. L’indignation tranquille qui s’en dégage a valeur universelle, du nord au sud de l’Amérique bien sûr, mais aussi dans n’importe laquelle de nos colonies ou garden parties de la Françafrique, en Loire-Atlantique comme dans la Meuse. Il ne s’agit pas de valeurs digérées dans ce prisme identitaire qui à l’heure actuelle avilit tout, réduisant le champ des possibles à une peau de chagrin ou un drapeau, mais de sentiments, de ce goût de l’Autre, jusque dans ses visions fantasmatiques du village originel monstrueusement transformé en Saint-Martyrs des damnés. Après tout, Robin Aubert a suffisamment voyagé pour se permettre d’interroger l’état du monde et notre rapport schizophrène à cet unique héritage commun. Il n’a donc rien du bobo mondialisé. Il ne s’achète pas non plus avec trois compliments ou une bordée de trophées. Et si la profession québécoise vient de le reconnaître désormais incontournable, on peut lui faire confiance pour échapper aux carcans comme aux recettes toutes faites. Car ce trublion aimant jouer, pratique très sérieusement la chasse, la confrontation à son double, à l’organique. C’est peut-être de là qu’il tire ce regard aigu et fasciné qui, s’il traque les petites choses, soutient sans embages les gens. Des gens simples, parfois perdus dans un monde beaucoup plus grand et mystérieux qu’eux – sa forêt noire hantée par les cris sauvages de Mohicans irascibles et souverains – lieu changeant constamment et qui conserve pourtant cet aspect de contrée immuable.

Robin Aubert avec Daniel Racine au festival 48 images seconde de Florac © Éric Vautrey 2018
Vous pourrez lire ci-dessous un long entretien mais qui a un peu rétréci à la publication, faute d’avoir sauvé la première partie des enregistrements. Bien qu’en tournage, Robin a gentiment proposé de la recommencer, d’où une certaine césure dans le ton du texte. Au départ, les réponses sont tranchantes, concises, quand l’intervieweur exalté disserte encore. Mais plus loin, vous sentirez les digressions s’allonger… Encore une fois, le jeu reprend.
Tu es à la base un comédien. Tu as commencé très jeune dans l’humour mais c’est dans la peau du méchant Blackie, le bad garagiste de Maudite poutine ( 2016 ) que le public de Florac t’as découvert l’an passé. Tu aimes aller dans tous les registres du jeu ?
J’aime collaborer avec des créateurs dont j’admire le travail. Karl Lemieux est un artiste comme il s’en fait peu. C’est un vrai. On vient du même coin de pays. Avec ce film j’ai eu la chance de jouer avec mes amis d’enfance. Un pur plaisir.
Tu as travaillé avec André Forcier ou Robert Morin. Qu’est-ce que ces grands metteurs en scène t’ont apporté ?
L’un ose en poésie, l’autre risque sans compromis.
Tu es aussi un acteur populaire de la télévision québécoise. Au vu de cette expérience, accepterais-tu d’y retravailler aujourd’hui comme réalisateur ?
Pourquoi pasn? Je n’ai aucun plan de carrière. Je n’en ai jamais eu d’ailleurs.

Sur le ciment (2014) de Robin Aubert
Tu passes à la réalisation dès 1999. Tu avais toujours porté cette envie de faire tes propres films ?
Dès la fin de ma formation en théâtre, j’avais envie de faire du cinéma avec les acteurs de ma cohorte. Le seul problème, c’est que j’avais du mal à trouver un réalisateur. Je me suis fatigué d’attendre. Je me suis inscrit à La Course Destination Monde. Une émission de télévision destinée aux jeunes dans le but de les envoyer dans le monde pendant 6 mois. Une fois par semaine, il fallait faire un film et l’acheminer au Québec. Tu pars seul avec une caméra et un micro. T’es laissé à toi même et c’est tant mieux. C’est là où tout a commencé.
Tu as toujours alterné entre formats courts et longs. Est-ce que cela dépend des sujets ou c’est aussi pour préserver cette liberté propre au tournage des courts, avec tout ce que ça permet d’expérimenter ?
Avant de faire du long, je faisais du court pour prouver que je pouvais faire du long. Maintenant, je m’en sers comme si c’était du papier et du crayon. J’explore.
Dans le cadre de la carte blanche à la Coop Vidéo, on découvre justement un de ces courts-métrages de la maturité. Sur le ciment ( 2014 ) est un film plus tendre que cru, très peu bavard et d’aspect presque documentaire pour ses extérieurs. Tu sembles souvent te promener entre deux pôles l’un minimaliste et chevillé à la nature, au monde extérieur et un autre plus intérieur et fantasmatique…
C’est une belle analyse que tu fais. J’y pense pas trop, c’est le film qui décide.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que tu traites le cinéma de genre de façon non conventionnelle dans Saint-Martyrs-des-damnés ( 2005 ) ou très récemment dans ton tout dernier film Les affamés ( 2017 )… D’où est venue l’idée de Saint-Martyrs-des-damnés ?
En écrivant mes rêves.

Capture d’écran de Saint-Martyrs des damnés (2005) de Robin Aubert – Max films production tous droits réservés
Le film jongle avec plusieurs registres : étrange, film de fantômes, poésie, gore… Y a-t-il certaines influences ?
Il y en a plusieurs. Le subconscient est rempli de références. C’est comme un gros pamplemousse postmoderniste. (rires )
C’est un film très touffu visuellement, avec beaucoup d’univers et une identité très marquée : l’usine, l’hôtel… On sait qu’à l’époque le cinéma de genre est peu présent au Québec. Est-ce que ça a été facile de convaincre Roger Frappier, puis de montrer le film en salles ?
Je dois dire que sans l’audace de Frappier, je n’aurais jamais réussi à faire ce film. Je pense que de manière inconsciente, il me voyait comme l’émule de Jean-Claude Lauzon. Probablement à cause du caractère bouillant, du côté « écorché vif », de la chasse ou je ne sais quoi. C’est la raison pour laquelle il voulait former l’ancienne équipe de Lauzon autour de moi. Son directeur photo, son monteur. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné. Roger Frappier a du flair, c’est le moins qu’on puisse dire, mais il est aussi nostalgique. Il a très vite réalisé que je n’étais pas Lauzon (rire ). Avec le recul, quand j’y pense, ça n’avait aucun sens : tenter de dompter quelqu’un qui ressemble à quelqu’un d’indomptable. C’est comme essayer de faire flotter une roche. C’est une des raison, je pense, pour laquelle il était moins présent pour À l’origine d’un cri ( 2010 ). C’est Luc Vandal ( maintenant à la COOP VIDÉO ) qui l’a produit. Il était mon allié, mon confident, mon scénariste-conseil. C’est à Luc que je dois ce film, mais sans l’acharnement de Frappier, Saints-Martyrs-des-Damnés ne se serait jamais fait. Je pense la même chose de Stéphanie Morissette pour Les Affamés.
Et pour répondre à ta deuxième question, montrer un film en salle n’a jamais été un problème pour moi. C’est de le faire perdurer qui l’est. Ça n’a rien à voir avec le nombre. Mes raisons sont politiques. J’aimerais que le film fasse bonne impression en salle pour me permettre d’en faire un autre plus facilement. J’ai cessé de penser que mes films feraient bonne figure au box office ou de tenter de rejoindre le grand public. S’il n’est pas au rendez-vous, ce n’est pas parce qu’il est con, seulement parce qu’on l’a éduqué à consommer autre chose.

À quelle heure le train pour nulle part ( 2009 ) de Robin Aubert – Lynx films tous droits réservés
Tu entames ensuite dans une « pentalogie des continents » avec À quelle heure le train pour nulle part ( 2009 ), l’histoire d’un homme qui se lance à la recherche de son frère jumeau en Inde. Tourner à nouveau dans des pays lointains, c’est pour toi l’occasion de te mettre en danger, de refaire des voyages initiatiques ?
J’aime ta question. Mes films sont souvent reliés à des voyages initiatiques. Particulièrement À quelle heure le train pour nulle part qui est en quelque sorte le petit frère de Saints-Martyrs-des-Damnés. On a affaire à une certaine dualité entre le côté sombre et lumineux d’une personne, le combat d’un anti-héros et son double.
Les déchirements et réconciliations familiales, c’est quelque chose que tu as vécu comme les protagonistes de ton film suivant À l’origine d’un cri ? Tu portais ce projet depuis longtemps ?
Non et peut-être que oui, je ne m’en souviens plus.
Louis Bélanger disait lui aussi qu’il faut s’éloigner de sa propre histoire pour en laisser grandir sa part de fiction…
Y’a raison. Quoi que dans mon cas, ça m’arrive encore de me demander ce qu’est la fiction et ce qu’est la réalité avec ce film. J’aime beaucoup Louis Bélanger. J’aime son cinéma empreint de candeur, ça lui ressemble, mais j’aime aussi parler cinéma avec lui autour d’un pot. Tu vois, un soir à Florac, on s’est enfilé une bière ou deux dans une taverne. Il m’a parlé d’un de ses cinéastes fétiches, Milos Forman. Le lendemain, on apprenait sa mort.

À l’origine d’un cri ( 2010 ) de Robin Aubert – Max films tous droits réservés
En 2011, tu trouves le temps de publier un recueil de poésie, Entre la ville et l’écorce. Déjà, le titre définit assez bien ton territoire. Mais des extraits consultés ça et là, on reconnaît immédiatement une écriture proche du haïku, avec ce rapport très intense à la nature. « La solitude se niche dans les arbres et ne reste jamais très longtemps, les oiseaux prennent toute la place. » Pour moi, on est presque déjà au Nunavik ! Tu as toujours écrit ?
Oui. Depuis que j’ai des enfants, j’ai moins le temps. Je prends toujours un moment pour fuir la réalité, me trouver une cachette pour écrire une phrase ou deux. Évidemment, ça fait des poèmes plus courts, plus condensés, griffonnés dans l’urgence. L’urgence de créer est toujours là. En fait, c’est encore plus fort depuis que les enfants sont dans ma vie. Ça demeure existentialiste mais avec beaucoup plus de dérision. Y’a rien de plus rafraîchissant qu’un philosophe qui ne se prend pas au sérieux. Les questionnements sont les mêmes, mais la critique devient moins moralisatrice, donc plus percutante.
D’une poésie à l’autre, on te retrouve aux sources du continent américain. Tu recherches l’authenticité jusqu’au Nunavik. Cette prise de conscience est assez récente dans le cinéma québécois…
Une fois qu’on s’est regardé dans le miroir comme créateur, on doit regarder le miroir de l’autre, le malaise ambiant. On parle souvent des deux solitudes au Canada : francophones versus anglophones. Or, y’a une réalité encore plus criante selon moi. Celle des blancs d’Amérique et de ses frères bafoués, les Autochtones. C’est une cicatrice qu’il faut ouvrir pour sortir le pus sinon la cicatrice demeure une plaie ouverte. Ça ne fait que commencer…

Robin Aubert au festival 48 images seconde de Florac © Éric Vautrey 2018
Pour Tuktuq ( 2016 ), combien de temps es tu resté au Nunavik, de la préparation à l’après film ?
J’suis resté deux mois en haut, mais le film a pris quatre ans à se faire. Petite anecdote, pendant que je tournais Tuktuq, les jours où je n’avais rien, j’écrivais les premiers balbutiements des Affamés pendant que j’écoutais des giallo à la tonne le soir. Pour ne pas trouve le temps long, François Lévesque ( peintre et également critique de cinéma au Devoir ), qui est une sommité lorsqu’il s’agit de parler films de genre, m’avait refilé une série de DVD pour mon voyage. Il savait que je n’étais pas familier avec le giallo et comme c’est un ami, il voulait que je revienne à Montréal un peu moins con ( rire ). Je me suis tapé des Aldo Lado : Night Train Murders, Short Night of the Glass Dolls, Who Saw Her Die ? – mon préféré de Lado ! -, Profondo Rosso ( Deep Red ) d’Argento, Solamente Nero (Terreur sur la lagune, d’Antonio Bido ), The house with laughing windows de Pupi Avati, Seven Deaths ( Les diablesses, d’Antonio Margheriti ), The parfum of the lady in black, de Francesco Barilli, un des plus beaux finales de film gore que j’ai eu la chance de voir. Le grand Mario Bava : Kill Baby…Kill ! ( Opération peur ), The Whip and the Body, La Baie Sanglante… Mais aussi d’autres films comme Deathdream ( Le mort-vivant ) de Bob Clark, Les yeux sans visage de Franju, Cat People – la version de Schrader, je n’ai pas encore vu celle de Tourneur -, Dead & Buried (Réincarnations ) de Gary Sherman et The Brood ( Chromosome 3 ) de Cronenberg dont je ne suis pas sorti indemne. D’ailleurs, La Baie Sanglante de Bava a eu le même effet sur moi et demeure à ce jour un de mes films préférés de tous les temps. Je ne sais pas jusqu’à quel point ça a influencé ma manière de filmer, mais je sais que ça m’a encouragé à poursuivre mon désir d’écrire à nouveau un film d’horreur.
La base du scénario de Tuktuq repose-t-elle sur une assise documentaire ou simplement sur une situation emblématique de tous les peuples et de beaucoup de communautés amérindiennes dans le monde d’aujourd’hui ?
Un mélange des deux, je dirais. Je sais que ce que je dis dans le film n’est rien comparé à la réalité. La réalité dépasse toujours la fiction. La fiction ne va jamais assez loin à mon avis. On ne peut jamais aller trop loin en fiction, c’est impossible. C’est la raison pour laquelle les analystes pensent que tu fricotes avec le « surréalisme » alors que toi, tu tentes juste de transposer la vérité en image.

Tuktuq (2016) de Robin Aubert – Lynx Films et PRIM Centre D’arts Médiatiques tous droits réservés
Il y a une limpidité de l’image, un sens de l’espace qui laissent dans la narration la possibilité du retour à l’essentiel…
C’est gentil. Aussi bien Tuktuq que Les Affamés ( j’inclus là-dedans Sur le Ciment ) m’ont redonné le goût de faire du cinéma. Par contre, sans À l’origine d’un cri, aucun de ces films n’aurait été possible. À l’origine d’un cri demeura toujours mon film le plus important. De le savoir, ça m’enlève un poids énorme. J’peux explorer d’avantage, rire de moi-même, prendre des risques, m’écheveler dans le chaos des idées, ne plus m’en faire avec ce milieu de pacotille. L’essentiel se trouve dans ce que tu fais avec le cinéma et non ce qui gravite autour du cinéma.
Il était assez logique que Robert Morin, qui a si souvent pointé les travers du système, interprète le narrateur…
C’est pour moi un hommage à peine dissimulé à Robert Morin, parce que je pensais à lui en écrivant le personnage du sous-ministre, entre autres à deux films qu’il a fait avec Le voleur vit en enfer, un court-métrage sur quelqu’un qui avait des conversations téléphoniques avec une dame et ensuite à Yes sir Madame, qui est l’histoire d’un mec qui se présente comme ministre. C’était donc dans mon esprit la personne parfaite. Comme c’est aussi un ami, j’ai insisté parce qu’au départ, il ne voulait pas. Mais j’écrivais le texte en pensant à lui. Ça allait tellement loin dans l’absurdité, dans la satire, qu’il fallait Robert pour amener ça, pour y croire. Je pense qu’avec un acteur professionnel, ç’aurait été un peu trop décalé. Avec Robert, ça fait toute la différence !
Ici, c’est une voix-off, un exercice qu’il a beaucoup travaillé dans les films de la Coop. Au festival, certains personnes disaient ne pas tout comprendre. Pourtant, ce qu’on est sûrs de comprendre, c’est l’intention derrière le discours. Là, il s’agit d’arguments de politicien, de technocrate, mais il est très bon dans la prosodie, dans cette manière chantante qu’il utilise pour te charmer, t’endormir ! ( éclate de rire )
En même temps, je voulais le faire avec une certaine dérision, avec une pointe d’humour, pour apporter au film un peu de légèreté, tout en épinglant le fait que ces politiciens là jouent avec nous de manière très ironique. Il fallait que je leur renvoie la monnaie de leur pièce ! Ce sont deux sourds qui se parlent en un dialogue kafkaïen. Autrement dit , ce sont deux blancs qui sont en train de parler de la condition d’un peuple qu’ils ne connaissent pas… ( rire ) Un n’y est jamais allé et l’autre se laisse tranquillement toucher… Par l’intérieur. J’aimais bien cette ironie parce que ces deux blancs vont changer le monde inuit.

Robin Aubert dans Tuktuq (2016) – Lynx Films et PRIM Centre D’arts Médiatiques tous droits réservés
Ça passe d’ailleurs par des choses très concrètes. Ne serait-ce que dans cette idée où le sous-ministre lui demande de filmer des scènes de dépeçage pour leur côté gore afin de manipuler l’opinion et la monter contre des indigènes qui continuent à massacrer des animaux. Alors qu’au contraire, ce côté organique le ramènera à son rapport à la nature…
Oui, à ses racines. C’est pas pour rien qu’on le voie chasser avec son fils à la fin du film. Le sous-ministre ne croit pas à la transmission des traditions vers les jeunes générations, alors que c’est ce que lui ramène du pays inuit : ce transfert, ce partage là des racines et de la culture avec son propre fils. Il y a encore là un questionnement sur la condition de père.
Est-ce que tu as pu montrer le film là-bas ?
Pas encore. J’ai aussi des milliers d’images que je n’ai pas gardées et que j’ai données à l’association Avataq pour les archives inuits. Parmi les rushes, j’ai des pêches en haute mer, d’autres chasses ; des gens que je n’ai pas mis dans le film parce qu’il me fallait condenser.
Il y a trois ans, le festival avait invité le Wapikoni mobile, un studio itinérant dont le but est de mettre les outils audiovisuels à la portée de toutes les communautés autochtones. Dans le cas de ce village, est-ce que les habitants avaient déjà accédé à des moyens semblables ?
Oui, ils ont accès à l’audiovisuel. Ils n’ont pas seulement des camps de chasse et des maisons. Il y a une espèce de salle communautaire équipée avec des lecteurs dvd. Ici, la promesse faite à Avataq, c’est que j’aille présenter le film en personne. Ils l’auront sans doute avant en dvd, mais j’aimerais vraiment le projeter là-bas. Le seul problème, c’est que se rendre au Nunavik est extrêmement cher.

Les affamés (2017) de Robin Aubert – La Maison de Prod tous droits réservés
Tu es ensuite revenu au cinéma de genre pour Les affamés, très bien accueilli au Québec. On retrouve certains traits caractéristiques du cinéma québécois : le sens des paysages, ce besoin de se ressourcer dans la forêt profonde, la justesse psychologique des personnages et un élément qui est propre à ton cinéma, privilégier l’humain aux effets de mise en scène, mais sans crainte d’utiliser les codes du genre et autres figures obligées. Tu vas franchement dans le suspense mais pourtant, ton film, c’est bien plus que ça…
Dans le fond, faire un film de zombies, c’est un prétexte pour parler de l’humain. Faire des scènes gore pour elles-mêmes, ça ne m’aurait pas intéressé. Juste pour prouver que je suis capable de le faire ? J’avais envie d’aller plus loin. Mais c’est quand tu écris un film de zombies que tu réalises justement que tu es en train de faire un film social !
Romero a traité ça depuis toujours…
Exactement ! Et si je ne suis pas forcément un grand fan de films de zombies, je suis par contre un fan de Romero. Parce qu’il avait toujours un point de vue, un sens caché dans ses films. Il a malheureusement été un peu boudé ou considéré pendant des années comme un cinéaste de second ordre ou de série B alors que ses films contiennent un message politique.
Le début des Affamés est extraordinaire. Au lieu de nous mettre en empathie avec les survivants, tu vas d’abord planter le lieu. Ce lieu, c’est le bois, que tu connais bien et non loin de l’endroit où tu as vécu. C’est l’arène où les situations les plus extravagantes de ce film post-apocalyptique peuvent éclore. Il renferme un aspect légendaire et éminemment fantastique. En plus de ce cadre, les scènes finissent toujours hors-champ, la caméra délaissant les personnages qui traversent un espace qui existe avant eux. Ces lieux laissent d’emblée une empreinte profonde sur le spectateur…
Peut-être, en tout cas c’est une belle analyse que tu fais. Je vais y réfléchir… ( rires ) Je ne voyais pas tout ça mais j’aime ça !

Les affamés (2017) de Robin Aubert – La Maison de Prod tous droits réservés
Il y a aussi ces chaises vides, qui appellent à être réinventées dans le film. D’où est venue cette idée des totems d’objets, de ces grandes tours? Dès le scénario ou en travaillant avec André-Line Beauparlant ?
Les sculptures, les pyramides et les autres objets ont pris un sens beaucoup plus fort dès lors qu’André-Line a apporté sa touche artistique, c’est certain ! Sinon, les chaises, ça vient de ma tante qui avait une brocante ( rires ) Après son décès, j’ai trouvé des milliers de chaises dans le garage. Il fallait faire quelque chose avec ça. À sa mort, toutes ces vieilles chaises m’ont marquées, l’idée a perduré au long des années jusqu’aux Affamés.
Ça symbolise très bien le devenir de l’Humanité… La place de l’humain dans un monde qui pourrait très bien se passer de nous.
Exactement. Mais le passé aussi…
Le travail sonore est ici très présent, autant dans les ambiances que par ces cris très puissants de zombies qui sont un vrai appel vers autre chose. Tu as tourné dans des lieux très précis que tu connaissais. Tu gardais en mémoire des impressions de ces forêts ou de ces prés ?
J’en gardais certaines en mémoire mais j’ai surtout beaucoup marché en écrivant. Je marchais les forêt que j’avais en tête de tourner. Je cherchais aussi beaucoup en voiture. J’aime beaucoup écrire le film en me perdant dans le décor. En fait, le décor me parle beaucoup, il me remplit et m’inspire pour décrire les scènes.

Les affamés (2017) de Robin Aubert – La Maison de Prod tous droits réservés
Ça joue certainement sur l’aspect parfois méditatif du film. Le récit est plein de ruptures de ton ( il acquiesce ) : On va passer des blagues douteuses du personnage joué par Marc-André Grondin et qui font beaucoup rire le public, à des scènes à suspense ou à des temps morts. Par exemple un effet de mise en scène que j’aime beaucoup, c’est ce faux champ contre champ entre le jeune et le vieil homme, sachant que le destin va les séparer.
Exactement, ils sont en fait côte à côte ( bien qu’éloignés de plusieurs mètres ) au lieu d’être face à face. Sur Les Affamés, je me suis dit que c’était peut-être le dernier film que je faisais mais je veux que ce soit comme si c’était mon tout premier film. J’ai donc changé toute mon équipe pour quitter mes pantoufles. J’ai essayé de travailler avec un nouveau directeur photo, une première assistante, une nouvelle DA ( direction artistique ), tout ça pour m’obliger à aller plus loin et ne pas retomber dans certains thèmes et manières de cinéaste que je trimballe déjà. À la base, j’avais envie de m’amuser dans ce film là et de retrouver ce plaisir que je continuais d’avoir depuis Tuktuq. Un plaisir fou de faire de la mise en scène pour la mise en scène, sans essayer de prouver quoi que ce soit. Trouver la meilleure manière de filmer chaque scène et pas chercher à en mettre plein la vue. Mais c’est vrai que cette fois, ça comportait un vrai risque de changer de ton comme ça. Je ne savais pas si ça fonctionnerait, mais j’avais envie de mélanger humour et horreur. La vie n’est pas que drame ! Après peut-être que le public ne sait plus sur quel pied danser… Mais pour moi, ces ruptures de ton ressemblent à la vie. On a de l’humour et après, le drame : il faut qu’elle tue sa meilleure amie !
Penses tu que ta pratique de la chasse t’ait inspiré pour les scènes de suspense comme celle où elle se cache dans les hautes herbes où on sent à la fois l’adrénaline, l’attente et le rapport à la végétation ?
En fait, cette scène dans les fougères avait été story-boardée pour se dérouler en forêt, mais comme je ne trouvais pas l’endroit parfait, on a mis tout ça à la poubelle le lendemain et on s’est décidé pour les fougères. Je me suis traîné toute l’après midi dedans, à les fouiller pour trouver la bonne manière de faire. Pour en revenir à la chasse, je pense que quand tu marches en forêt, il y a inévitablement un moment de tension entre toi et l’animal. Je l’ai sans doute utilisé pour Les affamés.
Il y a un rapport entre la topographie du lieu et toi, comment on peut s’y cacher…
Exactement. Le son vient aussi beaucoup de là, de la chasse probablement. Souvent dans les films d’horreur, tu te retrouves en forêt, tu marches tranquillement et tu sais que la tension arrive et à ce moment, le piano part. Mais que je sache, quand tu marches dans la forêt, il n’y a personne derrière un arbre qui se mette à pianoter. ( rire ) Les silences et les bruits de la forêt sont beaucoup plus apeurants selon moi. On a surutilisé le piano, le violoncelle et le violon dans les films d’horreur. Il faut trouver une nouvelle manière parce que ces codes sont ancrés en nous. Même si cette absence dérange certaines personnes du public… J’ai reçu quelques messages de spectateurs enragés parce que je n’avais pas mis de musique ou parce que certaines scènes n’étaient pas exactement comme celles des autres films d’horreur. Ça fait aussi partie du jeu.

Les affamés (2017) de Robin Aubert – La Maison de Prod tous droits réservés
On a déjà parlé de communauté chez Romero, mais beaucoup de films de zombies sont axés sur l’individualisme dans la survie, un futur où chacun se tire dans les pattes. Chez toi on s’organise ensemble…
Ça, ça vient des villages. Par chez nous, on s’organise en effet ensemble. J’imagine que dans les Cévennes, c’est le même esprit d’entraide.
Donc même si tu allais te réfugier dans le grand Nord, tu aurais fatalement besoin des autres tôt ou tard…
Je suis convaincu que l’humain n’est pas capable de vivre seul sans devenir fou un jour ou l’autre. Ce qui me fatigue en général dans les films de zombies, c’est l’explication de l’infection. Mais on en a rien à foutre ! Vous nous perdez avec vos scènes explicatives interminables. Après tant de films, on n’est plus obligés d’expliquer cette partie là. Enfin, ça se termine toujours avec cette espèce de ville lumière, le château fort qui nous sauve, où l’armée veille et nous attend. Or, si ça arrivait, je ne pense pas qu’ils nous y laisseraient entrer ! C’est pour ça que j’avais envie de créer ce vide à la fin, et qu’on ne sait pas ce qui va arriver à la petite, ce qu’il y a ailleurs… Avant leur seul désir était d’aller dans un bunker, sauf qu’il n’y a rien dans ce bunker là.
Comment vois-tu notre avenir commun après la disparition des ressources naturelles et est-ce que tes voyages t’ont permis d’appréhender ces problèmes de façon concrète, ces mutations et ce point de non-retour comme une épée de Damoclès…?
J’en ai peut-être en effet une vision un peu plus nihiliste. Mais comme je voyage beaucoup et que je m’intéresse à l’autre, je trouve qu’on manque de curiosité. On est en train de la perdre d‘où un certain cynisme, une ironie dans les propos. ( Marc-André Grondin entre en douce et passe devant notre champ de vision ) Je pense au comédien qui fait Bonin. Il a fallu beaucoup travailler au départ car il n’était pas très bon ( rires ). Lui n’avait pas fait d’école de théâtre alors ça a été extrêmement difficile. ( Marc-André râle et Robin éclate de rire )

Robin Aubert au festival 48 images seconde de Florac © Éric Vautrey 2018
Tu es aujourd’hui reconnu par l’ensemble de la profession québécoise, d’ailleurs tes deux derniers films sont nominés au Gala du cinéma québécois. Ça fait quel effet ?
( soupir ) Je suis un peu mitigé par rapport à tout ça. L’indépendance, ça fait un peu mon affaire, je fais mes trucs de mon côté et on ne m’attend pas avec une brique et un fanal ( s’attendre à des reproches ). En fait, je ne me suis jamais senti faire partie de ce milieu là ni être respecté par mes pairs. Mais je ne sais pas vraiment, je te réponds n’importe quoi là… ( rires ) C’est un mélange d’émotions !
Les affamés est diffusé dans le monde entier sur Netflix, mais pas au Québec…
Après en France ou au Québec, les films de genre sont toujours mal distribués. Les distributeurs ne croient pas dans ce genre de films et ils ont peut-être raison parce que quand ils sortent un film en costumes ou sur la première chanteuse québécoise dans 94 salles, ils savent que le public va aller les voir. C’est peut-être un public vieillissant… Mais les propriétaires de salles, pour la plupart, ne voulaient pas non plus de mon film.
Mais comment la profession a-t-elle réagi au fait que tu aies vendu les droits à Netflix ?
Je ne suis pas sûr mais je crois que ça les ennuie un peu. Enfin un film québécois qui dément ce qu’ils disent depuis des années sur le cinéma de genre. Pleins de jeunes cinéastes ont envie d’en faire et peut-être que ça peut leur permettre d’ouvrir des portes. Peut-être… ( il fait une dernière blague sur Marc-André Grondin qui se rebelle )
Remerciements : Robin Aubert, Festival 48 images seconde : Guillaume Sapin, Caroline Radigois, Jason Burnham, et Jimmy Grandadam ( association la Nouvelle dimension ). Photos du festival 48 images seconde 2018 (dont photo de tête ) : Eric Vautrey. Moyens techniques : Radio Bartas