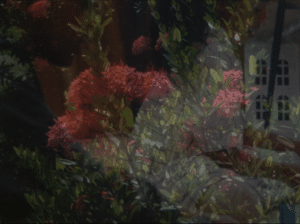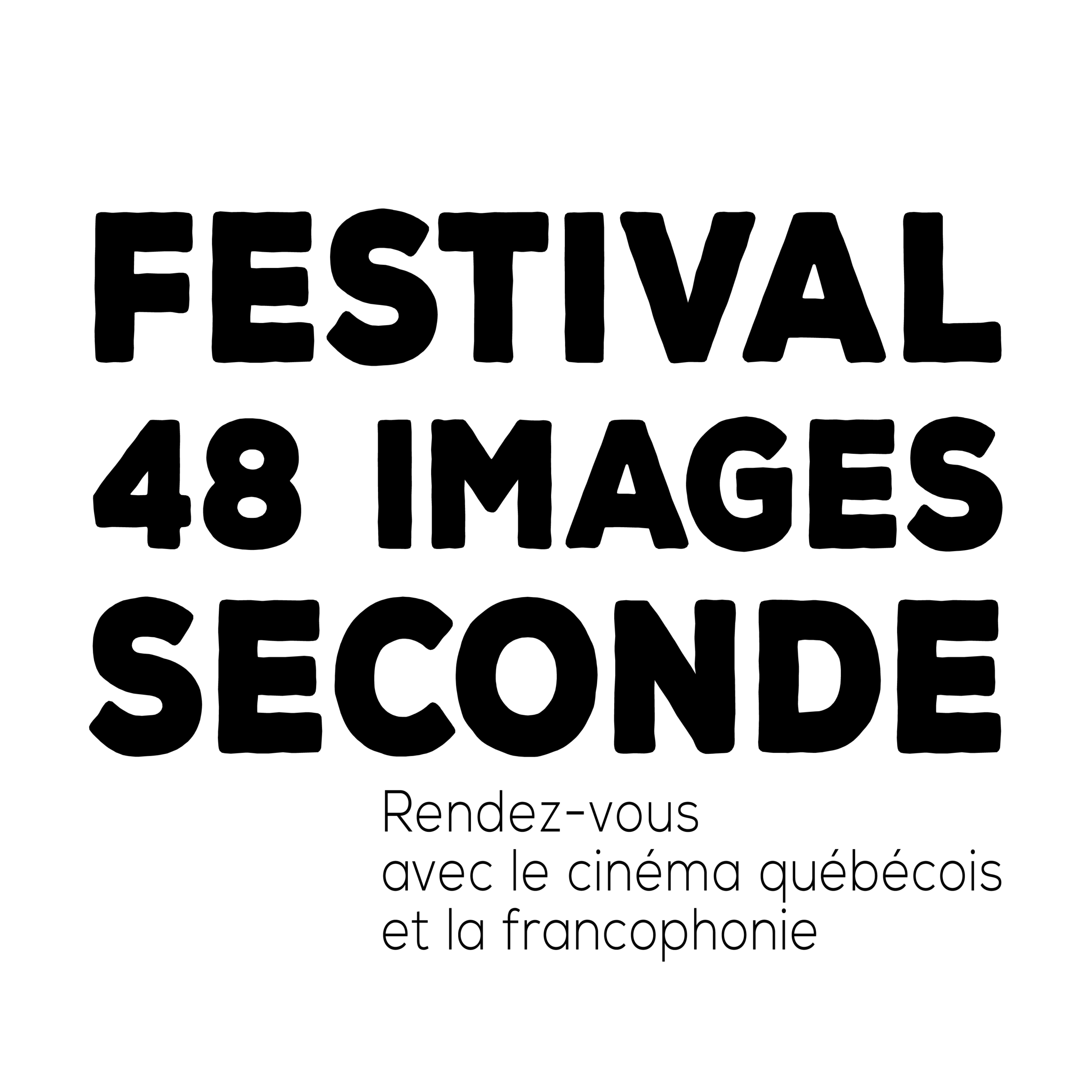- Partagez
- prev
- next
Entrevue de Mon cinéma québécois en France
Entretien avec Pierre Audebert au festival Vues du Québec de Florac en avril 2023.
Certains disent son cinéma cérébral, il est plutôt intuitif et éminemment sensoriel, habité. Normal que sa présence soit aussi radieuse et pourtant en toute simplicité, avec une parole sérieuse mais qui n'oublie jamais de rire d'elle-même. C'est avec cette force et cette douceur que Miryam Charles signe son premier long-métrage, Cette Maison, certainement l'un des plus beaux films de cette décennie. Sa sortie prochaine devrait lui amener de fervents adeptes avant de briller désormais dans les grands festivals. Miryam ne s'en préoccupe pas - elle sait la rencontre avec chaque spectateur unique. Au cours de ce beau moment de discussion où elle fut toujours gaie et passionnée de cinéma, on revient sur ses débuts, sa collaboration avec Olivier Godin (relire le bel article de Maude Trottier dans le journal des Cahiers, il y a de ça quelques années), ses méthodes de travail et sur la construction de Cette maison, film à habiter pour qui veut s'y abandonner, une œuvre qui vous trottera dans la tête tout en ravissant votre cœur à jamais.
Je me souviens de tout dans les détails, presque microscopiques...
Alors, j'ai vu que tu avais dit dans l'entrevue de la revue 24 images que ta carrière avait débuté par la recherche et la création de sons. Est- ce que tu peux revenir là- dessus, justement ?
Oui. En fait, je n'ai jamais pensé que je serais cinéaste, parce que j'ai commencé à la production et à la direction photo. Je pensais vraiment que j'allais faire une carrière double de productrice et opératrice de films un peu… je ne dirais pas de « champ gauche », mais en tout cas de films qui me rejoignaient dans la sensibilité. Et aussi dans la manière de chercher de nouvelles façons de structurer des histoires, voilà ce qui m'interpellait. Bref, je pensais vraiment que ma carrière était lancée dans cette direction là. Au niveau direction photo, j’ai travaillé avec Olivier Godin, mais aussi avec d’autres réalisateurs et réalisatrices. Or, je n'avais pas nécessairement assez confiance en moi. Je regardais des amis travailler sur les plateaux. J'ai occupé aussi beaucoup d'autres postes. J'ai fait de la cantine, j'ai été assistante de production, juste pour comprendre un peu les dynamiques de plateaux. Je me suis toujours dit qu'être réalisatrice ou réalisateur, ça demandait beaucoup de courage. Il faut quand même parler à beaucoup de gens. Je suis quand même quelqu'un de timide. Sur le plateau, tout le monde écoute la personne qui réalise et je me disais « Ça, ce n'est pas pour moi ». J'évite quand même d’avoir à parler en public ! En tant que directrice photo, tu discutes avec la réalisation, avec ton équipe à la caméra, mais c'est quand même très fermé. Donc pour moi, ça allait bien avec ma personnalité. Au niveau de l'écriture des scénarios, j'ai pris des cours de scénarisation à l'université et je trouvais ça très difficile parce que c'était très structuré.
La dramaturgie ?
La dramaturgie et tout ça. Même si je comprends le principe, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement chez moi. Je me disais « Ah ben ça, ça ne sera pas pour moi. » C'est vraiment avec le temps, avec le fait d'avoir travaillé beaucoup que j'ai fini par gagner en confiance. Puis quand j'ai commencé à penser à faire des films, le son m'est venu tout de suite. Déjà quand je faisais de la production pour d'autres réalisateurs, la partie conception sonore, le mix, c’était vraiment ce qui m'intéressait le plus dans le processus. « OK, oui, je peux faire ça», juste pour comprendre. Surtout dans les films d'Olivier Godin où le son est quand même très important et et il n'est pas nécessairement tout le temps collé à l'image. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Quand j'ai commencé à penser à mes films, je les pensais toujours de manière sonore. Par exemple, pour mon premier court-métrage Vole vole Tristesse (2015), j'avais déjà pensé au son d'Haïti, un pays que je visite souvent parce que j'ai beaucoup de famille là- bas. À chaque fois que je vais en Haïti, il est très rare que je prenne des photos ou des images. Par contre, même quand je voyage, j'ai tout le temps un enregistreur comme celui-ci (un zoom donc...) et je me promène, je me fais des balades sonores. J'enregistre des sons, puis après j'ai mon petit cahier où je note « telle ville, telle heure ». J'essaie alors de me souvenir de tels sons. J'ai comme un registre sonore, des archives sonores qui s'étalent sur des années. Quand j'ai commencé à faire des films, je suis allée puiser dans ces archives- là. Je bâtis. Là j'ai enregistré des sons à Florac, donc peut- être qu'un jour, il y a des sons de Florac qui vont ressortir ailleurs (rire).
 Vole vole tristesse (2015) de Miryam Charles - Capture d'écran
Vole vole tristesse (2015) de Miryam Charles - Capture d'écran
C'est sûr qu'après, les sons sont uniques dans chaque endroit.
Oui, mais je pense que c'est plus pour moi que pour le public, parce que par exemple, pour Trois atlas (2018) ou même pour Cette maison (2022), il y a beaucoup de sons qui ne sont pas reconnaissables par le public. Pour moi, c'est correct, car je tisse une carte sonore qui évoque des souvenirs, des moments dans le temps.
J’ai d’ailleurs remarqué qu'il y avait beaucoup d'échos. Je me suis posé la question d’autant que je vois des correspondances avec ce que tu as fait dans la première partie de ta collaboration avec Olivier Godin. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà préciser que tu as été une enfant cinéphile.
Oui !
Qu'est- ce qui t'a vraiment marqué et a déterminé ton orientation ?
(elle hésite) Quand tu dis « ce qui m'a marqué ? », veux-tu dire ce qui m'a donné le goût d'aller vers le cinéma ou plutôt ce qui m'a marquée humainement ?
Ça peut être les deux car si les films qu'on a vu souvent à un très jeune âge n'ont pas forcément déterminé une vocation de cinéaste, ils laissent des souvenirs impérissables.
Alors ça ne va pas être le meilleur exemple de cinéphilie, mais je pense que le premier film qui m'a vraiment marquée, c'est un film qu'on a vu en famille, Annie de John Huston.
Beaucoup de femmes d'un certain âge citent souvent ce film.
Mais c’est autant le personnage que la mise en scène, les chansons qu'on a apprises par cœur parce que mes parents nous avaient acheté le disque, donc on l'écoutait beaucoup. C'est aussi une histoire qui se termine bien, d'une certaine façon. Je pense que mes parents aimaient aussi beaucoup cette histoire- là, parce qu'eux ont connu beaucoup d'adversité. Ils sont venus au Canada, etc. Donc l’histoire de cette petite fille où tout est un peu contre elle et qui retrouve une famille… Je suis presque émue en en parlant !
C'est presque la métaphore du pays d'adoption.
Exactement. C'est un film que je peux encore regarder avec beaucoup de plaisir. Il y a certains films de ton enfance que tu regardes adulte, et là :« Hmmm...» Ça ne passe pas vraiment le test ! Mais Annie... On a aussi fait découvrir le film à ma nièce qui l’aime beaucoup, donc on essaie de se le transmettre.
D’ailleurs on nous le demande beaucoup au vidéo-club.
C'est un signe ! Il faudrait en trouver un exemplaire ! (rire)
Absolument. Quand tu grandis et que tu commences à construire ton parcours toi- même, quel est le cinéaste qui te parle le plus ?
Je dirais que je me suis vraiment lancée dans le cinéma québécois, vers la moitié de mon adolescence. À la télévision québécoise, il n'y avait pas tant de films québécois de patrimoine, à part à Radio-Canada qui diffusait des films du Cinéma Direct, mais vraiment tard le soir, 23h00, minuit, et là tu pouvais en attraper quelques- uns. Sinon, c'était juste les films de l'année en cours. J'ai essayé de découvrir la cinématographie québécoise. Je suis devenue obsédée par Pierre Perrault. (rire)
(étonné) Adolescente ?
Il y a comme une humanité, quelque chose qui me touchait profondément dans les films de Pierre Perrault. Toute sa filmographie et ensuite Michel Brault. Puis ça a été Gilles Groulx et ensuite Denys Arcand. On dirait que je voulais comprendre moi aussi, car je me faisais souvent dire que je n'étais pas québécoise. Donc je consommais beaucoup de cinéma québécois, beaucoup de télévision québécoise et beaucoup de tout ce qui est musique, culture, etc, pour essayer d’en comprendre les codes, pour essayer d'être québécoise. Je me disais « C'est par le cinéma que je vais comprendre ce qu’est le Québec », pour qu'un jour moi aussi je sois québécoise. Donc oui, ce cinéma québécois je l’ai adoré et je l'aime encore toujours.
Il y avait aussi quelques diffusions de films de l’ONF…
D’un certain format pour la télévision. Oui, mais pas tant non plus. Moi, j'ai grandi dans les années 90. Oui, c'est vrai. Je crois que c'est avant, effectivement. C'est ça. Il fallait aller à la Cinémathèque. J'ai commencé à aller à la Cinémathèque fin des années 90. C'est là que j'ai découvert toute la cinématographie de l'ONF. Je dirais que le Canada n'est pas très fort. En tout cas, sans critiquer la Société des Terres, même maintenant, il n'y a pas vraiment de films de l'ONF qui sont montrés, soit très tard le soir, mais je pense qu'ils assument que les gens ont juste à aller sur le site de l'ONF, ils vont trouver les films- là, alors que moi, je trouve que c'est une occasion un peu manquée.
Il n’y a pas beaucoup de pays où la télévision publique est efficace. À quel moment est- ce que tu prends conscience que tous les personnages noirs sont sous-représentés à l'écran, et même qu’il y en a finalement relativement peu. Quand tu commences à te dire « Moi, je ferais bien du cinéma » ? Sauf que visiblement, qui fait du cinéma ?
Je pense que c'est arrivé assez tôt, parce que je regardais la télé. Tu regardais des émissions et en effet il n'y avait pas tant de personnages noirs. Quand il y en avait, c'est tout le temps un peu en arrière-plan, de passage, des personnages secondaires, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est plus vers la fin de la adolescence que j'ai remarqué que c'était problématique. Alors que quand j'étais plus jeune, dès que je voyais un personnage noir, j'étais contente. « Au moins, il y a quelqu'un ». Mais je ne me posais pas la question de comment il était représenté. C'est ça.
 Miryam Charles à la cérémonie d'ouverture du festival Vues du Québec de Florac, avril 2023 - Photo Christian Ayesten
Miryam Charles à la cérémonie d'ouverture du festival Vues du Québec de Florac, avril 2023 - Photo Christian Ayesten
« Gone with the wind »...
Exactement. J’étais vraiment heureuse de voir, je me disais, « oh ils font des efforts », etc, et puis c’est vraiment en vieillissant que je me suis dit : « oh, ben finalement, c’est pas des personnages si important que ça », surtout à la télé, c’est pas des personnages qui ont des familles, qui sont très développés, c’est souvent des personnages qui sont en situation d’immigration… C’est toujours des immigrants qui viennent d’arriver, et puis c’est difficile, et ils ne comprennent pas la langue, pas les codes. Ils ont un accent vraiment prononcé, alors qu' autour de moi, c’est pas nécessairement ça non plus. Donc là, j’étais comme « oh tiens, c’est un peu étrange que ce soit toujours comme ça ! ». Ou des criminels, enfin, pas trop des bonnes personnes… Je ne dis pas que ça n’existait pas, mais c’était plus souvent ça. Et puis après, tu réfléchis, tu regardes les génériques, tu regardes qui écrit ces histoires là, qui réalise ces histoires là…. Et puis tu réalises que la plupart des gens, c’est des québécois, qui peut-être ne sont pas au fait de la réalité. Peut-être qu' ils n’ont pas un entourage multiculturel, pour comme, nuancer aussi, les personnages. Donc cette réflexion là est venue presque à la fin de l’adolescence, mais moi ça ne m’a jamais frustrée. Et puis j’ai eu beaucoup de conversations avec des gens, surtout des comédiens, qui sont un peu fatigués de ça ! Mais moi ça m’a toujours motivée en fait.
C’est pas un truc qui t’a mis en colère.
Non, je trouvais ça dommage, j’étais pas contente de ça, mais je savais qu’il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à changer ça, et je me disais que moi aussi j’allais en faire partie, donc ça m’aidait à ne pas être frustrée de la situation.
J’ai vu que tu avais échangé, et je crois qu’Olivier Godin était fan aussi, autour de cinéastes comme Sarah Maldoror, ou j’avais vu aussi une présentation que tu faisais du début d’un film de Souleymane Cissé, alors, quand est-ce que tu commences vraiment à découvrir les cinéastes qui soient afro américains, ou africains ?
Je dirais que c’est vers 18 ou 19ans, quand j’ai commencé à aller à la Cinémathèque. C’est à la Cinémathèque que j’ai découvert, je me souviens, les deux premières rétrospectives que j’ai vu à la cinémathèque, c’étaient Tsai Ming Liang que j’ai vu en 1999, Ousmane Sembène et Monteiro. Et là, même si je savais pas encore que j’allais être cinéaste, j’ai vraiment eu un déclic et ça a complètement ouvert mes horizons vers des structures narratives plus libres ! « Oh mon dieu, c’est possible ! » (Rire) Donc c’est à la Cinémathèque que je suis devenue cinéphile. Je me suis achetée une carte et j’étais tout le temps là bas et je regardais tellement de films magnifiques, donc merci Cinémathèque ! (rires)
Et après, par exemple, les cinéastes de la LA Rebellion, ou des choses plus militantes…
Ça, c’est venu un peu plus tard, mi-vingtaine, peut-être de manière inconsciente, quand j’ai vu qu’autant j'aimais le cinéma québécois, autant j’avais l’impression - et avec raison - que c’était un cinéma qui était quand même assez hermétique, donc j’ai commencé à aller voir ce qui se faisait ailleurs, pour nourrir un esprit de révolte ou de rébellion et puis pour y trouver des outils qu’à l’époque je ne savais même pas que j’allais appliquer, mais j’avais besoin de réponses. Et comme dans le cinéma québécois, et même dans le cinéma Canadien d’une certaine façon, je ne trouvais pas de réponses, et bien je suis allée voir ce qui se faisait aux États-Unis, à Londres… J’ai aussi découvert le cinéma des Caraïbes, que je ne connaissais pas du tout, qui n’est pas enseigné dans les écoles, (rires) même maintenant.
On n’en parlera même pas au niveau de la France, parce que les français… À part Euzhan Palcy qui a une petite carrière, et qu’on a totalement oubliée par la suite, ou Christian Lara, pour nous il n’y a pas grand monde aux Caraïbes !
Non c’est ça ! Caraïbes, Amérique Latine, que je ne connaissais pas du tout et qui n'étaient pas du tout enseignées. J’ai fait le CÉGEP en cinéma, l’Université en cinéma, mais rien ! Ce qui est un peu inquiétant quand on y pense, parce que quand on prend la peine de rechercher, il y a d’excellents cinéastes !
Oui, le cinéma cubain par exemple est très important, je pense qu’il a une influence sur beaucoup beaucoup de gens.
Exact !
Alors je ne connais toujours pas Sarah Maldoror malheureusement parce que ici malheureusement, ses films ont été montrés dans certains festivals ou à la Cinémathèque, mais peu ailleurs…
C’est tout ?!
Je crois...
Et ben je ne sais pas, naïvement j’aurai cru qu’en France …
Non, on en a parlé dans des festivals, comme Douarnenez, les Cahiers ont écrit dessus, mais pour l’instant ce n’est toujours pas édité.
Ça c’est fou quand même !
Non, mais peut-être que ça va arriver…
On espère !
 Danger of Death (pour Pénélope) (2011) de Olivier Godin - Capture d'écran
Danger of Death (pour Pénélope) (2011) de Olivier Godin - Capture d'écran
Avec Olivier Godin, vous avez ce goût commun pour Sarah Maldoror. Est-ce que c’est le goût du cinéma qui vous a réunis, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? À l’Université ?
En fait on a été mariés ! On s’est rencontrés au CÉGEP à 17, 18 ans, et on a été en couple pendant 12 ans !
Ah oui, à partir de l’âge de 17 ans !
Ouais ! Ben là on est divorcés, on reste de très bon amis. On a commencé comme amis, on allait voir des films à la cinémathèque, puis on s’est rendus compte qu'on avait quand même beaucoup de goûts communs pour un cinéma pas trop commercial, même si moi j’ai quand même des goûts assez variés, il y a ici des films que j’adorerais voir ! Donc pour un cinéma un peu différent. Et puis on s’échangeait des livres, etc, et puis on s’est rendus compte qu’on avait tous deux le goût d’une certaine liberté cinématographique, donc c’est comme ça que ça a commencé ! (rire)
Comment s’opère pour toi le passage à la caméra ? Quand est-ce que tu commences à tourner véritablement ?
En tant que réalisatrice ?
Non , pas seulement. J’ai remarqué dans ses courts-métrages que tu étais au générique, comme productrice ou que tu étais parfois assistante caméra, parfois directrice photo, et quand est ce que tu commences vraiment à faire tes armes ?
C’est à l’Université, début vingtaine, que j’ai commencé. C’est quelque chose qui m’a toujours attirée, parce que je pense que mon père avait, et a toujours, un goût pour la photographie, on avait des appareils photos, je prenais beaucoup de photos adolescente, et comme je savais que je voulais travailler dans le milieu du cinéma, je me disais : « ok je vais faire de la photo, je vais être directrice photo », donc ça c’est fait un peu naturellement. Et puis beaucoup d’étudiants de mon cycle me demandaient de faire la caméra pour leurs projets, donc j’en faisais beaucoup et ça m’a mis en confiance. Puis quand je suis sortie de l'Université, toute les personnes qui voulaient tourner sur pellicule m’appelaient parce qu’il n’y avait pas beaucoup de directeurs photo, même maintenant, qui travaillent sur pellicule parce que le numérique a quand même pris beaucoup de place, donc quand quelqu’un cherche pour du 16mm « Oh oui ben Miryam… » Voilà comment ça a commencé.
Quand Olivier commence à signer des films, là vous travaillez vraiment collectivement sur les projets, parce que parfois tu es créditée à certains postes… Mais j’imagine que du coup en étant aussi proche tu devais être un peu partie prenante… ?
Oui exact, du début de l’idée à la relecture du scénario. Je fais encore la relecture de ses scénarios et avec beaucoup de plaisir ! Mais oui, on avait beaucoup de discussions… On a commencé à produire des films avec très peu de budget, donc il fallait être créatifs et ne pas se ruiner en faisant les projets ! Donc ça, c’était important dans la discussion, et aussi avec tous les membres de l’équipe. On faisait vraiment des films en collectivité, tout le monde mettait un peu la main à la pâte. Les gens recevaient les scénarios quand même assez tôt. Olivier est quand même très ouvert aux commentaires. Il y a des réalisateurs qui le sont moins - et ça se comprend, ils protègent leurs scénarios, il faut vraiment que ça soit comme ils ont écrit. Moi je respecte ça aussi, mais Olivier lui, est très dans la collaboration. Donc les comédiens peuvent apporter leur avis, l’équipe créative peuvent aussi donner leur avis, et puis moi je travaille aussi comme ça. Je trouve que j’ai tendance à être un peu trop dans ma tête, donc le fait d’ouvrir le scénario aux comédiens – comme ce sont des gens qui me connaissent bien, ils peuvent me confronter à certaines choses, (rire) avec beaucoup de douceur, moi j’apprécie beaucoup et je pense aussi que ça fait des meilleurs œuvres. Il y a plusieurs façons de faire.
Au départ, tu tournais en noir et blanc. Les premiers films que j’ai vus étaient des trucs assez elliptiques, et là il y a un film ou je me suis dit en voyant les rideaux et les meubles, qu’il y avait déjà là quelque chose qu’on allait retrouver après chez toi : la part du noir, le goût de certaines couleurs, les marrons très chaleureux et tout ça…
Oui, je pense que j’ai quand même apporté quelque chose, je ne sais pas à quel point Olivier pourra s’en rendre compte, une partie de mon identité culturelle haïtienne (rire) dans le cinéma d’Olivier, que je ne pouvais pas gommer. On en a discuté, c’est sûr, mais je pense que j’avais certains biais par rapport à ça que j’ai amené dans ma façon de faire la photo.
 Un feu de bengale (2014) de Olivier Godin - Capture d'écran
Un feu de bengale (2014) de Olivier Godin - Capture d'écran
Ce n’est donc pas lui qui a fantasmé Haïti à travers toi !
(rire) Non, exactement ! Je pense que c’est quelque chose qui est resté et puis dont je suis fière, et dans mes œuvres aussi.
Dans Le livre des abeilles (2011), tu es à la photo, au montage mais par contre là tu n’étais pas productrice. Est-ce que c’est parce que c’est vraiment la première fois que tu assures la direction photo et que tu es très prise… ?
Oui, mais c’est aussi parce qu’on faisait notre projet par blocs. Donc on a un trou dans le plan de tournage, on tourne quelques heures en fin de semaine… Pour pouvoir faire la post-production de nos films, moi je travaille dans un laboratoire de post-production à Montréal, et si je n’ai pas fait la production sur ce projet là, c’est déjà parce que j’avais beaucoup de travail. Je voulais faire plus d’heures pour pouvoir payer les gens de l'équipe. Mais je pense aussi que si j’ai fait carrière, c’est beaucoup grâce au patron de ce laboratoire là, parce que pour tous nos premiers films et comme j’étais une bonne employée - on va dire ça comme ça -, il me laissait faire la colorisation le soir, il me laissait faire le mix, alors que je n’aurais jamais eu l’argent pour les faire… Parce qu’Olivier dans ses premiers films, et puis moi aussi quand j’ai commencé à faire du cinéma, nous n’arrivions pas à être financés. J’ai fait des demandes de subventions mais elles étaient toujours refusées. Ils aimaient beaucoup l’idée mais ce n’était pas assez clair, « Trop confus ! On ne comprend pas tout ce qui se passe… » Donc on a fait nos premiers films avec notre propre argent, avec nos salaires. Pour Le livre des Abeilles, c’est donc parce qu’il fallait que je travaille, et comme je voulais aussi me concentrer sur la photographie et ne pas me disperser, si j’avais ajouté la production, je pense qu’on n’y serait pas arrivés.
Dans Le pays des âmes (2011), il y a cette culture du jazz et un montage très fluide. Ça m’a vraiment fait penser à plusieurs choses, aux grands classiques, The Connection, The Cry of Jazz ou au film de Larry Clark, Passing Through, à Rivette aussi qui a tendance à faire beaucoup de cinéma direct avec des musiciens en improvisation, comme dans Merry-Go-Round. Ce film-ci, tu l’as produit et quand je vois le montage, j’ai l’impression là encore d’être un peu dans ton univers à toi. Le mouvement, le montage peut-être…
Le Pays des âmes est un film qu’on a monté ensemble, dans la mesure où Olivier montait une partie, ensuite je remontais. On a fait beaucoup de ping pong, (rire) et puis je pense que c’est un mélange des deux qui est resté dans le film. Tu as mentionné Rivette... Olivier adore ! Il peut parler des heures de Jacques Rivette, il a a toute une collection des films de Rivette, et moi aussi j’aime beaucoup. Un tout petit peu moins, je pense que je suis moins enthousiaste que lui mais j’adore quand même, et le jazz, c’est une influence vraiment présente dans son cinéma et dans le mien aussi parce que j’écoute beaucoup de jazz. Mon père écoutait beaucoup de jazz, donc oui !
Alors, le premier plan de La boutique de forge (2012) m’a connecté directement avec certains de tes courts-métrages que j’avais vus avant. Là, je me suis dit : le voyage, l’exil, le rêve. Je me suis dit : si ça se trouve, elle a tourné les plans comme ça et puis finalement ça se retrouve au scénario alors que ça n’y était pas forcément…. (elle éclate de rire)
(elle réfléchit) La boutique de forge, ça s’ouvre sur un horizon, non ?
Oui.
Je pense qu’on a tourné ça à Tadoussac mais oui, ça n’était pas nécessairement prévu. Je me souviens qu’on allait tourner d’autres images, puis sur la route j’ai dit « oh non, on s’arrête ici! On va filmer, ça va peut-être nous servir ou non! » (rire) et puis finalement, ça a servi.
Et c’est toi qui fait la photo sur ce film là, c’est une photographie qui est très contrastée, qui est assez différente des films précédents...
Oui.
Toi tu aimes travailler avec quoi ? Quelles sont tes préférences de matériel, de pellicules ?
Je dirais que j’ai quand même un amour pour la lumière naturelle. Si je pouvais tourner tous mes films en lumière naturelle… En même temps j’ai tourné Cette maison en studio ! Ce n’est donc peut-être pas vrai, mais aussi pour plusieurs raisons... Mais oui, je recherche la lumière naturelle et pour la pellicule de prédilection, c’est la 50D de Kodak, c’est une pellicule D-light, de jour, avec laquelle j’ai tourné la majeure partie de mes courts-métrages. Je crois que mon congélateur est rempli de bobines 100 pieds de 50 D, (rire) que je peux toujours sortir avec moi, voilà ma prédilection.
 Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Et le format ?
Je dirais le 16mm régulier, qui est le format de Cette maison, qui est un format pas tout à fait carré mais presque.
Vous avez tourné dans des conditions particulières pour le Festival du Nouveau cinéma, le film, Le plantain (2013). Vous avez tourné le film très vite si je ne me trompe pas ?
Oui exactement, très vite, et avec très peu de budget ! (rire) Mais quand même, on est reconnaissants de ce budget.
Là je me suis dit : c’est un film de Miryam Charles ! (morte de rire) La manière de filmer la crête qui bouge, il y a Haïti, il y a le mouvement, il y a la lumière…
Quand même...
Celui-là ne ressemble pas au film d’Olivier Godin que j’ai vu.
Non !!! Mais en plus, c’est tous des membres de ma famille ! En fait, on est allés tourner Le Plantain, je ne suis pas certaine qu’on l’aurait tourné de cette façon là, c’est plus un film qui est arrivé comme ça. Déjà le Festival du Nouveau cinéma nous a averti à la dernière minute qu’il fallait faire ça et qu'on n’avait pas beaucoup de temps pour le faire. En fait, on allait tourner du visuel pour Feu de bengale (2014), donc on avait une demie journée pour faire quelque chose et comme Olivier s’entendait super bien avec mon cousin, on a quand même trouvé une façon de le faire et donc, oui, je peux comprendre que ça ressemble à un film de Miryam, parce que oui, ça ressemble aussi à un film de Miryam.
Et c’est dans Feu de Bengale justement qu’on retrouve un grain qui est caractéristique de ta manière de photographier et tout ça.
Exact !
En plus, tu es autrice de son scénario, et moi là je le trouve clairement plus haïtien, plus féminin aussi, il y a les plans du début, avec les jeunes filles sur la plage, il y a la fin…
Dans ma vie, au moment où j'écris Feu de bengale, je pense que lorsque que je l’ai écrit, je me suis quand même posée la question de : est ce que je pourrais réaliser le film ? Et puis j’en ai parlé à Olivier mais je n’en étais pas encore là. Et puis en plus, c’est un film qu’on a tourné avec des amis, mes cousines sont dans le film, mon père aussi… J’avais quand même tous les éléments pour être assez confortable, mais en même temps, je n’en étais vraiment pas rendue là dans mon degré de confiance en moi. J’ai dit à Olivier de lire ce scénario là, il m’a dit « Ah, j’aime beaucoup ! » et même « Tu devrais le réaliser. » « Ah non, non !… » Finalement, et comme on s’entend super bien, le tournage c’est super bien passé.
Dans ce film, il y a cette phrase « Toute chose se fabrique une langue », que je trouve qui correspond à vos films autant pour l’un que pour l’autre. Je n’ai pas vu les films d’Olivier postérieurs à cette période, je les ai pas encore vus mais je sais qu’il a sorti beaucoup de choses.
Oui quand même, 2 ou 3 long-métrages…
Alors peut être que chez toi la langue est plus mystérieuse encore, il y a aussi quelque chose de plus organique.
Alors oui, je pense que c’est autant lié à la langue, de manière littérale...
Au créole ?
Le créole, le fait que mon créole est un mélange alors que déjà à la base il est un mélange, (rire) il y a ça aussi ! Puis un langage cinématographique, un langage de vie, c’est comme tout mélangé ensemble, qui évolue à travers le temps, selon les rencontres que l’ont fait aussi, et puis j’aime l’idée que c’est vivant en fait, que ça n’est pas fixe.
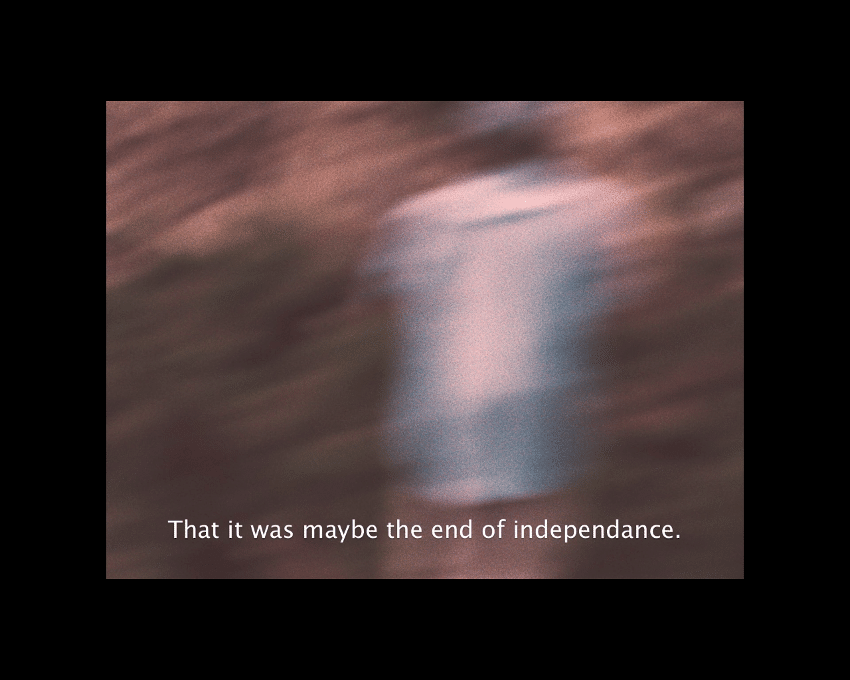 Vole vole tristesse (2015) de Miryam Charles - Capture d'écran
Vole vole tristesse (2015) de Miryam Charles - Capture d'écran
Alors, Vole vole tristesse (2015), on l’avait passé au festival quand il y a eu la thématique sur Haïti, c’est ma collègue qui l’avait découvert, et donc justement, je trouve qu’il matérialise vraiment la naissance d’une nouvelle voix féminine, et même plus ici, une féminisation des voix, qu’il explore ici de façon plus poétique et plus décalée encore, tout en étant très politique. Ce qui est un aspect que je sentais moins avant, en tout cas moins directement.
Je pense que j’essaie d’apporter des points d’une manière comme radicale mais de façon très douce, (rire) et Vole vole tristesse ça marque vraiment un point dans ma vie où il fallait que je fasse le saut, en tant que réalisatrice. Et puis c’est aussi lié à ma vie personnelle, dans la mesure où Olivier et moi on venait de divorcer et là j’ai eu un genre de questionnement existentiel « Qu’est ce que je veux faire? » Parce que oui j’avais travaillé avec d’autres personnes mais mon cinéma était quand même lié à son cinéma, et là je me suis dit « Bon !... » J’ai vraiment pris 3 ou 4 mois d’errance, on va dire ça comme ça, de questionnement, de remise en question. Puis j’ai commencé à enregistrer des sons et à fouiller dans les sons que j’avais enregistrés en Haïti. Et puis le film s’appelle Vole vole tristesse, c’est parce que je voulais aussi me libérer de quelque chose. Je pense que ça fait des années que déjà je retournais en Haïti. Au niveau politique, c’est un pays qui est très compliqué. Donc je voulais raconter une histoire haïtienne, mais d’un point de vue un peu extérieur. C’est donc une journaliste qui s’en va en Haïti et y découvre un phénomène inexpliqué : tout le monde à la même voix, une voix de femme. Je trouvais ça à la fois rigolo et, sans critiquer - parce que c’est facile pour moi qui est du Canada - intéressant sur ce que ça dit aussi du pays, ce manque d’unité, même si je pense que c’est aussi un mécanisme de survie. Chaque personne fait son truc un peu dans son coin, tout le monde se plaint du gouvernement et que ça ne va pas, mais il n’y a pourtant pas de mouvement commun, pour plein de raisons. Donc j’ai essayé de d’aborder ça à travers le film.
Et quel rapport entretiens-tu avec le cinéma de Raoul Peck, qui dénonce souvent des problèmes plus systémiques ?
Moi, c’est un cinéma qui m’interpelle beaucoup. Je pense avoir vu tous ses films, C’est quelqu’un qui me fait un peu peur, (rires) mais que je trouve courageux en fait. Moi, je ne pense pas que j’aurai le courage d’aborder les choses de front comme il le fait. J’essaie toujours de le faire d’une manière un peu détournée, parce que je pense que c'est lié aussi à la personne que je suis.
Et donc justement tu travailles le montage de l’image et du son séparément. J’ai l’impression que tu travailles beaucoup par couches...
Oui !
Alors dans Cette Maison (2022), c’est particulièrement prégnant, il y a tout un travail de fond. Pour moi, c’est un film de fantôme…
C’est exactement ça !
… Donc dès le début, il y a cet écho. Je ne sais plus si il s’arrête avant le cri de la mère. Je crois qu’il y a un long silence après le cri et après, je crois que ça revient…
Oui, exact.
… et c’est tout le temps là… Penses-tu que ça soit lié à ton rapport avec Haïti ? C’est à dire le fait que ce soit lointain, diffus, toujours présent, toujours quelque part un peu dans ta tête, c’est ton lien avec ta famille, avec le pays...
Oui. Je pense que c'est une de mes cousines qui dit souvent ça : « Haïti est dans le cœur de chaque haïtienne, peu importe où tu te trouves sur la planète, tu es toujours connectée. » Et moi je pense aussi que c’est vrai.
Danny Laferrière parle beaucoup de ça aussi.
Exact ! Donc ce son là qu’on entend presque tout du long, pour moi c’est exactement ça que ça veut dire. Et puis en effet, oui c’est un film de fantôme !
C’est même certainement un des plus beaux films de fantômes depuis que Kiyoshi Kurosawa se fait vieux ! (rires) Ça n'a pas grand chose à voir sur le traitement, mais pourtant...
Mais en fait, pour nous avec le concepteur sonore, c’était la couche de base et ensuite on a construit à partir de ça.
Oui car c’est aussi très dense…
Oui, on a eu tellement de plaisir à le faire. Autant j’ai beaucoup aimé travailler avec cette actrice que j’aime beaucoup, mais au montage, cette conception sonore c’était… ma récompense ! Pour toutes les difficultés qu’on a eu à faire ce tournage là, on a aussi pu connecter le son d'Haïti aux images de Sainte Lucie et de la Dominique. Parce que c’est encore un de mes grands deuils de ne pas avoir tourné le film en Haïti. Mais au niveau du son, ce qu’on entend la majeure partie du temps c’est ça. Et même quand on est dans la maison à Laval. Avec mon concepteur sonore, on cache des choses que nous on sait qu’elles sont là...
 Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Des sons fantômes…
Exactement, mais pas nécessairement perceptibles. Même à la morgue, on a modifié un peu ! Mais le son d’ambiance qu’on entend, c’est du son d'Haïti.
Revenons à tes courts-métrages, parce que je trouve qu’il y a une progression – normal puisque les courts-métrages sont souvent une sorte d’étude pour la suite. Dans Vers les colonies (2016), le montage est de plus en plus tranché. Tu exacerbes le rapport texte/image, au point qu’on a l’impression que tu as envie de provoquer un choc. Est-ce que ce choc servirait à raviver la mémoire ? Au delà du fait qu’après il y a la déconstruction de l’exotisme, de toute l’idée de l’exotisme du film de voyage…
Je ne l’ai jamais vu comme ça. Je ne sais pas si j’essayais de provoquer quelque chose. Je pense que j’essayais simplement de créer une distance entre Vole vole tristesse et mon second film.Vers les colonies est mon film favori dans toute ma filmographie. C’est le film que je trouve le plus apaisant à regarder. (rire) Mais je pense que c’est vraiment pour des raisons personnelles, dans la mesure où moi je n’ai fait qu’une croisière dans ma vie et je ne pense pas que j’en referai d’autre ! C’était dans un moment de tristesse inimaginable. Et j’étais avec une de mes cousines qui n’était pas non plus dans un très bon état - on va dire ça comme ça. Et puis sur un coup de tête, on s’est dit : « On va faire une croisière ! ». Et cette croisière s'arrêtait à 3, 4 anciennes colonies françaises ou anglaises. Mais c’est le voyage le plus triste et le plus étrange que j’ai fait de toute ma vie ! Quand je fais des voyages, il est très rare que j’aie une caméra avec moi. Ma cousine et moi, tout ce qu’on a fait du voyage, c’était d’aller s’asseoir sur le pont, pleurer, et de temps en temps, j’allumais la caméra pour prendre des images sans savoir que j’allais faire un film là dessus. Ça n’était pas mon intention. Déjà, pour que les gens aient l’impression qu’on faisait quelque chose de notre journée, j’allumais juste la caméra. Et même au niveau du cadre... Les cadres ne sont pas réfléchis, juste une activité entre les pleurs. Et ça n’est vraiment que 4 ou 5 mois après être revenue que j’ai voulu regarder ce que j’avais filmé à l’époque. Ça m’a inspiré l’ histoire du corps d’une jeune femme qu’on retrouve à la mer etc... On dirait que j’ai comme exorcisé cette tristesse là pour en faire un film.
C’est vraiment un peu ton idéal de création, le truc qui arrive un peu de manière fortuite…
Exactement, et puis il y a un commentaire un peu politique qui est comme : l’homme n’est pas tout.
Et donc, je n’ai pas vu Une forteresse (2018) mais j’ai lu des trucs dessus et j’ai l’impression qu’il a l’air pas mal ancré dans un fantastique qui serait plus historique, terrien. Par contre Trois atlas (2019), qui vient après, m’a pas mal surpris, je ne m’attendais pas à ce côté gothique, (elle rit) mais presque abstrait. Il y a un truc un peu répétitif là encore, et puis il y a aussi une petite déconstruction des mythes.
Je dis souvent que je n’ai pas tant d’imagination que ça, donc les films que je fais parlent souvent de ma vie. À chaque film, j'essaie aussi de raconter plusieurs histoires en même temps. Pour Trois atlas, il y a plusieurs choses. J’avais toujours voulu faire un film de vampires. À l’époque où j’ai fais Trois atlas, je n’étais pas encore financée par le Conseils des Arts ou la SODEC et je me demandais « Comment faire un film de vampires sans budget ? » (rire). Donc ça c’était mon idée de départ. Ensuite, j’ai commencé à écrire le scénario d’une conversation entre une agente de police - mais on ne sait pas exactement qui -, et une femme de ménage. J’ai déjà été femme de ménage donc la manière dont la jeune femme raconte son parcours, c’est exactement ce que je faisais moi quand j’allais chez les gens et que je nettoyais leurs maisons, donc j’ai pris pas mal de souvenirs personnels, plus cette envie de faire un film de vampires. Bon, ce n’est pas super clair non plus et quand je décris le film comme « mon film de vampires » les gens font « Hein ? ». Ce n’est pas tout le monde qui le comprend comme ça, mais moi je n’ai pas vraiment de problème avec ça.
Donc j’écris le scénario, je l’envoie à une amie que j’ai à Vienne depuis que j’y suis allée il y a peut être dix ans de ça et où j’avais assisté à une projection. C’était dans le cadre d’un festival de court-métrages et j’assistais à cette projection pour enfants. Il y avait cette comédienne là qui faisait toute les traductions : le film était en anglais, et elle, elle faisait toute les voix en même temps. J’étais tellement impressionnée, et par sa voix aussi. Cette voix m’a beaucoup interpellée. Puis je me suis dit : « Un jour, on va travailler ensemble ». Donc quand j’ai écrit le scénario, je lui ai envoyé. Je lui ai dit : « J’aimerais vraiment qu’on travaille ensemble ». Elle a fait la traduction en allemand. Au départ, le film était en allemand parce qu’aussi à l’époque, j’apprenais l’allemand et donc c’était parfait ! On enregistre chacune de notre côté, je lui envoie ma partie, juste pour qu’elle valide si on va comprendre au niveau de la langue. Elle me dit que c’est parfait, mais moi je n’en étais pas sûre « Aaah, il me semble que ce n’est pas le niveau que je voudrais, tu sais, pour que la conversation soit fluide ». Je l’ai quand même montée, même si là, je n’avais pas encore les images. Juste le son que j’écoutais et le sentiment que ça ne marchait pas. Alors je me suis dit : « Bon ! Ce que je dois faire, c’est que je vais enregistrer mes parties en créole et je vais donner l’impression que la conversation est quand même fluide entre les deux. » Aujourd’hui, je trouve que le film fonctionne encore mieux de cette façon là, parce qu’il y a quelque chose de personnel pour moi avec le créole et qui n’est pas encore tout à fait réglé. J’ai beaucoup de difficultés à m’entendre parler le créole et en plus, je n’arrête pas d’enregistrer des narrations en créole, ce qui est très étrange, parce que je trouve que c’est une langue que je ne maîtrise pas parfaitement. Comme je l’ai dit plus tôt, je parle un créole québécois, que je mélange avec plein de mots français.
Mais je racontais aussi une histoire d’immigration, je trouvais ça intéressant et important que la femme qui est accusée d’un crime se retranche dans sa langue pour répondre, et qu’il y ait quand même un dialogue entre les deux. On ne sait pas si elles se comprennent, on a l’impression que oui. À la fin on n’en est plus si certains. Après cela, j’ai monté et j’ai fait une conception sonore. Et puis pendant 2, 3 semaines j’écoutais ça chez moi et je me suis dit : « Au niveau des images, qu’est ce qu’on fait ? » Et je me suis souvenue que j’avais tourné des images en 2015, - 2013 ou 2014 ? - à Dresde. J’avais donc des images de l’Allemagne quelque part ! Donc je suis allée dans mon congélateur, j’ai trouvé la bobine, je l’ai faite développer et j’en ai été moi même surprise, parce que les rares fois où je filme, je ne prends pas de notes de ce que j’ai filmé. « Tiens, j’ai juste filmé des immeubles ! ». (rire) J’ai commencé la bande sonore après ça et monté le rythme par rapport à elle.
 Drei atlas (2018) de Miryam Charles - Capture d'écran
Drei atlas (2018) de Miryam Charles - Capture d'écran
L'air de rien, il y a presque ici une approche de la maison et j’ai l’impression qu’il y a quand même quelque chose d'architectural chez toi, ou dans ta construction générale des films, mais après ça revient il y a ce plan dans cette maison de l’église que je trouve particulièrement beau, qui m’a pas mal marqué, il y a un enchaînement de plusieurs plans mais celui-ci est le premier plutôt dans les bleus, il y a quelque chose d’expressionniste, un peu post-expressionniste et tout ça et ça m’a ramené à Cette maison et à ce goût que tu as pour ça.
Ou, je pense que c’est ce que je remarque le plus. Là je suis à Florac, et j’ai tout le temps la tête un peu en l’air… (rire) comme ça ! Il est rare que je filme des intérieurs, parce que je suis toujours un peu à distance. J’observe les choses, sans vraiment m’approcher, alors que je pourrais. Dans Cette maison, tout est un peu hostile et tout les paysages, à distance. Selon moi, ça permet d’avoir le recul pour observer. Quand on est trop proche des choses, j’ai l’impression qu’on ne les voit plus. Mais ça, c’est vraiment quelque chose de personnel, donc oui, c’est très très très important.
Il y a un film qui est assez différent, dans tes courts-métrages, je pense que tu vois lequel…
Heu, oui !
C’est Au crépuscule (2021). Je ne suis pas sûr qu’il soit plus classique narrativement mais au moins sur le plan formel. Alors pourquoi ce choix là ? Est-ce que tu avais aussi envie de travailler avec des comédiennes et de porter ces questionnements sur l’adolescence ?
Hum, je te dirai qu' au départ, non. Ce n’était pas un désir que j’avais en moi. Je pense que ça a grandi une fois que j’ai rencontré Fanie Demeule, l’autrice du recueil de nouvelles Déterrer les os. Je l’ai rencontrée dans un genre de speed dating (rire) littérature/cinéma et elle, elle avait vu mes courts-métrages. Déjà, moi je suis surprise quand les gens ont vu mes courts métrages. Donc on s’est vus cinq minutes, puis elle avait son recueil avec elle et elle me le laisse. Je rentre chez moi, je le lis le recueil et là j’ai tellement été émue par son écriture ! Elle a une manière d’écrire que je ne peux même pas expliquer. Mais comme je suis quelqu’un d’assez gêné, j’ai lu le roman et puis rien. « Bon... ben c’est beau ! » Finalement, c’est elle qui m’a écrit, elle m’a demandé « Oh Miryam, est ce que tu l’as lu ? » Puis finalement le fait qu’elle m’ait écrit, ça m’a donné l’opportunité de lui dire que j’avais adoré, puis là on s’est dit « Travaillons ensemble ! ». Puis on s’est rencontrées, le recueil à plusieurs sections selon les différents moments de la vie de cette adolescente là. Moi j’aime beaucoup sortir de ma zone de confort, Par exemple, j’aime l’hiver, mais de loin ! Mais là, je me suis dit « Allons-y pour la portion ou elle va en classe de neige », encore une fois pour sortir de ma zone de confort : tourner un film d’hiver, avec des adolescents. Il est vrai que généralement, la plupart de mes personnages sont des gens de mon âge, donc ça me donnait aussi un défi supplémentaire. Je pense qu’à cette époque là de ma vie, j’en avais besoin. Quant au personnage de Charlotte et même si je n’ai jamais vécu de troubles alimentaires, je trouve que c’est un personnage qui me ressemble beaucoup humainement. Alors, oui c’était différent de ce que je faisais, mais le personnage féminin ressemble beaucoup à tous mes autres personnages féminins, et de cette façon là, ça me rejoignait.
Et il y a quelque chose de souterrain ici. Est-ce lié aux racines autochtones des québécois ? En tout cas, c’est lié à l'environnement, le mystère est déjà là.
Oui, je pense que oui. Après, ce n’est pas que je ne me considère pas comme québécoise, mais je pense qu’il faudrait poser la question à des québécois plus « de souche ». Pour répondre à ta question, je dirais quand même oui. Mais je ne sais pas si j’ai l’autorité pour dire ça.
Parce que là tu parles de quelque chose déjà présent dans le roman,
Exactement.
Et donc tu ne sais pas tout ce qu’elle y a mis…
Non, parce qu’il y a aussi le fait que Fanie et moi, on se ressemble beaucoup. C’est une très bonne amie, mais c’est aussi quelqu’un de très privé. Elle a longtemps parlé du roman comme si c’était quelque chose d’un peu détaché d’elle, alors que c’est quand même aussi son histoire. Pour qu’elle en parle vraiment en profondeur, ce n’est pas évident. Ça lui demande beaucoup et je la comprends de vouloir garder cette distance pour se protéger.
Après tout, il n’est pas nécessaire de tout expliquer.
Non, en effet.
D’ailleurs, plus ça va aller plus ton cinéma va arriver à ça !
Exactement !
Et, après tu reviens à une forme impressionniste de nouveau avec Chanson pour le nouveau monde (2021), donc au grain. Le grain, chez toi, matérialise aussi la distance. Par rapport à ce que tu m’as dit sur la plénitude au sujet de Vers les colonies, je trouve que dans celui là moi je la ressens beaucoup cette plénitude, Mais on a jamais vraiment des clichés avec toi sur Haïti, plutôt tout ce qu’on voit ailleurs. Dans tes films, on n’a jamais cette approche là...
Ben, j’essaie de leur faire honneur. Pour parler du grain et de la pellicule, il faut préciser qu’il y a très peu de matériel tourné sur film par des haïtiens ou par des gens d’origine haïtienne, qui aie perduré dans le temps. Côté Archives nationales, Haïti est pas nécessairement reconnu comme un bon exemple de son système d’archivage. Alors, quand j’ai décidé de m’assumer en tant que cinéaste, il était très important pour moi d’aller en Haïti et de tourner des images sur pellicule parce que la pellicule pour moi renvoie quand même à l’histoire du cinéma. Donc plus je peux filmer en Haïti sur film, mieux c’est ! Pour moi, c’est très important de faire ça.
 Chanson pour le nouveau monde (2021) de Miryam Charles - Capture d'écran
Chanson pour le nouveau monde (2021) de Miryam Charles - Capture d'écran
Côté sources documentaires, d'où vient la chanson ?
En fait, l’idée de faire le film est venue du fait que le processus de tournage pour Cette Maison à été très long, entre le moment où on a eu le financement en 2019 et le moment ou on a tourné mi-2021. Et puis entre les deux, il y a eu la pandémie. Je crois que j’ai vraiment pensé à faire le film quelques mois après le début de la pandémie, surtout parce que j’ai eu une grosse angoisse car j’ai été très malade. Je me disais : « Ok bon, peut-être que je vais pas survivre » ! Dit comme ça, ça a l’air un peu dramatique. Donc il fallait que je fasse quelque chose avec des images, pour qu’au moins il y ait quelque chose qui reste et que si je meures, ce soit fini ! Et durant tout le processus de création de Cette Maison, j’ai vraiment cru que j’allais mourir avant de l’avoir achevé. C’est bizarre à dire mais il y a eu une partie de moi qui était un peu soulagée que ça se termine. Parce que j’ai eu peur de faire le film, pendant que je l’écrivais, puis pendant que je le faisais, et pendant que je le terminais j’ai eu vraiment peur de ne pas faire honneur à la famille, de passer à côté de quelque chose. Que les gens de la famille voient ce film et que tout le monde soit déçu, alors que j’en parlais depuis 7 ou 8 ans à tout le monde et qu’on me dise « Tout ça pour ça ! ». Une partie de moi a donc été terrifiée pendant tout ce temps là. À ce stade, faire Chanson pour le nouveau monde a beaucoup apaisé cette angoisse. J’y ai repris quelques chansons assez connues dans ma famille, des chansons de maman, que la mère de ma cousine a chanté à ma cousine, que ma mère me chantait... Quelques chansons aussi que j’ai écrites. Bref ça a été un vrai processus d’apaisement et de me dire « Ben si ça finit là, ça va terminer comme ça ». C’est un film que je trouve très doux, comme une berceuse.
Tu disais dans une interview que ton cinéma était très influencé par la manière haïtienne de raconter. Quelle est-elle ? Je ne m’en rends pas bien compte…
Mon cinéma est très influencé par ça. C’est un mélange de comment mon père racontait les histoires quand on était jeunes, et la manière générale dont les haïtiens les racontent. D’ailleurs, je me rends compte que je suis devenue un peu comme ça moi aussi alors que c’est quelque chose qui me dérangeait énormément quand j’étais plus jeune. Je fais aussi allusion aux récits banals du quotidien. Par exemple, si j’appelle ma mère pour qu’elle me raconte un peu sa journée, elle va prendre tellement de détours ! Mais tellement ! ! (rires) Des fois tu lui dis : « Va droit au but ! » Mais en même temps, c’est autant la manière dont on raconte les histoires que celle dont on les reçoit. Moi j’essaie de ne pas trop faire ça avec les non haïtiens parce que je sais que ça peut déconcentrer, mais quand quelqu'un d’origine haïtienne te raconte une histoire, on a tendance aussi à beaucoup l’interrompre. Donc autant la personne fait plein de détours, autant on interrompt, on donne notre point de vue, on répète… Il faut reculer dans l’histoire parce qu’on a perdu le fil… C’est sans fin ! Pour un truc très simple du genre « Je suis allée à l’épicerie et j’ai rencontré telle personne, et il m’a dit qu’il faisait beau aujourd’hui », ça peut devenir une aventure ! Mais on a tendance à faire ça, je le vois même chez les enfants de ma sœur. Et même quand on regarde des films en famille, on parle beaucoup. C’est quelque chose qu’à l’adolescence, j’ai appris à ne plus faire et quand je vais au cinéma puis que les gens parlent ça m’irrite complètement. Mais dans le confort de notre maison, au foyer, là on a vraiment tendance à commenter… (rire)
Alors, évidemment pour Cette Maison, les lieux étaient un point de départ du film et aussi de son écriture. Donc quels étaient les jalons : Bridgeport, Connecticut ?
Oui, dès la conception des premières ébauches du scénario. Moi j’écris les scénarios de manière très contre intuitive, dans la mesure où on nous a appris à l’école qu’il faut faire un synopsis long, puis un scène à scène et après tu tombes dans le scénario. Moi je commence directement à écrire le scénario, parce que je suis incapable de faire un scène à scène. Je ne sais pas exactement comment ça va se terminer donc, pourquoi faire semblant ? Même chose pour le synopsis long. Donc j’écris, je commence avec la 1ère scène, puis là j’écris mon scénario comme ça, et dès le départ je savais que j’avais 3 lieux principaux, dont Bridgeport Connecticut qui est la maison dans laquelle ma cousine est décédée au Connecticut,
 Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
La base documentaire…
Exactement. Laval, parce qu'au départ il y a plusieurs scènes qui ont été tournées en studio, qui devaient être tournées à Laval. On devait tourner à Laval dans la maison de ma sœur et aussi chez mes parents. Pandémie est arrivée... Je dit souvent que j’aime plus ma famille que je n’aime faire du cinéma, et je sentais qu’il y avait un inconfort. Tout le monde avait dit oui mais je le sentais… Ma mère n’étais pas à l’aise, ma sœur non plus avec ses jeunes enfants - là on parle du tout début de la pandémie, il n’y avait pas encore de vaccin, donc tout le monde était un peu inquiet, puis je sentais que plus on avançait vers les dates de tournage plus tout le monde était inquiet. Je leur ai donc dit « Écoutez, il n’y a vraiment pas de problème, on va trouver une solution ». On est donc allés en studio et je trouve que ça sert encore mieux le film, parce que c’est un film sur la mémoire, la mémoire fracturée par les traumatismes. Quand on est en studio, on s’en rend compte visuellement, on n’a pas essayé de le cacher. Je l’ai dit à la direction artistique, à celle qui fait la direction photo et on voit les cadres. Avec le film que je voulais faire, ça fonctionnait parfaitement. Quant à la maison Connecticut, on n’a pas tourné non plus dans la maison. c’est comme je le raconte dans le film : on est allés, on a tourné avant. Il faut vraiment que je remercie la productrice qui était avec moi, parce qu’elle ne ma pas forcée alors que c’était notre but ! L’objectif, c’était : aller dans la maison, tourner des images et retourner avec les comédiennes. En fait, aller tourner des scènes dans la maison, j’en étais émotionnellement incapable. Personne ne m’a forcée à le faire, même si c’était écrit comme ça. J’ai donc modifié le scénario pour le faire autrement.
Alors, j’ai l'impression, et dans ton cinéma aussi, que tu aimes beaucoup tout ce qui est filtres. Alors, ça participe aussi du processus de distanciation avec le grain de l’image, la brume, les brûlures de la pellicule, la surexposition de la pellicule, la pluie sur le carreau… C’est comme si, alors que le son chez toi permet de visualiser très bien les choses, au contraire l’image a un peu du mal à naître ?
Oui, c’est étrange à dire de la part de quelqu’un qui a fait de la direction photo, mais j’ai l’impression que c’est surtout nécessaire pour certains sujets. Et puis ça fonctionnait très bien avec le sujet que je voulais aborder, bien mieux qu’une image trop claire. Déjà, il fallait que je crée une distance, autant pour me protéger dans le processus que pour protéger ma famille dans ce même processus et ce jusqu’à la direction d’acteurs. Ici, les acteurs sont dirigés de manière très théâtrale. Ils parlent même un français qui n’est pas un français naturel québécois, mais comme on l’appelle au Québec, le français international, qui est le français de Radio Canada. Ça aussi, ça crée une autre distance, un mécanisme de protection, dans la mesure où oui, c’est quelque chose qui m’interpelle beaucoup. Il fallait déjà que je survive à faire ce film là, il fallait que je sois capable de le voir, que ma famille aussi puisse le voir. En fait, je ne voulais pas les choquer.
Et, donc tu dis au début « réalité reconstituée », « fiction documentée », « une vision au potentiel prophétique ». Est ce que toi tu as, à partir de ce que tu savais déjà, creusé encore plus l’histoire ?
Oui, dans la mesure où j'ai quand même eu une démarche documentaire. J’ai fait des entrevues, que j’ai enregistrées, parce que c’est un événement traumatisant pour ma famille mais aussi un événement dont on n’a plus parlé à partir du moment où ma cousine à été enterrée. Ce n’était pas comme si j’avais des souvenirs très frais, parce que depuis treize ans plus personne n’en parlait. Donc pour faire honneur à l’histoire que je voulais raconter moi-même, il fallait que j’aille poser moi même des questions. Donc on a eu des longues conversations où tout le monde faisait un peu des détours avant d’arriver au but. Mais j'ai rencontré la mère de ma cousine, puis ses sœurs. J’ai fait des entrevues avec ma mère, avec mes sœurs, mon frère, beaucoup de gens de la famille, juste pour avoir des avis différents, me rendre compte aussi qu’on se souvenait des mêmes événements de manière très différente aussi. Donc ça aussi ça m’a aidé sur le fait que la mémoire nous joue pas mal de tours. Ce n’est jamais aussi clair que l’on pense que ça l’est et j’ai essayé de traduire ça dans le film, cette confusion, ce flou par rapport au souvenir. On se répète les mêmes histoires de manière un peu différentes…
Alors, il y a des choses vraiment terrifiantes, les quelques plans de nature, le plan de la petite fille qui monte, comme chez Kurosawa ou je pense aussi au film Les Innocents de Jack Clayton. C’est extrêmement fort, ces plans d’apparitions, très dramatiques…
Oui, ce sont des plans captés. Ce ne sont pas des gens que je connaissais d'emblée. Je les ai vus de loin, puis j’ai filmé, puis après je suis allée voir la madame, je lui ai dit : « Je viens de vous filmer ». Là elle commence à me parler de sa vie, de sa petite fille, etc. Donc je les avertis et on avait des feuilles aussi, juste au cas, en anglais on dit des releases mais en français des autorisations de droit à l’image. Mais ce n’était pas quelque chose de prévu, et pourtant ça fonctionne tellement bien dans le film, la petite fille et sa mère...
 Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Alors, pourquoi avais-tu besoin de ces fonds noir, même si la néantisation du fond on peut la voir dans tes autres films, ça renforce le contraste total et même, ça renforce un peu tout.
Est-ce que tu parles des scènes de morgue ?
De toutes celles où tu utilises un fond noir absolu.
Bon, déjà, pour la scène de la morgue, on devait tourner dans une vraie morgue. On est allés visiter mais moi je ne pouvais pas tourner des scènes là et cette scène là en particulier ou alors je ne sais pas si après je pourrais continuer à faire le film, donc là aussi le fond neutre me permettait encore une distance. Il me permettait aussi de mettre en scène. Je ne pense pas que j’aurais été capable de mettre en scène dans un vrai lieu, déjà parce que je mettais en scène quelque chose de vrai. Au niveau du cerveau, ça m'en demandait trop. Donc quand on a su qu’on allait tourner en studio, avec la directrice photo on s’est assises, puis on a revu toute les scènes et on s’est dit : « OK cette scène là, en studio. Cette scène-là aussi ! ». Mais aussi pourquoi ce choix. Par exemple, la scène avec le jardin intérieur : cette scène là devait être tournée au Connecticut. Le jardin est inspiré du vrai jardin, mais là encore, au niveau émotionnel, ça ne se passait pas ! Donc on a recréé le jardin à l’intérieur de la maison… et ça m'a permis de tourner la scène de cette façon là.
En même temps, tout est beaucoup plus beau puisque tout est composé…
Exact ! Je ne dis pas que ça n’aurait pas nécessairement fonctionné si on y était allés. Ça aurait créé quelque chose de différent..
Par rapport à l’utilisation des couleurs, certaines de tes couleurs n’ont jamais été aussi éclatantes. L’indigo, certaines nuances de bleu...
Oui mais c’est quand même le film où j’ai eu le plus de budget, même si ce n’est pas un film à gros budget. J’ai pu travailler avec deux personnes à la direction artistique. D’habitude c’était surtout moi (rire) et des fois, ma sœur venait m’aider. Et puis cette fois, je voulais tellement faire honneur à la culture haïtienne, alors comme j’avais les moyens de le faire, je me suis dit « On va tout mettre ! » Il y a des peintures, des bibelots, des objets très spécifiques à la culture, qu’on a pu mettre dans ce film. Un des directeurs artistiques est aussi né en Haïti, donc on s’est beaucoup nourri de ça, même au niveau des vêtements, des coiffures. Alors oui, on s’est gâtés ! Une de mes plus belles récompenses au niveau de la réception du film, c’est qu’il y a beaucoup de haïtiens à Montréal qui ont vu le film. Bon, il y a eu deux commentaires. Le premier, évident, que je savais très bien qu’il allait arriver : dès la première image, les haïtiens savent qu’on n’est pas en Haïti. À la fin, les gens lèvent la main, « Mais, est-ce que ça a été tourné en Haïti ? Il me semble que ça ne ressemble pas… » Et ils ont complètement raison; ! Mais le deuxième commentaire qui est ressorti, c’est à quel point ils étaient reconnaissants de retrouver autant de couleurs, autant d'objets, jusqu’à la nourriture - ce qu’on ne voit jamais dans le cinéma québécois, et ça pour moi c’était vraiment une belle récompense.
Quels étaient les détails qui les rendaient si sûr que ce n’était pas tourné en Haïti ?
Si tu es allé en Haïti et que tu as visité le pays, tu sais à la première image du film, un genre de mont isolé, que ça n’y existe pas vraiment. (rire) Après, j’ai quand même essayé, du mieux que j’ai pu, mais je me disais bien que ça n’allait pas passer car la végétation en Dominique, c’est un peu différent. Sainte-Lucie ressemble un peu plus, mais finalement je n’ai pas tellement utilisé d’images de Sainte-Lucie pour plein de raisons. Ça m'inspirait un peu moins au niveau du montage, du rythme etc...
Alors, j’ai vu que la scène du référendum était pas mal commentée par les québécois. Il ne pouvait pas en être autrement !
En effet !
 Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Et donc il y a ce plan du téléviseur, avec d’un côté un buste de Napoléon et de l'autre un éléphant je crois, ou une girafe, des objets à valeur symbolique...
Oui et placés à bon escient, c’est vraiment calculé là !
Donc Napoléon, c’est le côté francophone...
Oui, le côté francophone et de l’autre, le côté africain, dans la mesure où il y a quand même une filiation entre Haïti et l’Afrique. Mais il y a aussi quelque chose de très surprenant chez les haïtiens, d’une certaine génération, presque tout le monde a des effigies de Napoléon. Alors que si on comprend l’histoire d'Haïti, le colonialisme, c’est très étrange. Mais pourtant c’est là presque partout : chez mes parents, chez mes tantes, chez mes grands-parents… Tout le monde a son petit buste… Moi, (rire) oh non j’en ai un chez moi mais parce que je l’ai gardé du tournage !
Ça devient plus un symbole de l’autoritarisme...
Non, je ne pense pas.
Quant au sens politique de la scène, au delà du fait que forcément on peut comprendre que pour beaucoup ça n’était pas simple. Déjà je me souviens des commentaires ici en France et que moi-même qui étais allé au Québec, je ne savais pas trop si j’avais envie que le oui emporte la victoire.
Non, mais pas du tout !
… Je savais que la famille chez qui j’étais craignait que les québécois s’isolent, se replient sur eux-même. Ils voulaient plutôt qu’ils restent ouvert sur l’extérieur, et j’ai l’impression qu’ici c’est un peu ça aussi ?
Oui, dans la mesure où le vote a quand même été très serré, ce n’est pas une victoire écrasante non plus. J’ai eu beaucoup de discussions avec le producteur du film qui est un très bon ami à moi mais qui est indépendantiste jusqu’au cou, à fond ! Et quand il a lu la première version du scénario, il était tellement surpris, déjà de voir des gens célébrer le Canada, pour lui ça n’avait aucun sens ! Ce qui fait qu’on a eu des discussions là dessus, que je lui ai expliqué comment et pourquoi. Moi j’étais quand même très jeune à l’époque du référendum et c’est vraiment plus tard que j’ai apprise l’histoire du Québec, René Lévesque etc. J'ai alors compris les enjeux et les raisons de cette envie de séparation. Alors qu’enfant, j'étais comme « Oh, mon dieu, le Québec va se séparer, c'est la fin du monde ! » Et pour mes parents aussi c’était la fin du monde, parce que sans critiquer le gouvernement de l’époque, je pense que les explications du projet référendaire étaient insuffisantes. Il y a quand même quelque chose qui n’a pas été fait au niveau de toute la population immigrante, qui aurait pu être mieux fait selon moi pour mieux expliquer le projet référendaire. Mais là, tout le monde avait l’impression que ça allait être le chaos, la guerre, des trucs comme ça, qui ne seraient pas nécessairement arrivés, bien sûr. Mais c’est une conversation qui est encore difficile à avoir ! Je sais que j’ai fait plusieurs projections au Québec et il y a des gens qui étaient fâchés. Vraiment, outrés, ils n’arrivaient pas à croire ça… Mais en même temps, c’est intéressant d’entendre ce type de points de vue là, ça montre à quel point les gens sont très fermés sur la réalité. Parce que dans cette scène là, moi je ne suis pas en train de critiquer le Québec, je suis juste entrain de montrer une réalité...
Ben oui, de toute façons, il y a bien des gens qui l’ont voté…
Non mais c’est impossible que ce soit juste des immigrants. Puis on m’a souvent demandé comme il y a un extrait sur le téléviseur de la soirée référendaire, quand j’ai dit que j'allais faire le film et qu’une partie se passait durant la soirée du référendum, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j’allais prendre l’extrait un peu plus tard dans la soirée où le premier ministre du Québec blâme les immigrants pour la défaite. Et moi j’avais 8 ans et je pense que c’est à ce moment là que j’ai compris que je n’étais pas perçue comme québécoise, parce que ça avait été dit avec tellement de ... - et je peux comprendre la frustration parce que bon on a perdu -, mais avec tellement que dédain que j’ai fait comme « Oh, OK, donc c’est de notre faute, donc nous on est pas québécois ! », Donc ça avait fait beaucoup parler, il s’était excusé après... Mais j’ai décidé de ne pas mettre cette portion là dans le film, pour ne pas redonner de l’attention à ça. C’est un moment tellement important dans l'histoire du Québec, tout le monde s’en souvient.... Je ne voulais pas ranimer le débat là-dessus non plus.
Alors, ah oui, tu en as parlé tout à l’heure, ton producteur, Félix Dufour-Laperrière est également cinéaste mais dans un genre très différent et ça crée peut être une distance supplémentaire par rapport au projet d'être dans un domaine très différent. Quel regard porte-t-il sur ce type de cinéma ?
À la base, Félix est quand même un bon ami, mais c’est aussi un cinéphile, quelqu’un qui a une ouverture sur le cinéma très large. Donc créativement, il y a tout de suite eu une connexion. Est-ce que tu as vu les films de Félix?
J’ai vu beaucoup de courts, mais toujours pas les longs hélas...
Ah mon dieu ! Il fait des films exceptionnels et on s’y rejoint aussi beaucoup par le son et la voix, parce qu’il fait des films d’animation puis beaucoup d‘enregistrements sonores. On travaille aussi avec le même concepteur sonore, donc ce mariage créatif est très bien fait.
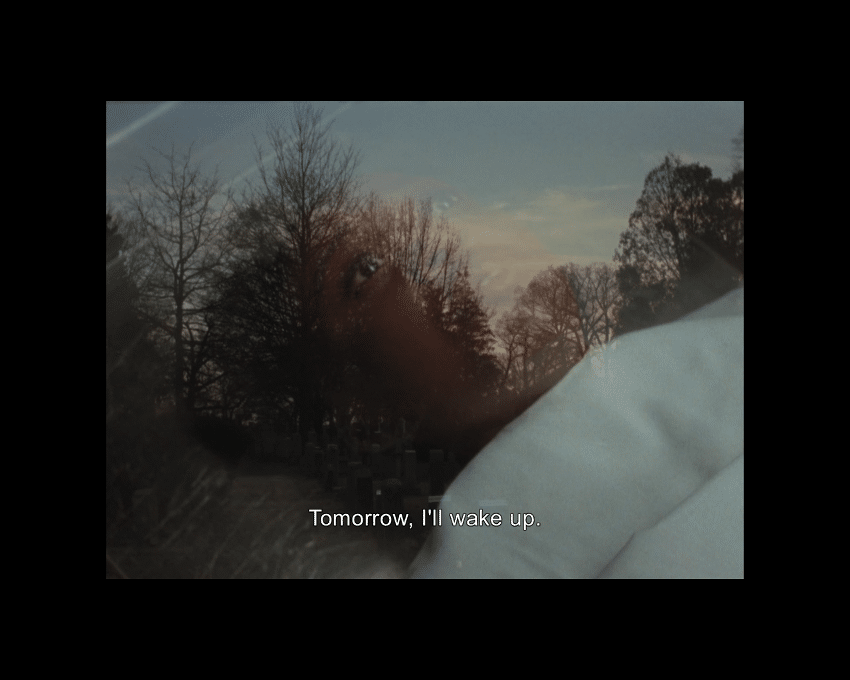 Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Cette maison (2022) de Miryam Charles - Capture d'écran
Alors, le côté incantatoire, ça aussi c'est lié à la culture haïtienne, la polyphonie des voix, les répétitions ?
Oui, c’est lié à la culture haïtienne
À la spiritualité…
Oui, à la spiritualité, et je pense qu’il y a deux types de spiritualité dans le film, même si ce n’est pas précisé, mais il y a comme tout ce pendant religieux, parce que moi j’ai quand même été élevée dans la religion chrétienne, et c’est vraiment plus tard que j’ai découvert tous les autres types, le vaudou… les prêtres, prêtresses vaudous, ce qui était très caché ou tabou dans ma famille, donc j’ai réappris à me reconnecter d’une certaine façon avec les ancêtres, etc, donc cette pluralité de spiritualité fait aussi partie de moi je pense.
Oui, on le sent aussi et très fortement, dans les courts-métrages. Si on a cru au départ à un ancrage dans le réel, c’est par la suite les possibilités de la fiction qui se retrouvent confinées dans l’espace temps du film. Est-ce que ce pessimisme recouperait ta philosophie de l’existence ?
Je pense que c’est un entre deux, je suis à la fois pessimiste et optimiste, je ne sais pas si c’est possible mais je pense que oui, parce que dans la mesure ou, je suis très consciente que ça ne va pas bien, à plein de niveaux, humains, planétaires, politiques, environnemental, dynamique... Il y a tellement de choses qui pourraient être améliorées, mais ça me motive aussi. Je pense que déjà mon pessimisme me motive à être une meilleure personne, à changer comme je peux par rapport à mon environnement. Je pense que je n’ai plus cette naïveté de : « Je peux changer le monde ! » comme quand tu es jeune. Alors que là, c’est plus concentré sur mon environnement, mon milieu, ma communauté. J’essaie de faire du mieux que je peux, mais oui il y a quand même un pessimisme dans mes œuvres, que j’assume en fait. Oui, je n’ai pas honte de ça.
Et est-ce que tu es déjà en écriture sur un autre projet ?
Oui, je suis en train d’écrire mon 2ème long-métrage, qui va être une comédie expérimentale poétique. (elle éclate de rire) Je ne suis pas encore sûre du côté comique, mais bon, c’est correct ! Je pense que si le public ne trouve pas ça drôle, je peux vivre avec. Je n’ai pas vraiment d’attentes par rapport au public, je ne pense pas au public quand j’écris parce que je trouve que c’est quelque chose d’un peu dangereux, en tout cas pour moi, dans la mesure où tu ne peux pas anticiper ce que les gens vont aimer ou pas, et moi j’accepte quand les gens aiment pas aussi, parce que en tant que personne je n’aime pas tout, donc quand quelqu’un n’aime pas, je ne me sens pas comme meurtrie. J’ai lu des mauvaises critiques de mon film, de Cette Maison mais je comprends, c’est pas pour tout le monde, et puis ce n’est pas tout le cinéma non plus qui est pour tout le monde aussi. Donc, c’est correct.
Merci à Miryam Charles et à toute l'équipe du festival Vues du Québec.