Crédits images
Portrait : Lëa-Kim Châteauneuf
Bandeau : Inis
Entretien avec Pierre Audebert
Tu es au festival de Florac pour présenter ton premier long mais en réalité, tu es actif depuis 25 ans puisque tu as été un talent précoce. Peux tu nous dire quels ont été les éléments qui ont déterminé ton envie d’être cinéaste ?
Ça a surtout été le dessin… Mes parents étaient déjà assez âgés lorsque je suis né et ils ont vite appris que s’ils me laissaient tout seul avec un crayon et du papier, au fond j’allais m’élever tout seul. Enfant, je dessinais donc et ça s’est doucement transformé en désir de faire des films d’animation. Adolescent, j’étais très sérieux et je me suis vraiment consacré à ça. Sinon, si je dois nommer un film qui m’a vraiment marqué dans mon jeune âge, je dirais que c’est le Duck’s soup des frères Marx. Je suis vraiment devenu obsédé par les Marx brothers, surtout par mon préféré, Groucho. J’ai beaucoup appris sur sa vie, ses méthodes, sa démarche en tant qu’humoriste. Je m’habillais en Groucho et tous les jours je mettais une moustache, des sourcils… Je portais aussi des fausses lunettes et j’avais même un petit cigare. (Rire) Pour tous les adultes de mon entourage, c’était très agaçant et ça, ça a duré des années.
Comment un adolescent de 15 ans se retrouve à créer pour la télévision ? En France, ça paraîtrait impossible !
C’est sûr que j’aurais du plutôt être en train de voler dans les commerces ou vendre de la drogue ainsi que le font beaucoup d’adolescents, mais moi j’étais trop sérieux. Non seulement, je voulais déjà faire du cinéma, mais le faire de façon sérieuse. J’avais quelques amis qui étaient cinéastes d’animation à cette époque et qui faisaient des capsules pour l’émission pour enfants Sesame street, en partie produite à Winnipeg durant mon adolescence. Ils m’ont donc expliqué le processus et je me suis dit que j’allais faire pareil. J’y suis allé et c’est comme ça, il y avait une ouverture. Ça, c’était pendant les années 90, mais peut-être qu’aujourd’hui, ce serait impossible ! De fait, il n’y a d’ailleurs plus ce genre de choses en production à Winnipeg aujourd’hui. À l’époque, je dessinais très bien et j’étais assez sérieux pour être crédible, ça doit être pour ça. Ce serait une bonne question à poser à la personne qui m’a engagée ! Mais cette personne est morte… (rire)
Quelle a été ta première impression en rencontrant Guy Maddin et en le voyant à l’oeuvre sur un plateau ?
Il est très généreux avec les jeunes cinéastes et les créateurs émergents à Winnipeg, très impliqué, concerné. Il prend très au sérieux sa position de mentor. Guy Maddin est bien sûr le plus connu de cette communauté et c’est un cinéaste que j’adore. Il fait partie d’un écosystème d’artistes qui s’auto-alimentent beaucoup, c’est ça le système de Winnipeg. Je pense notamment à John Paizs qui était le mentor de Guy Maddin et d’autres qui ont suivi par la suite. John ou Guy ont développé des techniques qui permettaient de travailler sur une échelle totalement épique pour un budget de quelques dollars et ça, c’est quelque chose qui m’intéresse et qui m’inspire beaucoup. Ce que je retiens le plus de Guy Maddin, c’est de faire des petits moyens une vertu esthétique. Par exemple, avec le même budget de ce que je peux avoir au Québec, les gens font normalement des films beaucoup plus minimalistes, avec sagesse d’ailleurs… Des huis-clos avec un minimum d’acteurs et de décors. Mais chez moi, cette tendance ne sort pas de façon organique ! Je me vois comme un maximaliste et ça, c’est très winnipegois ! Les films y sont toujours très denses, très surréalistes avec un humour très bizarre et ils sont toujours sur une échelle beaucoup trop démesurée par rapport au budget disponible. C’est donc une méthode que je retiens de Guy et c’est encore une source d’inspiration.
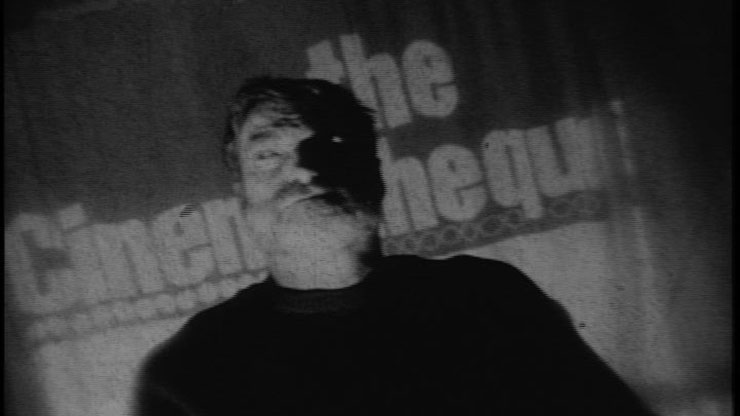 Barber Gull Rub (2008)
Barber Gull Rub (2008)
En France, on ne se rend pas encore compte mais Winnipeg, c’est comme un chaudron en ébullition. Hormis Maddin ou toi, on a pu entendre parler de Paizs et de Crimewave, bien qu’il porte le même titre que le Sam Raimi sorti la même année. Peux tu nous détailler les différents groupes ou réseaux d’artistes en activité à tes débuts et ceux dont tu as croisé le parcours ?
Je dirais que parmi les cinéastes qui m’ont le plus impacté, il y a d’abord Solomon Nagler qui vit maintenant à Halifax et qui travaille beaucoup avec la matérialité de l’émulsion. Ce que j’aime beaucoup chez lui et qui se retrouve dans mon cinéma, c’est l’utilisation du langage du cinéma abstrait ou avant-gardiste mais à des fins quand même narratives. La syntaxe et la grammaire du cinéma expérimental peuvent être mobilisées pour raconter une histoire, créer des émotions ou développer un personnage. Sol reste quand même dans l’abstraction mais pas dans le formalisme absolu dans le sens où il reste toujours quelque chose de narratif, un petit récit et ça c’est quelque chose qui m’a beaucoup marqué, cet énorme travail sur la pellicule. Je le vois encore comme l’un des professeurs de cinéma les plus importants pour moi. Je citerai aussi Deco Dawson, collaborateur de Guy et coréalisateur de The heart of the world, pour moi un des plus grands courts-métrages de tous les temps à l’échelle planétaire ! Lui aussi a beaucoup participé à mon éducation. Je les vois comme mes parents de cinéma winnipégois. Au Québec, c’est la même chose. J’ai été fasciné par les cinéastes qui ont une certaine ironie, ce qui est plutôt rare dans le cinéma québécois qui est normalement très sincère, honest plus précisément. Sans ironie justement. Il y a quand même quelques cinéastes qui se démarquent : Denis Côté bien sûr, Robert Morin et Stéphane Lafleur. Voilà ceux qui ont servi de proviseurs - à part Morin- quand j’ai commencé à travailler en tant que cinéaste « à plein temps ». Ils m’ont servi de diapason.
D’où vient le style des films de Winnipeg : décalé, absurde, fauché, délirant, dépressif comme l’a dit Maddin ?
C’est la ville la plus triste du monde ! C’est difficile à dire mais la réponse habituelle, c’est qu’on est isolés. C’est loin de tout au Canada. Ça devient donc bizarre du fait de ne pas avoir de points de contact avec le reste de la planète. C’est sans doute vrai jusqu’à un certain point mais au-delà de ça, je dirais que c’est son statut d’étranger qui fait aussi partie de ça. Au Canada, Winnipeg est un objet de condescendance, la tendance est à la moquerie et à l’exclure du mainstream culturel et je pense que par la force des choses, ça provoque une contre-culture qui s’installe à Winnipeg et qui est vraiment Punk rock et contre rien, qui se prononce contre les tendances culturelles, les centres de pouvoir. Je pense que cela se voit vraiment dans le travail des cinéastes winnipegois.C’est contre le zeitgeist (climat culturel dominant ou esprit du temps). La création de notre époque est très minimaliste et s’exprime selon le zeitgeist économique à l’échelle planétaire. Les winnipegois sont tout au contraire des maximalistes.
J’ai été assez étonné par le film collectif Kubasa in a glass qui dresse une sorte de best-of des publicités commerciales des networks locaux, agrémenté de quelques extraits d’émission ou courts-métrages comme cet espèce d’happening de Maddin contre les mutants ou ton très beau court expérimental I dream of Driftwood. Quelle a été exactement ta participation à ce travail de collectage et de montage ?
Aujourd’hui, c’est devenu tout à fait normal de passer du temps avec des cassettes VHS. Mais la télévision éphémère est quelque chose qui me fascine formellement, le langage de la télévision de cette époque là. On faisait une sorte de télévision communautaire à la manière des années 70 ou 80. Pour Survival, l’idée c’est de faire un film essai, le bonus éventuel de ces objets. Comment est-ce que ça incarne la ville et son esprit ? Quel en est l’esprit ? Le tout en abordant la publicité sur ces spots à très petits budgets. Ça représente sans doute la vision capitaliste ou commerciale de quelques personnes, mais il y a quand même des décisions artistiques qui sont prises. C’était donc une façon de regarder ce matériau là. Ma participation a été jusqu’à la construction de l’ensemble, parce que c’était quand même construit !
 I dream of Driftwood (2006)
I dream of Driftwood (2006)
J’ai l’impression que tu préfères le 16mm et la pellicule. Ce qu’on voit dans I dream of driftwood, c’est que les lieux ont aussi une identité, ils sont hantés comme si la ville et son urbanisme pesait sur les habitants, un peu comme dans l’œuvre du cinéaste expérimental japonais Takashi Ito. Et puis il y a au 2/3 du film ce texte punk jeté en stop motion au milieu de ce montage épileptique « home for ever of you poor bastards ». Y avait-il une forme de colère en toi à l’époque par rapport à la gestion de la ville, de la collectivité ?
(il éclate de rire) Yeah… peut-être. J’ai grandi dans un de ces édifices qui s’appelle The lady Adele’s appartments. C’est quelque chose que j’ai vraiment fait spontanément avec ma caméra super 8. Je me promenais dans la ville en vélo et j’ai fait la capture de toutes ces images, sans trop de certitudes quant à ce que j’allais faire avec. C’était juste un mouvement d’architecture à Winnipeg que je trouvais fascinant et singulier. Il s’agissait d’édifices carrés, fait avec des briques de couleur claire, qui sont vraiment utilitaires. Sans âme ni signification. Et pourtant, on leur donne des identités vraiment grandioses comme The New-York appartments... Bref, ces noms semblent leur promettre un destin spectaculaire que les espaces ne fournissent absolument pas en tant que tels. Aussi, cette ironie me fascinait : ces édifices sont fait avec un œil sur l’économie, l’utilitarisme et pourtant il y a ce nom. C’est très Winnipegois et c’est aussi ce que j’étais en train de subir. Ce n’est pas forcément une colère, mais une façon de mettre en scène.
On retrouve cette folie du montage, ce goût de l’image vidéo un peu pourrie aussi et de l’hybridation dans le documentaire satirique que vous avez consacré avec ton coréalisateur à l’équipe de hockey des Jets de Winnipeg, Death by popcorn. Mais comment ce projet sur ces idoles locales a-t-il été perçu ?
En fait, ce projet était extrêmement populaire localement. On l’a présenté pendant une semaine à la Cinémathèque de Winnipeg, deux fois par jour, et chaque représentation était pleine. C’était vraiment un phénomène et les gens avaient le goût de consommer ce matériel. La raison pour laquelle on l’a fait est très simple. Il y avait à Winnipeg une chaîne de télé qui a fait faillite et qui se débarrassait de toutes ses archives. Or je connaissais un peu l’archiviste. Il m’a appelé et m’a dit de venir récupérer le matériau jeté aux poubelles. On y est donc allé et on a récupéré un millier de cassettes. On a donc passé le contenu au crible et c’était surtout des matches des jets de Winnipeg, donc que du hockey ! Non seulement les matches, mais aussi tout le phénomène culturel qu’était le hockey à Winnipeg et la chute de cette équipe pour des raisons économiques, ce qui a provoqué un traumatisme existentiel chez les winnipegois. C’était un peu la référence, son cœur. Le fait qu’on ait commencé à faire le film à cause de cela et on ait été aussi très inspirés par les films de Craig Baldwin ou Bruce Conner, autres cinéastes expérimentaux qui travaillent à partir d’une base d’archives. C’est donc l’accès à ce matériau qui a motivé ce film et on a commencé à construire une histoire parallèle des Jets de Winnipeg. Le film était très populaire mais là la compagnie qui avait racheté la chaîne de télé en faillite nous a menacé par une lettre qui disait qu’on devait détruire toutes les copies du film et l’archive. Ça a été mon premier point de contact avec les dangers du droit d’auteur. Finalement, cette tentative de nous punir a provoqué la réaction populaire inverse. Les chroniqueurs des journaux étaient vraiment de notre côté (rire) et finalement suite à ce conflit, la chaîne de télé a retiré son veto.
 Death by Popcorn: The Tragedy of the Winnipeg Jets (2006, coréalisateurs : Mike Maryniuk, Walter Forsberg)
Death by Popcorn: The Tragedy of the Winnipeg Jets (2006, coréalisateurs : Mike Maryniuk, Walter Forsberg)
Venons en à ta passion du Québec. Tu as choisi d’étudier l’histoire du Québec. Qu’est-ce qui t’attirait plus que l’histoire du Manitoba ? Un passé plus riche, leur volonté d’indépendance ? Ou encore et comme vous le disiez avec humour à propos des Jets, est-ce parce que l’histoire est vraiment écrite par ceux qui perdent ?
Avant tout, le désir était de me réinventer personnellement. Je suis donc arrivé pour m’inscrire à l’université McGill et très vite, dès la première semaine de mon arrivée, j’ai du constater que tout ce qui était intéressant se trouvait du côté francophone et pas dans la communauté anglophone de McGill. Je me sentais tellement déconfit de ne pas accéder à cette culture parce que je ne parlais pas le français ! j’ai donc commencé à l’apprendre à cause de ce très fort intérêt pour tout ce qui se passait du côté francophone. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi on s’intéresse à quelque chose, cela reste difficile à cerner. Je crois que ce sont plutôt nos intérêts qui nous choisissent que l’inverse. Quand je suis arrivé à Montréal, le référendum de 1995 était encore un peu dans la culture politique et être unilingue anglophone était à ce moment là beaucoup plus politique. Ça a peut-être été un facteur, mais j’étais aussi très attiré par le nationalisme québécois et l’aventure francophone en Amérique du Nord.
Quels souvenirs gardes-tu de ton passage à l’INIS?
Je dirais que c’est surtout les amis que j’y ai rencontrés. En fait quand je dis que j’ai étudié à l’INIS, les gens ne me croient pas parce que c’est quand même une école de cinéma très commerciale. C’est une formation pour travailler dans l’industrie et moi le genre de cinéma qui m’intéressait, ce n’était pas vraiment ça. En même temps, ça a été ma porte d’entrée vers un matériel de cinéma auquel je n’avais pas accès avant.
Les passerelles avec le style visuel ou narratif de Maddin sont nombreuses et fréquentes dans ton œuvre, comme si c’était ton port d’attache ou une référence inconsciente...
Oui, tout à fait ! Et je pense aussi que pour Guy, ses films sont aussi des collections de références sur d’autres films. Je pense que c’est la même chose pour Le vingtième siècle. Il s’inscrit dans une tradition très artificielle. En théorie au cinéma, on fait l’effort de rendre tout tellement réaliste qu’on en oublie que ce n’est qu’un film qu’on regarde. Mais il existe quand même une tradition parallèle où on assume l’artificialité du cinéma et cela fait partie de l’expérience esthétique. Je pense par exemple au cinéaste d’animation tchèque Karel Zeman, aux premiers films de Lars Von Trier et à Guy qui est un des grands-maîtres de ce cinéma parallèle, mais il y en a d’autres. Je me situe absolument dans cette même idée et il y a des références à tous ces cinéastes. Mais c’est surtout le sujet qui se prête à ce genre de traitement. Mon prochain film ne sera pas un film de studio et ne sera pas tourné en anglais, ni en français mais en perse. Il sera tourné en décors réels sur des lieux qui existent et avec des non-acteurs. Il s’agira donc de toute autre chose au point de vue esthétique, mais même ici, cette question peut encore se poser. Pour moi, le cinéma commence dans ma communauté cinématographique de Winnipeg et à plusieurs niveaux Vingtième siècle est un hommage à cette tradition esthétique là.
 Le vingtième siècle (2019)
Le vingtième siècle (2019)
Le film va-t-il se tourner au Canada ou en Iran ?
Surtout au Canada, mais une journée est prévue en Iran !
Est-ce que cette idée vient de ce fameux accent farsi que tu aurais pris selon les anglophones d’origine moyen-orientale comme on pouvait le voir dans ton autoportrait tourné avec un téléphone portable (rires) où tu imaginais cette ville de Winnipeg repeinte avec des calligraphies arabes et une population également transformée ?
Oui, c’est exactement ça. L’idée contenue dans cet autoportrait est développée avec beaucoup plus d’ambition. Ça se déroule dans un Winnipeg qui est peut-être l’Iran, à moins que ce ne soit l’Iran qui soit Winnipeg… C’est un peu comme de tourner en nuit américaine, on n’en est pas sûrs ! C’est un peu un enchevêtrement identitaire.
Où est Maurice ? (2006) est par exemple en phase avec ce ton décalé, peut-être en plus décalé encore… Mais… pourquoi Jacques Chirac ? (rires)
Bonne question française ! C’est tout simplement une joke...
Est-ce que tu réalises sur Guy Maddin Barber gull rub (2008) autant en hommage que pour tuer le père ? (rire) Tu vas exacerber vos rapports en en faisant une passion homo-érotique. Est-ce un jeu entre vous ?
Ce film est surtout un hommage à Dave Barber, le programmateur de la Cinémathèque de Winnipeg décédé il y a quelques mois. Ce film a pour moi une signification toute à fait différente parce qu’il a un peu fait office de parents et a été très important dans ma vie. Je suis content que ce film existe. Mais c’est sûr qu’esthétiquement, c’est presque un pastiche de Guy Maddin. C’est niaiseux et c’est drôle… Mais c’est avant tout un témoignage de l’engagement artistique de Dave. Guy arrivait avec ce besoin artistique très bizarre et Dave Barber se trouvait là et a tout compris. Il se donnait physiquement (rire) aux besoins artistiques de Guy Maddin. Voilà le genre de personne que Dave était et ça, c’est précieux !
Mais chez toi, ce n’est pas une mouette morte mais des volatiles bien vivants qui reviennent assez souvent en stop motion. D’où vient cette fixation : du perroquet de Richard Condie, des oiseaux de Karel Zeman ? Des créatures de Willis O‘Brien ?
Je ne peux pas répondre à cette question, mais j’y ai pensé hier parce que dans ce film que je vais faire en perse, il y a une scène avec beaucoup de dindons dedans et même un défilé de dindons sauvages ! Et là, je me disais, à un moment, quelqu’un va me poser cette question : pourquoi y a-t-il autant d’oiseaux ? Il va falloir que j’y réfléchisse, ça sera peut-être un sujet de dissertation un jour pour quelqu’un. (rire)
 Hydro-Lévesque (2008)
Hydro-Lévesque (2008)
Dans Hydro-Lévesque (2008), il y a déjà cette obsession ou boutade ou tu aimerais que le Québec vienne sauver Winnipeg. La déclaration d’Hubert Aquin de 1962 que tu as mis en début de film est assez terrible… D’où vient ce rapport assez curieux entre le Québec et Winnipeg ?
Encore une fois, c’est cet enchevêtrement entre leurs deux situations existentielles qui avait animé ce projet. C’était quoi la citation déjà ? « On est tiraillés entre le désir de se suicider et celui de s’affirmer, de dormir ou de s’assumer ». C’est un regard très misérabiliste sur le Québec qui possède comme une espèce de double tendance. Il y a un Québec qui est vraiment électrifiant, qui s’assume et s’affirme. Le cinéma québécois en est un très bon exemple. C’est une des grandes cinématographies à l’échelle planétaire. Et pourtant, il y a aussi cet élément du Québec qui est très triste, mélancolique, avec une vision très négative de son passé, mais aussi de son avenir. Ça, c’est quelque chose qui m’intéressait beaucoup. C’est peut-être lié à notre époque, car nous vivons dans une époque anti-utopique où tous nos projets idéalistes nous semblent très naïfs et maintenant on voit l’avenir comme quelque chose de pire encore que ce qu’on est en train de vivre aujourd’hui ! Cet idéalisme, qu’est-ce qu’on en fait ? Reste-t-il un seul endroit pour y exprimer le désir d’un monde meilleur ? Donc je voulais passer tout ça à travers le prisme de Winnipeg. C’est un peu ironique car Winnipeg n’a jamais eu d’idéal, ni de projet de société au-delà d’un simple désir d’affirmation mainstream. Ce film est donc à la recherche d’une certaine expérience ironique. J’y suis suis vraiment dans les microbes, les particules subatomiques. Ça fait longtemps que je ne l’ai pas revu, je devrais... (rire)
Tu rends hommage à Levesque et à un moment tu cites Vigneault… Mais est-ce que ce traitement décalé a trouvé un écho chez les québécois ? Ont-ils apprécié l’hommage ou est-ce que la référence est déjà datée ?
Oui, parce qu’il s’agit d’une représentation bizarre d’un moment fort dans la mémoire des québécois. Je pense qu’à ce moment là, c’était une déclaration sur un projet qui n’était pas terminé, qui commençait même et de le faire vivre hydroélectriquement à travers Winnipeg rejoint un principe universel : cette énergie peut être contagieuse. Je pense que les spectateurs ont bien réagi à cette idée là.
On retrouve souvent à la musique ton complice Alek Rzeszowski, coréalisateur de Où est maurice ?, Vincent Biron ou Julien Fontaine à la photo. Même si tes univers changent, tes équipes restent sensiblement les mêmes…
Oui, c’est toujours mieux de faire des films avec tes amis. Ça devrait rester familial. Il faut vraiment que nos équipes soient des guerriers spirituels.
 Cattle Call (2008, coréalisateur : Mike Maryniuk)
Cattle Call (2008, coréalisateur : Mike Maryniuk)
Tu t’associes ensuite à un autre cinéaste alors débutant Mike Maryniuk qui a réalisé depuis une quarantaine de films dont récemment, le très beau Nuit de juin pour l’ONF. Il réalisera plus tard The yoddling farmer, qui reprend le thème de votre court survitaminé Cattle call (2008). Comment vous partagiez-vous le travail sachant que tu es crédité à la plupart des postes clé ?
De façon très simple. Parfois, les collaborations peuvent être difficiles, tendues, bizarres ou mal calibrées mais dans le cas de Cattle call, c’était parfait, tellement trop organique au point qu’on aurait dit que nos deux cerveaux ne formaient qu’un seul cerveau autonome. En fait, ni Mike ni moi n’aurions pu réaliser ce film seul, c’est la richesse de la chose. Ça serait super fun de faire un autre film avec Mike, ça me plairait beaucoup. C’est un grand cinéaste et son long-métrage, The goose (L’oie, 2018) est un chef-d’œuvre de cette esthétique de Winnipeg. C’est un grand collaborateur. Il y a quelques années, on a fait un film de commande pour les Parcs Nationaux et que les parcs ont judicieusement décidé de ne pas publier. (rire) En fait, Mike est un peu plus vieux que moi et c’est un autre cinéaste dont la démarche m’inspire beaucoup.
Vous y utilisez une grande variété de techniques d’avant-garde pour représenter la poésie du capitalisme dont parlait Herzog et que vous reprenez dans la présentation. Peux-tu revenir sur les aspects techniques et artistiques ?
Il y avait toutes sortes de choses : de la pixilation, du stop-motion, du grattage de pellicule. On l’a aussi perforée avec des perforateurs. J’ai également fait de l’animation avec du Letraset. Ce sont des feuilles transparentes avec des lettres en cire à l’intérieur. Tu peux les enlever et les décalcomanier sur une autre surface pour y coller la lettre. Non seulement des lettres, mais aussi des symboles ou toutes sortes de formes. On les a beaucoup utilisées. Il y a aussi un peu d’animation de lumière, une chose que j’allais reprendre plus tard, surtout avec Tesla. On a donc commencé des expériences avec tout ce matériel et c’est un film qui s’est fait spontanément. On n’a pas vraiment écrit de scénario. On a juste filmé toutes les idées qui ressemblaient à l’encanteur, un film à la manière de Norman McLaren, Len Lye, Evelyn Lambart, Oscar Fischinger… L’idée était de faire comme un film de musique visuelle (œuvres dont la composante visuelle fait usage du support filmique. L'appellation s'applique aussi aux méthodes ou appareils qui traduisent le son ou la musique en une représentation visuelle comme des films, vidéos ou en infographie, au moyen d'un instrument mécanique, l'interprétation d'un artiste, ou un ordinateur. Cela peut s'étendre à au transfert de la musique sur une peinture. ), un encanteur visuel qui incarnait véritablement la forme de l'encan, son langage.
Avec Tabula rasa (2011), tu bifurques vers quelque chose de plus onirique et figuratif, tout en traitant un drame historique. Tu composes un tableau avec cette fois des objets en trois dimensions et non des formes géométriques, sans perdre ce petit côté expressionniste qui revient souvent chez toi. Quelles difficultés techniques as-tu affronté avec l’élément aquatique ?
Je dis souvent à propos de ma démarche qu’à chaque film je veux relancer le Hindenburg avec la certitude qu’il va exploser à nouveau mais je le fais dans l’idée que le désastre va peut-être provoquer un nouvel âge d’or du voyage en zeppelin. (rire) J’aime faire des images difficiles à faire et ce film a été particulièrement compliqué à tourner. On avait construit en studio une immense piscine de 60 cm de profondeur, puis on a placé tous les objets dedans. C’était difficile à cause des moyens que j’avais, mais le plus dur c’était quand même la température de l’eau. C’était très désagréable pour les comédiens. J’ai travaillé deux fois avec de l’eau et à chaque fois on me jure que l’eau sera chaude, mais non, c’est toujours froid !
 Tabula rasa (2011)
Tabula rasa (2011)
Le fait divers résonne dans le contemporain du réchauffement climatique. Il n’est pas sûr que le Québec vous protège toujours comme tu le souhaites, ni même qu’il arrive à se protéger lui-même…
Effectivement. Mais ça c’est une blague pour les franco-manitobains... Jusqu’à très récemment, le lieu de la nation francophone en Amérique du Nord, ce n’était pas le Québec mais les canadiens français qui représentaient comme un archipel francophone d’est en ouest. Il y avait donc toutes sortes de communautés francophones. Par exemple, à côté de Winnipeg, il y a une ville principalement francophone qui s’appelle Saint Boniface. Il y avait des rapports historiques avec le Québec, mais à un moment le Québec a coupé ces liens car ils avaient décidé de se consacrer juste sur l’état du Québec plutôt que sur la nation canadienne française. On comprend pourquoi mais il y a toujours chez les franco-manitobains un sentiment d’abandon. Cette affiche fait surtout référence à cela.
Pour Mynarski chute mortelle (2014), tu retrouves ton complice Alek. La chute est l’occasion d’un fabuleux mélange entre abstraction et figuration. Le travail sur la pellicule est une vieille tradition québécoise qui se poursuit encore aujourd’hui avec Karl Lemieux...
Norman McLaren, Evelyn Lambart, Daïchi Saïto, Karl… Oui, c’est bien une grande tradition québécoise. Mais la plupart des films dont on parle sont avant tout des films formalistes où il n’y a pas vraiment d’histoire racontée. Avec Mynarski, l’expérience était de savoir jusqu’à quel point je pouvais utiliser le langage du cinéma d’avant garde et expérimental pour raconter une histoire et développer un personnage pour créer des émotions.
J’ai un peu l’impression que ta création réconcilierait deux pôles historiques de l’ONF : l’esprit de recherche et d’invention de McLaren et l’absurde et le sens du montage d’Arthur Lipsett.
Exact, et aussi la propagande (rire), car l’ONF a longtemps eu un département qui lui était dédiée.
 Mynarski chute mortelle (2014)
Mynarski chute mortelle (2014)
Est-il difficile d’embarquer un chef d’orchestre comme Walter Boudreau dans un univers comme le tien ? (il acquiesce en anglais) Quel contrôle exerce la production sur le film et sa fabrication ?
Les exploits radicaux de Walter Boudreau (2015) était vraiment un film de propagande puisque Walter allait être honoré du Prix du Gouverneur général, un des prix les plus prestigieux du Canada. Ils tournent donc un petit film pour chacun des lauréats. On m’a donc invité à le faire alors que j’étais déjà très fan du travail de Walter. Je ne le connaissais pas mais là aussi, ça a été une très belle collaboration. Il était juste tellement game qu’il voulait que ce soit aussi bizarre que possible comme il me l’a dit dès le premier jour. C’était d’autant plus facile qu’à l’ONF, ils veulent que le récipiendaire aime le film tourné sur lui. ls ont donc été satisfaits.
Il dit à un moment « on peut vivre en mangeant du mammouth ». On a l’impression d‘entendre un le chef Bartek de Propagande culinaire (2010-2012).
Tu es allé loin ! (rire)
Il y a une obsession ou un problème avec les végans au Manitoba ?
Oh non, ça c’est juste Bartek ! C’est une commande, ce n’est pas un film d’auteur, tout comme le film sur Walter. J’utilise mes outils pour leur rendre hommage. Dans le cas de Bartek, c’est surtout lui qui anime les choses.
Il y a quand même un style, percutant et hilarant. Mais le mix entre ton style et l’humour outrancier de Stanislaw Bartosz Homorowski va assez loin. Pourquoi ce projet n’a-t-il pas continué ?
Je n’en sais rien. On a juste fait autre chose… On avait dans l’idée de peut-être le proposer comme série. Mais on n’avait pas exploré la chose de façon sérieuse et ceux qui au Québec et au Canada financent ce genre de produits sont assez conventionnels. C’est peut-être différent aujourd’hui mais à l’époque, il fallait faire quelque chose de très normal et ça, ça ne nous intéressait pas !
Ceci est un message officiel (2015) est réalisé dans le cas d’une carte blanche du festival du Nouveau Cinéma. On y sent déjà poindre l’esthétique du Vingtième siècle et certains personnages comme Joseph Israel Tarte. Etais-tu déjà bien avancé dans la conception du projet ou son visuel ?
Non pas tellement, mais j’étais fasciné par le mouvement espérantiste. J’apprenais l’espéranto à cette époque et j’avais assisté au congrès des espérantistes à Québec et j’étais fasciné par leur iconographie. J’ai approfondi cela dans le film. Ce n’est que plus tard que j’ai décidé d’appliquer une iconographie espérantiste au personnage de Tarte pour ce film. Annie Saint-Pierre et moi avons décidé qu’il était comme une combinaison entre le fondateur de l’espéranto, Louis-Lazare Zamenhof et le Maharishi Maesh Yogi, fondateur de la méditation transcendantale. L’espéranto est comme un ectoplasme que j’invoque souvent...
 Propagande culinaire (2010-2012)
Propagande culinaire (2010-2012)
Auparavant, il y a un de tes courts les plus fulgurants : Tesla : lumière mondiale (2017). Si le fait historique de départ est intéressant, tu en fais quasiment un mélodrame. La bauté visuelle résulte de recherches particulières : light painting avec des cierges magiques, tremper la pellicule dans la javel. Peux-tu revenir sur ce scénario étonnant et sur la recherche créative et technique ?
Il n’y avait aucun scénario pour ce film. Il y avait un synopsis et à partir de là, j’ai commencé à dessiner. C’est d’ailleurs la première fois que je conçois un film comme cela, mais à partir de maintenant, j’aimerais faire tous mes films de cette façon. Je trouve qu’un story-board est un document beaucoup plus cinématographique qu’un scénario et dans le cas de Tesla, c’était même la seule manière de le faire. Écrire un scénario. c’était tellement trop visuel qu’il me fallait dessiner car si je l’avais décrit avec des mots, ç’aurait été trop inexact. J’ai donc fait un story-board. J’étais toujours inspiré par l’histoire de Tesla, son utopie et sa vision idéaliste de l’avenir, ce projet de rendre l’électricité gratuite et illimitée à travers le monde. Cela m’a vraiment fasciné mais je n’ai eu l’idée de faire le film qu’à partir de la découverte du light painting. C’était pour moi la façon d’incarner Tesla. Je crois vraiment que la forme doit incarner la fonction et faire avancer la situation et le personnage. Quand j’ai fait ce lien entre Tesla et l’animation de lumière, j’ai su alors que je pourrai faire un film sur lui. Car le matériel cru de ce film est la lumière. Le défi était donc surtout de trouver une forme qui pouvait incarner le sujet.
Enfin pour ton long-métrage Le vingtième siècle, tu rejoins ta passion de toujours l’histoire, une forme narrative farfelue avec quelques digressions dignes de La chambre interdite de Maddin et un traitement visuel qui peut évoquer certains de ses films les plus anciens, tout comme le Crimewave de Paizs. Je pense à cet aspect pastel, sépia de la couleur. Le traitement du décor, sa géométrie, sa stylisation évoque tes travaux de toujours. Là encore, es-tu parti du story-board ?
Pour ce film là, il y avait un scénario qu’à un moment j’ai lâché et c’est devenu une question de story-board. C’était très important pour ce film. Encore une fois, lire ce projet est un exercice un peu inutile de par sa nature visuelle. J’ai donc élaboré le story-board et ça a été beaucoup plus simple pour communiquer avec le directeur photo et le directeur artistique, et même aux comédiens et aux productrices, afin d’expliquer comment on allait le faire et à quoi ça ressemblerait au juste. Quant à l’inspiration de Guy, c’est toujours cette échelle épique pour micros-budgets.
 Tesla : Lumière mondiale (2017)
Tesla : Lumière mondiale (2017)
Pourrais-tu détailler un peu car on a vraiment du mal à voir ce que cela peut représenter ?
Je ne l’ai pas du tout produit et n’ai donc pas vu le budget, cela restait assez ambigu. Mais si je fais les calculs de ce que je sais, ça doit être autour d’un million ou un peu au-delà, 900 000 dollars en argent comptant et il y a eu des crédits d’impôts en plus. Ce n’est quand même pas énorme pour un film d’époque, surtout si je voulais qu’il soit aussi crédible, irrésistible et précis qu’un film de Spielberg par exemple. Là le budget serait terminé au bout d’un jour et demi ! Alors que si par contre j’embrassais le côté artificiel et que je travaillais dans une tradition beaucoup plus théâtrale, là je pouvais tourner tout le film ! Ça faisait partie de la décision mais pas seulement. Comme toujours, la forme incarne la fonction, l’histoire, le personnage. Tout tourne autour de cette mise en nationalité du Canada. L’histoire se déroule au tout début du projet canadien avec l’évolution de McKenzie King comme politicien et ce projet de nationalité. Je voulais que le spectateur soit en permanence confronté à l’artificialité de cette entreprise. On a toujours l’impression que l’univers naturel du film est architectural, qu’une structure s’impose sur la nature. Elle incarne la constatation anti-nationaliste du film et est à l’origine de l’idée.
Le scénario est inspiré par le journal intime de ce héros historique, William McKenzie King, qui fut 22 ans premier ministre au total, en insistant sur ses côtés troubles, ses pulsions et obsessions érotiques. Comme tu viens de l’Université, comment le film a-til été perçu du côté des historiens ou des politiciens ?
Les historiens sont perpétuellement pédants et c’est sans doute souhaitable, mais dans ce film, la démarche est différente que dans la plupart des films d’époque. L’idée est de réaliser un simulacre de la réalité et de le rendre si irrésistible qu’on le trouve totalement crédible et authentique. On oublie alors que c’est une construction et que tout y est artificiel. Car c’est ça que les historiens ont comme problème avec la majorité des films d’époque : c’est tellement convaincant et pourtant c’est faux ! Je me souviens que j’avais une professeure qui avait consacré un cours entier aux dents de Leonardo di Caprio dans Titanic parce qu’elle trouvait que ses dents étaient beaucoup trop belles pour un pauvre de cette époque. Il est impossible en 1912 qu’un travailleur ait de si belles dents. Peut-être que James Cameron était conscient de ça et qu’il s’est dit « Ok je suis conscient que les soins dentaires chez les ouvriers n’étaient pas pareils à ceux de nos jours, mais en même temps mon histoire d’amour ne va pas fonctionner si Leonardo a des dents pourries », alors il fait un choix, une transformation pour bien raconter son histoire plutôt que d’être un simple sténographe au service du passé. Parce qu’il s’agit d’une opération artistique, nous ne sommes ni des sténographes ni des comptables. Il y a toujours une reconstitution du passé même lorsqu’on le fait de manière académique et scientifique. Organiser un événement dans l’histoire au début, au milieu et à la fin, c’est aussi une transformation et elle n’a rien à voir avec le passé, c’est une structure que nous imposons sur l’histoire. Ce que je trouve génial d’un point de vue tellement trop académique dans le cas de mon film, c’est qu’il n’a pas du tout cette prétention. On sait très explicitement qu’il y a une fiction. L’opération est artistique, fictive et subjective. Le film ne cache pas son propos derrière une crédibilité. Le plus drôle, c’est que lorsque je présente le film, il y a toujours une personne pour demander « Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux ? ». Parce que si on sait qu’il y a quelque chose de faux, on sait aussi qu’il y a du vrai là-dedans. C’est flou. Pour moi, c’est une excellente tension pour le spectateur lorsqu’il regarde un film historique. D’un point de vue historique, académique et scientifique, je pense que c’est génial. C’est comme ça qu’on devrait présenter l’Histoire à l’image. C’est ça la mise en images du passé et on est d’autant plus ouverts que c’est une construction. Et pourtant, malgré tout ça, j’ai lu et recensé quelques historiens qui ont vu le film et en font encore juste la correction (rire), Chez les historiens, on est pédants pour toujours.
Il y a parfois chez toi un peu de cruauté, je pense à la petite tuberculeuse ou au regard sur le cynisme du héros et des politiques de l’époque, sur la situation sociale à l’époque. N’y a-t-il pas là une pointe de noirceur ?
(perturbé par la question) Est-ce que je suis cruel, c’est ça ? (rires) Et bien, c’est souvent la question avec le nationalisme : il y a toujours quelque chose de caché notamment dans la façons dont les nationalités se propagandisent. C’est toujours comme la crème glacée à la vanille. Tout est sucré, honest et sincère. Peut-être qu’on a des problèmes mais on a tout pouvoir pour les résoudre. Mais un autre côté coexiste toujours simultanément. Je pense à la critique de Many Farber où il divise la critique entre le cinéma d’éléphants blancs et le cinéma de termites. Le patriotisme de Spielberg appartient au cinéma d’éléphants blancs. On le regarde en étant conscients que ce n’est peut-être pas tout à fait la vérité, à moins que nous n’en soyons pas conscients. Mais dans les deux cas, c’est une image très honnête de la société alors qu’un film termite est plutôt un film comme Pink flamingos (John Waters, 1972). Les termites veulent manger les fioritures en bois dans l’édifice de la nation, exposer ce qui pourrit de l’intérieur. Ça, ça fait donc partie de ma démarche de tous les jours.
 Le vingtième siècle (2019)
Le vingtième siècle (2019)
Ton univers est aussi très symbolique et très sexué, je songe à une parenté avec les films du français Bertrand Mandico, quoique tu sois moins versé dans l’organique, (sauf dans l’irrésistible scène de la chasse au phoque et ses saillies gore), un cinéma à la fois très construit visuellement, transgenre…
Oui il y avait beaucoup de ça et c’est quelque chose qui est très remarqué dans le film. Je trouve ça super mais je n’avais pas vraiment pensé à ça en faisant mon casting. Je voulais simplement caster la bonne personne pour le rôle.
Comme par exemple Emmanuel Schwartz dans le rôle de la fille de Lord Muto…
Exactement. J’avais fait des auditions avec des femmes cisgenres qui étaient très bonnes mais Emmanuel était vraiment parfait pour ce rôle et pour l’idée d’un homme cisgenre qui en femme drague un homme, cette idée d’enchevêtrement identitaire me paraissait somptueuse. Mais ce n’était pas vraiment une décision très réfléchie, j’ai plutôt choisi la personne.
Les rapports entre anglophones et francophones sont exacerbés et la satire politique est présente. Suis-tu la vie politique canadienne ou te paraît-elle trop surréaliste pour que tu t’y intéresses vraiment?
Non, c’est quelque chose que je suis de près, mais je la vis autrement que la plupart des gens puisque je campe un peu entre les deux solitudes : je suis québécois mais j’ai aussi un accès au reste du Canada et vice versa, ce qui me donne un poste d’observateur un peu bizarre.
D’où vient l’idée des hommes éléphants boers ?
Je lisais beaucoup de propagande britannique anti-Boers dans les journaux du London Times et souvent la représentation des Boers dépassait les bornes : ils étaient l’incarnation du mal. La propagande est un langage que je trouve tellement délicieux ! L’idée était donc de la pousser à l’extrême, jusqu’à l’absurde.
« Passif-agressif » pourrait être perçu comme une définition du célèbre flegme britannique . Est-ce que tu te sentirais plus proche d’un Pierre Falardeau et d’un pamphlet comme Le temps des bouffons (1985)?
Falardeau est un grand polémiste et malgré tout, il y a beaucoup d’ironie dans son œuvre. Pourtant, je le trouve en même temps fondamentalement sincère et honest. Il y a une vérité absolue avec Falardeau et ça c’est quelque chose qui me rend toujours un peu mal à l’aise. Mais bien sûr, j’admire son œuvre. Le temps des bouffons est peut-être son film que je préfère et je pense qu’on retrouve un peu son fantôme dans Vingtième siècle.
Comment les institutions canadiennes qui financent tes films accueillent-elles des pensées ou des phrases comme « le Canada n’est qu’un orgasme raté après un autre » ? (rires) Reçois-tu parfois quelques piques ?
Non ! Et c’est sans doute ce qui donne la mesure d’une démocratie fonctionnelle. À moins que ce ne soient juste que des lecteurs pas assez attentifs, je l’ignore. Mais non je n’ai jamais reçu ce genre de réflexions. Le film est principalement financé par le Québec et ce genre de critique du Canada leur plaît beaucoup, ce qui est bien normal.
 Ceci est un message officiel (2015)
Ceci est un message officiel (2015)
Pourtant ton casting est mi-anglais, mi-français. La langue de travail est-elle alors l’anglais sur le plateau ?
Non, la langue parlée sur le plateau était le français. Je parlais souvent avec les comédiens en anglais s’ils étaient anglophones, mais avec le reste de l’équipe c’était en français.
Winnipeg est-il réellement le royaume de la permissivité comparé à un Québec plus harmonieux, plus sage et plus honest?
Tout au long du film, je joue un peu avec la mise en image du soi dans les différentes parties du Canada. Mais certains winnipegois ont vu une critique de Winnipeg là-dedans et au contraire, pour moi il s’agit d’une représentation très positive de Winnipeg. C’est extrêmement contre-culturel ! Voilà mon idée… C’est aussi crade et glauque mais ceci fait vraiment partie de sa mise en image et de la contre-culture. c’est quelque chose que l’on peut tracer à travers l’art à Winnipeg. Au Québec, c’est sûr que dans le débat autour des deux solitudes, il y a toujours une façon de représenter le Québec au Canada anglais, de le représenter comme un état un peu extrême, un peu intolérant, renfermé et je voulais donc en montrer l’anti-thèse, la meilleure expression de toute l’humanité ! (rire) Dans l’univers de ce film, le centre de tout le bien se trouve au Québec. C’est ma façon de me moquer des francophones au Canada anglais, quoique je me moque un tout petit peu des québécois parce qu’il y a aussi au Québec cette façon de se présenter comme le centre de tout ce qui est progressiste, tolérant, génial et généreux en Amérique du Nord, ce qui est vrai jusqu’à un certain point mais ce n’est quand même pas tout à fait ça !
Peux tu revenir sur ton film en cours et nous dire à quel stade de la création tu en es et si dans ce projet il y a des choses que tu n’avais jamais faites auparavant ?
Oui ! À chaque fois qu’on fait un film, pour le prochain, on est toujours en guerre contre nos derniers films. Ici, je fais vraiment table rase et c’est une toute autre démarche. Déjà, ça se tourne dans des lieux de tournages qui existent réellement dans le monde avec des non-comédiens et en persan, ce qui est une langue que je parle à peine et un tout autre langage cinématographique et ça m’inspire au plus au point. J’ai juste tellement hâte ! En parallèle, je fais un second film dans un autre ordre d’idée, parce que le congrès universel d’Espéranto aura lieu à Montréal l’année prochaine et je travaille donc sur un docu-fiction qui aura lieu pendant le congrès. Enfin un long-métrage en espéranto ! Je suis donc en période de renouvellement. Pour moi, Vingtième siècle a été un peu l’apothéose de ce que j’avais à dire en studio. Il y a bien d’autres projets que je voudrais faire qui jouent aussi sur l’artificialité, les utopies et il y aura forcément des liens avec toute ma pratique jusqu’à ce jour, mais je me prépare pour des changements formels majeurs et cela m’inspire beaucoup.
https://www.horschamp.qc.ca/spip.php?article854