Crédits images
Coop Vidéo Montréal
(hésitante) J’aime la nuit…
Tu vis en ville ?
Ouais ! C’est plus tranquille la nuit, Montréal…
Tu habites Montréal ?
Ouais mais j’aime pas ça Montréal. Je suis un peu coincée là. Je me suis achetée une forêt dans les Laurentides mais j’ai pas les moyens de m’y construire une maison, ce qui fait que je n’ai qu’une forêt vide (rire), enfin pleine d’arbres.
Même une maison en bois ?
Les municipalités ont beaucoup de normes. C’est une forêt vierge mais dans une municipalité où il y a d’autres maisons et même si mon terrain est immense, il y a quand même des lois à respecter. Je suis donc obligée d’attendre d’avoir les moyens pour faire bâtir. On n’a pas le droit non plus d’y faire des constructions temporaires.
Moi qui croyait qu’on pouvait vivre comme ça dans le bois…
Éventuellement si tu as la montagne pour toi tout seul mais moi j’ai acheté 6 âcres de forêt, c’est à dire l’équivalent de quatre terrains de football. La rue elle est bétonnée, il y a l’électricité, des voisins. Certes c’est un grand terrain sans constructions, mais si j’installe un truc temporaire, les gens autour vont s’en rendre compte et je vais être dénoncée. Je ne peux donc pas être une pirate et faire ce que je veux.
J’avais une vision plus idyllique, peut-être à cause du film Il pleuvait des oiseaux…
Non le Québec est plein de règlements, notamment dans les municipalités, on ne fait pas du tout ce qu’on veut. En général, on ne fait pas ce qu’on veut sur cette planète, on est comme sur un plateau géant de Monopoly.
Quelles sont les films ou objets audiovisuels, voire uniquement visuels qui t’ont marquée durant ton enfance ?
Il y a d’abord des films québécois bien sûr. Pendant l’enfance, j’ai été marquée par Elvis Gratton, par Opération beurre de pinottes, qui était un film pour tous, par toute la collection, La fête… Il y avait Les aventuriers du timbre perdu, il y en avait plein, toute une collection de films jeunesse. Il y a aussi Le magicien d’Oz, l’original. Celui là et c’est vrai je l’ai vu plus de cent fois. Quand j’étais jeune, il y a aussi Les filles de Caleb. C’est une série qui maintenant passe sur Netflix. Je l’ai vue plusieurs fois. Ben oui, Roy Dupuis les fesses à l’air !! D’ailleurs, la première fois que j’ai ressenti de l’excitation dans ma vie, c’est dans une scène avec Roy Dupuis, entre Ovila et Emilie. J’étais assise à côté de ma mère et j’étais très mal à l’aise. Sinon, un film qui m’a traumatisée et que j’ai vu très jeune c’est Arachnophobie, ou le premier Poltergeist. J’ai longtemps eu peur de me regarder dans un miroir parce que j’avais peur que l’homme au chapeau arrive. Et je prenais ma douche en mettant un bouchon dans le bain à cause d’Arachnophobie, et ça pendant des années. Voilà sans réfléchir trop les films qui m’ont marqué quand j’étais jeune.
J’avoue avoir reconnu à une filiation avec l’univers d’Elvis Gratton…
Pierre Falardeau est quelqu’un de très important dans ma vie. c’est un homme politique et un artiste, quelqu’un qui n’avait pas peur de donner son opinion. J’ai beaucoup d’admiration pour les gens qui ont ce courage. J’essaie d’en avoir aussi.
 Lawrence Côté-Collins reçoit le Prix du public du Meilleur long-métrage au festival Vues du Québec de Florac-Trois Rivières 2023. Photo Dominique Caron
Lawrence Côté-Collins reçoit le Prix du public du Meilleur long-métrage au festival Vues du Québec de Florac-Trois Rivières 2023. Photo Dominique Caron
Peux tu revenir sur tes premières tentatives avant d’arriver à Kino et quel était ton bagage technique à cette époque là?
Quand j’étais jeune, je voulais être actrice, j’ai fait beaucoup d’impro et au CEGEP je voulais étudier le théâtre. Mais quand j’y suis rentrée, je détestais la prof de théâtre. Alors j’ai changé de classe et je suis partie en Réalisation, Journalisme, Arts de la Communication, dans un profil qui s’appelait Sciences de la parole où on apprenait la phonétique, comment s’exprimer devant un public... j’y ai fini première dans tous les cours de réalisation télé, radio et dans mes cours de cinéma. Pour mon cours de réalisation télé, il fallait faire un reportage et le premier document que j’ai produit était un reportage sur le suicide dans le métro de Montréal. Ce que je vais te dire maintenant est lourd mais moi j’ai fait des tentatives de suicide quand j’étais adolescente. J’ai toujours été très en colère contre la société, j’en ai toujours voulu à mes parents de m’avoir mis au monde. C’est cette colère contre la société et la vie en général qui est devenue mon moteur. Adolescente, j’ai souvent pensé à passer sous le métro. Puis j’ai appris que c’était vraiment une mauvaise idée car tout le monde devenait quadraplégique. En fait, tu meurs pas ! (rires). Là je me suis dit « Mon Dieu, il faut informer les gens que ce n’est pas une bonne façon, tu déranges tout le monde et en plus tu te brises les membres . Non seulement tu ne meurs pas mais en plus après tu es handicapé ! » J’ai donc tourné un reportage de 5 minutes qui s’appelait Code 904, car c’est ce qu’ils disent à l’intercom quand le métro s’arrête parce que quelqu’un s’est jeté sous la rame. J’avais même rencontré le psychologue qui accompagne les opérateurs de métro traumatisés et c’est là que j’ai appris qu’il y avait un opérateur sur dix qui allait gagner à la loterie macabre et percuter quelqu’un dans sa carrière. Et tous ces conducteurs traumatisés d’avoir écrasé des gens finissent au téléphone pour répondre à la clientèle parce qu’ils ne sont plus capables de continuer. Voilà le premier document que j’ai produit et il a gagné un prix à l’école.
Ma professeure de réalisation m’a alors engagé comme stagiaire sur des productions vidéo. Dans ce cours au CEGEP, j’avais aussi rencontré un directeur photo venu pour nous enseigner la lumière, comment éclairer. Moi je me tenais sur le bout de ma chaise, je n’arrêtais pas de poser des questions. Cet homme était un grand ami de ma prof. J’avais 19 ans à l’époque et il lui avait dit « Cette petite fille là, elle est tellement allumée, elle en veut tellement, engage là car c’est sur qu’elle va rocker ses affaires ». J’ai fini le CEGEP et ce même été, elle m’a engagé. Je faisais signer des cessions de droits, je déplaçais les véhicules, je vidais les poubelles. J’ai vraiment commencé tout en bas ! Le directeur photo m’a alors pris sous son aile et a décidé de m’enseigner comment éclairer, me débrouiller avec la caméra, ou faire semblant d’avoir plus de compétences que je n’en avais. Il m’a appris à jouer la confiance. Il me disait « tu traînes ta caméra comme ça et tu fais semblant d’avoir confiance en toi ». Aujourd’hui, cet homme est mort. Il s’est suicidé. C’est une bien triste histoire mais il m’a enseigné quelque chose de très important. Dans la semaine où j’ai travaillé avec lui durant mon premier gros stage en sortant de l’école, on partageait un chalet dans les Laurentides. On avait fait un feu le soir et lui avait gagné à la loterie, au 6/49 où il avait gagné 4 millions. C’est comme ça qu’il avait créé sa propre compagnie d’éclairage et il m’avait dit « Quand tu deviens très riche du jour au lendemain, il n’y a plus rien de vrai autour de toi parce que tu ne sais plus si les gens t’aiment pour ce que tu es ou pour ton argent. Quand tu peux tout acheter, les choses n’ont plus de sens. Il y a plein de choses que je ne vais pas acheter ou que je ne vais pas faire, même si j’en ai les moyens parce que je suis en train de réaliser que tout ce qu’il me reste et le plus important dans la vie c’est rêver. » Quelques années plus tard, il s’est pendu dans sa grosse maison de son quartier riche montréalais parce qu’il avait perdu le sens de sa vie, qu’il était devenu trop riche et que ça avait ôté toute vérité autour de lui. Cet enseignement avait été un pivot narratif important dans ma vie, cet homme a été très important au début de ma carrière.
Durant cette semaine de stage, tout le monde trouvait que j’avais du cœur à l’ouvrage, que j’étais rapide, que je faisais bien les choses. Ils m’ont dit « Achète toi un téléphone portable, (on était en 2001 et je n’en avais pas) parce qu’on va t’envoyer les contrats qu’on refuse ». Trois semaines après, le téléphone sonne. C’était l’Hippodrome de Montréal, les courses de chevaux, qui n’existe plus aujourd’hui. J’ai été engagée par le département Audiovisuel de l’hippodrome. Durant mon entretien entre quatre murs, j’ai menti. J’ai dit que je savais tout faire, toute la régie technique, que j’avais appris ça mais ce n’était pas vrai. J’ai donc eu le job et à l’entrée, on m’a dispensé une formation de cinq heures. J’ai alors fait des dessins que j’ai numérotés « OK, ce curseur là, j’y touche en premier, celui-là en deuxième ». Je faisais le contrôle des iris, ça s’appelait le CCU. Je contrôlais tous les iris, les gains, les slow motions des huit caméras qui faisaient le direct pour rediffuser toutes les courses de chevaux rediffusées dans tous les hippodromes du Québec. Un poste de cameraman s’est alors libéré. Je suis allé voir les patrons et j’ai dit que je voulais le job. Ils m’ont dit que je ne savais pas faire ça. C’était l’époque des grosses Betacam avec de gros bacs en fonte très lourds, 65 livres (29kg5) avec de gros câbles, des Triax hyper pesants. Ils m’ont dit « Amuse toi avec les caméras, enregistre tes tests et viens nous montrer ce dont tu es capable. Si tu t’en sors on te donne le boulot ».
 Lawrence Côté-Collins dans Parce que cé la mode (2004) Capture d'écran
Lawrence Côté-Collins dans Parce que cé la mode (2004) Capture d'écran
L’hippodrome était déjà sur le déclin et plein d’étages étaient abandonnés. Je suis partie avec des ami.e.s dans les étages et j’ai commencé à m’amuser avec les caméras et des cassettes. J’avais vingt ans et j’ai commencé à tourner dans ces lieux abandonnés. Il fallait tout gérer et j’apprenais aussi les micros... Je faisais alors du faux reportage avec les chevaux, toutes sortes de choses. Je suis donc allée voir les patrons avec mes tests et ils m’ont trouvé tellement motivée. J’ai donc obtenu le travail. Ils m’ont donc transféré de la Régie aux caméras extérieures où je faisais le film d’arrivée au slow motion et le cercle des vainqueurs caméra à l’épaule. Je maniais donc deux caméras durant le programme de courses. J’ai fait ça pendant quatre ans mais c’était très payant. J’étais aussi la première femme camerawoman de l’Hippodrome de Montréal, et la dernière puisque ça a fini par fermer et ça a été démoli aujourd’hui. C’est donc comme ça que j’ai commencé et puis j’ai fait mes premiers films avec Denis, le directeur photo dont j’ai parlé et qui est décédé. Mes premiers films ont donc été tournés avec la gang de l’Hippodrome et Denis qui me prêtait son matériel et venait sur mes tournages pour m’enseigner l’éclairage. J’ai donc fait deux films avec cette équipe. Très vite, il y a eu une grande grève au Québec, chez Vidéotron qui est le réseau de distribution. Certains grévistes en avait marre d’être dans la rue et sont donc venus travailler à l’Hippodrome. Quand la grève s’est finie, certains disaient « Tu es bien trop cool, il faut que tu viennes avec nous à la télévision ».
Ils sont retournés travailler et mon téléphone a sonné pour un entretien avec ce qui s’appelait à l’époque Canal Vox, une chaîne câblée. J’ai eu le boulot et suis vite devenue employée puis syndiquée. Mes patrons me laissaient m’amuser dans les studios tous les week-ends. J’ai donc fait mes premiers films en studio et en multi-caméras et je les aiguillais en Régie, c’était un peu comme du tourné-monté. J’avais donc mes acteurs et j’aiguillais mes films. Je ne connaissais pas Kino mais j’en étais à quatre ou cinq courts. Je faisais du faux documentaire. Un cameraman de la chaîne, Martin, est venu me voir « Ce que tu fais me fait penser à du Robert Morin ». Moi je ne connaissais pas, je ne suis pas une intellectuelle. Ma scolarité a été courte car je n’ai pas été à l’Université. J’étais trop pauvre et je ne voulais pas m’endetter parce que je voulais vraiment vivre de l’art et de la création. Je me disais que si j’avais plein de dettes, je serais obligée de faire un métier que je n’aime pas pour les rembourser. j’ai donc juste fini mon CEGEP, ce n’est pas grand-chose. A l’époque, il y avait encore des vidéo-clubs. Je me suis retrouvée dans celui de mon quartier. C’était classé par section et j’ai fini par trouver le rayon Robert Morin. J’ai tout loué et je me suis tapée toute sa filmographie en une semaine. Le premier que j’ai vu c’est Quiconque meurt meurt à douleur et c’est un film très important dans ma vie. C’était la première fois que je m’identifiais à quelqu’un et que je me disais « Ah ouais OK, il y a des gens qui font ça dans la vie ! » Enfin quelqu’un dans mon équipe ! Je n’ai pas imité Robert, je l’ai découvert.
À cette époque au Québec on avait le journal culturel Voir. L’équipe de la télé m’a dit qu’il y avait une gang appelé Kino qui faisaient des films. Moi je faisais des films mais je ne les projetais nulle part. « Tu devrais aller faire un tour à Kino ! ». J’y suis allée et durant un an j’ai assisté à tous les vendredis une fois par mois. Assise, je ne parlais à personne, tranquille, j’écoutais et je regardais ce qui se faisait. En 2004, j’ai réalisé mon premier film sélectionné en festival. Il s’appelait Parce que cé la mode et c’était un faux documentaire sur la génération g-strings et l’hypersexualisation des petites filles et je me suis retrouvée à l’édition n°1 du Documenteur en Abitibi. C’est là que je suis tombée en amour avec le genre, que j’avais déjà compris que c’était un genre et que je pouvais plonger là dedans. Dès 2004, je me suis fait plein d’amis en Abitibi et après ça je voulais toujours y retourner. Je me suis dit qu’il fallait que je fasse un faux documentaire chaque année et que je m’assure d’être sélectionnée, comme ça je suis sûre d’y faire un voyage par an ! Je suis donc allée à toutes les éditions du Documenteur à partir de 2004 jusqu’à ce que ça crève parce que le festival a changé d’équipe et depuis il est mort. Voilà, c’est ça mon parcours.

Billy Poulin dans Pas de pain pas de gain (2009) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Aujourd’hui, tout le monde a oublié que Stéphane Lafleur est passé par Kino…
Phlippe Falardeau aussi !
Oui mais ça n’apparaît pas forcément dans leur filmographie et ça ne résonne plus forcément avec leur travail, quoique Stéphane Lafleur garde un côté bricolage dans son principe de création. Ce que je dis n’est pas exact… Tu es une des rares cinéastes aujourd’hui en activité à y avoir officié aussi longtemps, ce qui veut dire que tu t’y es plu et que tu y as trouvé matière à y faire plein de choses. Qu’est-ce qui explique ça ? Le plaisir ? La stimulation ? Le côté collaboratif ? La difficulté à financer des projets plus classiques ?
J’ai toujours eu le rêve de faire des grands films mais tu sais, c’est dur de faire des bons films ! J’ai toujours voulu explorer mais en ayant le droit de me casser la gueule. Avoir le droit de me planter, de me tromper. Pour moi Kino, c’était comme une bande de musiciens, comme faire de la musique au sein d’un groupe dans un garage. C’est comme des jam de musique mais au lieu d’être de la musique ce sont des jam de films, mais au lieu de faire des chansons et de crier dans un micro, on était un groupe de gens et on faisait de la création ensemble.Plusieurs facteurs ont fait que j’ai vraiment accroché à Kino : premièrement, je suis vraiment une junkie de l’adrénaline. D’ailleurs les urgentologues dans les hôpitaux sont des gens accro à l’adrénaline. J’ai compris ça en regardant le documentaire sur les urgentologues. Moi quand j’ai un gun sur la tempe et que c’est « maintenant » qu’il faut que ça sorte, la pression me donne des ailes. La longueur et le temps me rendent lourde, amorphe. Plus il y a de contraintes, plus c’est un tremplin à ma créativité. J’ai toujours fait de la télévision. Je ne suis pas une puriste et je n’aime pas les puristes qui font (elle beugle) « Aah le cinéma ! Beurk, la télé ! » Je suis une enfant de la télé, j’ai passé toute ma vie devant car je suis une enfant unique avec des parents divorcés. C’est la télé qui m’a éduquée, qui m’a gardée, c’est la télé qui s’est occupée de moi. Mes parents ne sont pas des mauvaises personnes juste des gens qui travaillaient dur, ils n’avaient pas le temps. La télé a été ma meilleure amie, ce qui fait que le jour où j’ai commencé à travailler pour la télévision, j’ai eu l’impression de réussir ma vie. Carrément. Parce que je rentrais dans la télé, je me disais « Waouh la télé c’est ma meilleure amie et maintenant je fais équipe avec elle ». J’ai toujours aimé faire de la télé et j’aime encore ça aujourd’hui. Gagner sa vie au cinéma, c’est aussi très rare, que par l’art et le cinéma. Et puis moi j’ai toujours travaillé.
Pour moi, Kino, c’était comme de jouer au hockey ou de faire du tennis ou du golf, c’était mon hobby et ma passion. Donc je travaillais à la télé et dès que j’en avais le temps, je fabriquais des films. Pour moi, faire un film est comme une purge. Un véhicule, il faut lui changer son huile, nettoyer le moteur. Quand j’ai des idées, si je ne les évacue pas de mon corps, ça me congestionne. Or Kino me permettait d’aller au bout de toutes mes niaiseries. Toutes mes idées. Publiquement, ça représente une quarantaine de courts-métrages, mais c’est bien plus que ça. J’ai aussi fait la caméra pour plein de gens, joué dans des films. Au total, j’ai participé à plus de 100 kinos. Mais dans ceux que j’ai signés, une quinzaine ont fait leur vie en festivals. Je suis vraiment une artiste, je ne dis pas ça avec prétention parce que je pense qu’être artiste c’est un peu une maladie. Je m’explique : si je ne crée pas, je crève. J’ai découvert que le sens de ma vie et ma propre survie passaient par la créativité, en exprimant ce que je pense du monde dans le quel je vis, mon regard cynique sur le monde. La création est donc devenu un remède pour moi et une nécessité viscérale. J’ai aussi une facilité à aller vers les gens et le cinéma est justement un art de groupe. Par contre, moi je suis toute ou rien, soit sauvage, soit en grosse gang. J’aime le travail d’équipe et quand je fais de la télévision, je suis un excellent soldat et si je fais des films, je suis un bon capitaine. À la télévision, je suis au service de la machine et au cinéma, c’est la machine qui est à mon service. (elle s’esclaffe) J’ai besoin des deux dans ma vie parce que les réalisateurs qui font juste du cinéma, ils vont tourner une fois en quatre ans. Parce que j’ai fait de la téléréalité et beaucoup d’émissions, 250 demi-heures en dix ans, c’est énorme. Donc je suis vraiment quelqu’un qui tourne beaucoup donc les moments où je me sens le mieux dans ma vie, c’est en tournage. Là je me sens bien et n’ai pas de tracas personnels. Kino a été ma source de vie (éclat de rire) et aujourd’hui, beaucoup de mes collaborateurs et de mes grands ami.e.s sont tous des kinoïtes. On s’est construits ensemble dans la créativité, l’humour, le partage et l’échange. Les gens les plus importants de ma vie, ce sont ceux de Kino. Je n’ai pas honte d’en parler ni de le mettre en avant parce que j’ai fait partie des pionniers de Kino qui se sont tracés une route dans les festivals, Regard sur le court-métrage entre autres. J’ai gagné deux fois à Tourner à tout prix, avec Crudités (2009) et Fuck that (2010). Les journalistes me disaient toujours « À quand un vrai film ? » Moi j’ai toujours été frustrée car ce n’est pas parce que je n’ai pas d’argent. C’est comme s’il fallait de l’argent pour confirmer qu’on est en train de faire quelque chose. Je n’aime pas beaucoup l’élitisme. Je viens de la classe ouvrière pauvre du milieu de la ligue de garage et je pense qu’il n’est pas obligatoire d’avoir de l’argent pour faire des choses je pense qu’il faut du courage, du désir, de la motivation et puis du travail.

Crudités (2009) de Lawrence Côté-Collins -Capture d'écran
Tu l’as dit, il est difficile d’établir ta filmographie. On peut quand même tenter de les classer dans quelques catégories. Hors les spots promotionnels et les films d’ateliers avec les enfants (Soliloques)…
J’ai en effet fait de la formation avec les jeunes pendant 12 ans. Ce n’est pas dans ma filmographie parce que c’est juste du travail, j’étais payée pour le faire. C’est juste que mon travail finit par être sur internet parce que les jeunes publient leurs œuvres. J’ai fait du Wapikoni mobile, toutes sortes de trucs. Mais quand mon nom est dessus, ce n’est pas quelque chose que je signe, mais un travail auquel j’ai collaboré, pour enseigner.
Tu as fait quelques tentatives dans le drame avec Jessica notamment...
Ça fait longtemps qu’on ne m’a pas parlé de Jess’. C’est drôle parce que c’est la seule fois de ma vie où j’ai pris l’histoire de quelqu’un d’autre. Alexandre L’Heureux, un comédien qui a joué dans presque tous mes films -c’est celui qui arrête Guillaume à la fin, dans Bungalow c’est l’homme à la moustache. Alexandre a même joué dans mon premier film en VHS, celui là même où Denis m’avait aidé. Il m’a aussi donné la réplique lorsque j’essayais de rentrer dans les écoles de théâtre. Et c'est lui qui prête sa voix dans mon prochain film documentaire Billy qui sort en 2024 ! Bref, c’est comme mon « ami comédien » qui me suit depuis mes débuts. En fait, c’est lui qui a écrit Jessica. C’est quelque chose qu’il avait écrit pour son exercice final de théâtre quand il étudiait. J’étais allée le voir sur scène dans toutes ses pièces. Alexandre et Guillaume Cyr étaient dans la même année, je les ai donc vu grandir en même temps. C’est pour ça que c’est chouette que ce soit Alexandre qui l’arrête à la fin parce que dans notre amitié, ça fait si longtemps qu’on se suit. Jessica est donc mon seul film qui soit une adaptation de quelqu’un d’autre, j’ai pris le scénario d’Alex et je l’ai porté à l’écran.
Je n’aurais pas deviné que ce film ci était écrit par un homme.
Oui, c’est un homme gay, ça joue peut-être…
Tu as justement beaucoup donné dans la poésie Queer. Par exemple, un film comme Ode…
Aujourd’hui, parler de notre orientation sexuelle est à la mode. Maintenant c’est dans ma bio mais moi, depuis que je suis ado, j’aime les hommes et j’aime les femmes. Mes premières expériences dans la vie pour embrasser, c’était avec des filles et j’ai toujours aimé les filles, mais j’ai toujours aimé les garçons aussi. On dit queer parce que c’est un mot valise, c’est plus chic que de dire LGBT+ ou bisexuelle, c’est plus propre. Mais j’ai toujours été Bi et jusqu’à tout récemment, on te traitait de salope, de charrue, de personne qui veut coucher avec tout le monde. C’est quelque chose qui m’a beaucoup isolé dans ma vie parce que les gens croient que j’ai le goût de coucher avec tout le monde et ça m’ennuie. C’est pas vrai. De même que je n’ai pas envie de coucher avec tous les garçons que je rencontre, et bien c’est la même chose pour les filles, je ne suis pas forcément attirée par tout le monde. Quand je suis avec des femmes lesbiennes, je ressens de la discrimination parce que je ne suis pas lesbienne. Je suis comme une traître, aussi j’ai connu l’isolement dans le milieu lesbien. Côté hétéro, je me suis fait traiter de « charrue » (femme aux mœurs légères). Et puis les mecs pensent toujours qu’ils peuvent se faire des trips à trois et j’ai l’air d’être un super plan cul (rire) donc ça m’a ennuyé toute ma vie. Je pense même que ça a participé, à mon désir de mourir, je le dis en toute transparence parce que je n’ai pas honte de parler de ça maintenant. Dans l’optique de ce besoin de me purger de ce qui m’habite, la présence de l’amour féminin transparaît dans mon cinéma parce que j’ai besoin d’exprimer ce qui m’habite. C’est très récent que dans la communauté LGBT+, on mette ça en avant.

Ode (2008) de Lawrence Côté-Collins-Capture d'écran
Vu d’ici, on a pourtant l’impression que cette thématique arrive plutôt dans le cinéma québécois et on croit que la tolérance est nettement plus forte que chez nous.
Je ne sais pas car moi, j’ai vécu beaucoup beaucoup de discrimination, de stigmatisation. Quand j’avais 21 ans, en 2003, j’étais dans un taxi en banlieue de Montréal avec ma copine de l’époque et quand il a compris qu'on était un couple, le chauffeur nous a jeté hors de son taxi. Ma mère est décédée aujourd’hui mais elle est toujours allée dans les défilés gays, avait plein d’amis gays. Mais lorsque je lui ai annoncé que j’avais une copine, elle s’est effondrée. « Si tu m’avais dit que tu avais épousé un détenu, j’aurais moins de peine. Tu le fais exprès, pour te rendre la vie difficile ». Donc quand j’ai eu le courage de dire que je sortais avec une femme, ça m’a éloigné de ma mère. Je viens vraiment d’une banlieue ordinaire, de la classe moyenne pauvre. Quand je suis sortie avec un noir, ma famille m’a tassé, idem quand je suis sortie avec des femmes. Tasser c’est comme juger… (elle cherche ses mots) C’est drôle parce que mon seul court-métrage aidé financièrement, Score. J’étais en festival en 2009, je buvais une bière avec un directeur de festival que je ne nommerais pas... Or j’avais osé parler de ma bissexualité et ça avait créé une dispute à la table. On avait dit que j’essayais de me rendre intéressante. En fait, ça m’a nui jusqu’à tout récemment. Ça ne fait pas si longtemps que c’est un plus dans ma vie et que maintenant il faut que je le dise et que je coche des cases : vous êtes une femme, et j’ai aussi un diagnostic de neurodiversité, un TDAH. Je suis hyperactive et j’ai un problème avec l’autorité. Ça a été un diagnostic très tardif mais le TDAH, maintenant ça rentre aussi dans les handicaps dans les formulaires de financement. Je coche donc « femme », « neurodiversité/handicap » et « LGBTQ+ » et là, tout ce qui m’a nui toute ma vie est d’un seul coup devenu un plus pour obtenir des financements ! Aujourd’hui, on en est là dans la société et j’en parle super ouvertement. C’est sorti dans les journaux avec Bungalow : « Mais pourquoi flasher (rendre voyante) votre diversité ? ». Ben parce que ce qui m’a tant desservi, aujourd’hui on me donne de l’argent si j’en parle ! C’est bien la première fois de ma vie que ça me sert. J’ai des amis noirs qui disent « Tu ne peux pas comprendre le racisme quand tu n’es pas noir car ta vie est vraiment différente quand tu es noir». Tu ne peux pas savoir ce que c’est tant que tu n’en fais pas l’expérience. Mais quand on fait partie de la communauté LGBT+, on fait vraiment l’expérience de la stigmatisation, elle est vraiment réelle. Et on pense que le milieu des artistes est très ouvert mais pas tant que ça. C’est surprenant.
Pourtant, j’ai vu finalement pas mal de films québécois qui l’évoquent.
C’est drôle parce que je l’ai cherchée la diversité dans le cinéma québécois et moi je ne l’ai pas beaucoup vue. Il y avait un film de bicyclette à un moment… 2 secondes (1998).
C’est vrai que ça peut aussi être péjoratif comme dans Being at home with Claude (Seul avec Claude, Jean Beaudin, 1993) qui date du début des années 90...
Oui, ou bien J’en suis ! (Claude Fournier, 1997). Et là ça devient super réducteur.
J’en suis ! c’est de la parodie, c’est un peu l’équivalent de La cage aux folles chez nous.
C’est comme quand on fait des films sur les communautés et qu’on prend des gros clichés et qu'on les ridiculise. Je hais les artistes ou les réalisateurs qui mettent en scène des choses qu’ils ne connaissent pas. Si tu ne connais pas, ferme ta gueule ! Fais des sujets que tu connais. Pose un regard. Pour Bungalow, des journalistes me disaient « Pourquoi prendre des gens de cette classe ? -Pauvres ? Oui, pourquoi, parler de ces gens là ? Et bien parce que c’est moi, j’ai grandi comme ça, parce que je suis encore pauvre. » Ça fait seulement un an et demi que je fais du documentaire. J’ai le même salaire que quand j’étais au CEGEP. Je l’ai vécu très récemment avec des journalistes qui posaient ce regard là sur la pauvreté. Voyons tabarnak, dans la vie c’est la majorité des gens qui sont pauvres ! Ça m’a surprise de constater la condescendance élitiste des journalistes, pas tous mais de quelques uns qui m’ont choquée. Si dans Bungalow, je considère que j’ai un regard juste sur mes personnages, c’est parce que ça émerge de ma vie, de ma réalité, du quartier où j’ai grandi. Oui, je suis en tabarnak contre tout ! (éclate de rire)
 Chimère de Lawrence-Côté-Collins (2007) Capture d'écran
Chimère de Lawrence-Côté-Collins (2007) Capture d'écran
Tu as aussi donné dans l’expérimental poétique avec Chimère (2007).
D’ailleurs Chimère j’ai le personnage tatoué dans le dos ! (elle se lève et remonte son tee-shirt pour me montrer)
OK !
C’est mon premier film qui a circulé dans les vidéo-clubs, sur la compilation Best of Kino. C’est aussi le premier film que j’ai tourné à avoir gagné des prix. Hey, j’ai gagné 1000 dollars avec ce film alors qu’il m’en a coûté… 58 ! ça m’a payé deux loyers. Lors des seules entrevues que j’ai sur ce prix avec Chimère, je leur au dit que j’étais contente parce que j’allais pouvoir payer mes courses et mon loyer ! (rires) Pour Chimère, c’est de la pixilation, c’est à dire de l’animation en stop motion avec des humains. Ça a commencé à l’ONF avec Norman McLaren qui avait fait Voisins. Je venais de le découvrir au moment où j’ai tourné ce film. Waouh ! J’ai fait ça avec un garçon avec qui je sortais à l’époque, en 2006, il y a un bon bout de temps. La pixilation est aussi la technique que j’ai le plus enseignée aux enfants. C’est tellement facile avec eux parce que ce sont des photos. Donc ce n’est pas grave s’ils sont turbulents. Le montage est rapide donc c’est parfait pour les ateliers.
J’ai l’impression que tes films sont influencés par les lieux où tu les fais comme ceux en Belgique ou Crudités tourné en France, à Trouville.
Crudités, c’était ma lettre d’amour à Bertrand Blier. La découverte de Bertrand Blier (soupir), c’est un peu comme pour Robert Morin…
C’est quand même très différent. Blier c’est très écrit.
Oui ! Le premier film de lui que j’ai vu, c’était Buffet froid. Hooo ! (elle crie) Il fait partie de mon top 10 de mes films préférés au monde ! Je trouve ça tellement intelligent. Je suis une grande amoureuse des cerveaux. Dans la vie, je tombe en amour avec des cerveaux. J’aime beaucoup les gens spéciaux, en marge. Plus les gens sont fous, plus je les aime, c’est d’ailleurs un grave problème dans ma vie. J’ai eu beaucoup de problèmes avec les fous, j’en ai encore aujourd’hui. Mais là, le talent de Blier me scie les deux jambes ! Crudités est donc un hommage, c’était ma façon de lui dire que je l’aimais. J’ai contacté son agent et je lui en ai envoyé une copie avec une lettre d’amour. J’avais écrit « Si jamais vous me répondez, je vais me payer un billet d’avion, juste pour boire un café avec vous. » Et puis il ne m’a jamais répondu (déçue) mais j’ai envoyé le film à son agent, je ne sais pas s’il l’a vu. Je disais tantôt que les contraintes sont un tremplin pour ma créativité ou les choses qui arrivent… Pour Crudités, au lancement du cabaret, il y avait là une fille qui a dit « Bonjour ! Moi je fais de la pyrotechnie au cinéma, j’ai trois bombes pour le cabaret. » « Ah ben moi, je vais t’en prendre une ! » (rire) Je ne savais pas ce que j’allais faire avec mais j’étais tellement énervée d’avoir une vraie bombe. Quant à la fille qui se mange un coup de poing, c’est une cascadeuse. Les choses se sont donc faites comme ça, tout simplement… Et quand j’ai vu la plage, comme toutes les personnes qui vont à Trouville, j’ai dit « Waah, je veux tourner sur la plage ». Quand la bombe explose, personne ne se retourne car au cinéma, ça ne fait pas de bruit une bombe qui explose, on le rajoute en postprod. Donc chacun fait sa vie…
Le film est à la fois décalé et violent, notamment la fin.
Mais tous mes films sont violents ! Enfin presque… il y a de la violence dans mon cinéma.
Ici elle est peut-être un peu malaisante parce que la chute est… sèche !
Ouais.
C’est une manière très frontale d’aborder les violences faites aux femmes.
La violence, on la tolère beaucoup avec la guerre, elle y est vue comme normale. Par contre, à l’extérieur, on la criminalise énormément. Les troubles de santé mentale viennent avec la violence, mais aussi les troubles de consommation, la passion donc la violence est une chose qui nous entoure constamment. Et il y en a eu beaucoup dans ma vie (silence).
On a eu diffusé Les valseuses de Bertrand Blier à Florac et une fille d’environ vingt ans avait trouvé le film trop sexiste, misogyne et même insupportable.
Mais Bertrand est un misogyne ! Je n'aurais pas été surprise qu'il soit cité dans la vague Me too ! Depardieu en fait partie. Parce que c’est nouveau de parler de tout ça, des abus sur les femmes. J’en parle dans le documentaire Billy que je vais sortir l’année prochaine. J’ai vraiment vécu plusieurs agressions sexuelles. Mes amies ont presque toutes subi des agressions. Et quand on regarde les films qu’on regardait adolescents, comme American pie où le but du film est de fourrer des tartes pour saouler des filles au bal de fin d’années pour les baiser ! Dans ce cinéma d’exploitation que j’ai consommé toute ma vie, il y a toujours une paire de seins et plein de blagues cochonnes dans les dix premières minutes. Même si on ne s’en rend pas compte, on s’est collectivement construits dans l’abus sexuel fait aux femmes. Ça fait partie de notre culture et pour beaucoup, par le cinéma. Ma mère, mes tantes, toutes ont été abusées par des oncles. L’abus sexuel fait partie des racines de nos familles, la pédophilie est partout. Tout ça sont des tabous alors que ce sont des choses tellement présentes. C’est nouveau d’en parler aujourd’hui. La seule fois où j’ai porté plainte contre un agresseur en 2007, c’est lui qui m’a traînée au tribunal pour diffamation et atteinte à sa réputation, à la suite de quoi je n’ai pas pu travailler pendant un an.J’avais l’aide juridique car sinon tout mon salaire serait passé dans l’avocat. Cet homme pervers qui m’a agressé m’a donc causé des problèmes durant un an et m’a poursuivi pour avoir porté plainte. C’est lourd… Ça fait partie de notre culture mais on ne s’en rend pas compte. C’est vraiment présent.
Chez Blier, il y a une misogynie de façade, très provocante et à côté de ça, de très beaux personnages féminins. Donc la question du point de vue et de ce que l’auteur montre se pose. Ne s’agit-il pas justement d’une violence culturelle et liée à son époque ? On dirait qu’il y a les deux. Calmos pousse loin et au premier degré la provocation anti MLF alors que dans Les valseuses, on trouve aussi le personnage interprété par Jeanne Moreau…
La sexualité, c’est animal, instinctif. C’est pire quand on consomme de l’alcool. Il est connu que Depardieu a des problèmes de boisson. Mais en fait, n’importe quel gars qui boit plus de trois bières a envie de fourrer tout ce qui bouge ! (rire gêné) Non, mais c’est ça la vérité ! C’est pas parce qu’on agresse les femmes qu’on ne les aime pas. On peut aimer les femmes et vouloir en prendre soin mais les agresser quand même. Si ! C’est comme des parents qui battent leurs enfants. Ils vont les aimer leurs enfants, mais s’ils sont à bout, ils les battent quand même. Moi je crois que les deux sont possibles, ensemble, être misogyne et aimer les femmes. On peut avoir des doubles standards. De toutes façons, tout le monde est un peu paradoxal. La frontière est mince entre la haine et l’amour, ça se touche. Aussi la misogynie et la passion des femmes sont très proches.

Jessica (2009) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Chez Sacha Guitry aussi par exemple… Quand tu tournes Ode en Belgique, tu es sensible à cet environnement et on retrouve dans le visuel quelque chose de la culture européenne…
Ben il y avait un château, c’était donc facile de faire des princesses.
Mais ce n’est pas que ça, il est aussi plus littéraire, le ton est différent.
C’est sûr. Quand j’arrive quelque part, ma boîte à outils, ce sont les gens sur place. Quels sont mes outils, mes acteurs, mes lieux ou mes costumes ? Moi je suis toujours la même personne. Si moi je suis un marteau, quand je me déplace, la scie, le tournevis et les autres ne sont pas les mêmes. Même les prises électriques ne sont pas les mêmes en France qu’au Québec, donc ma boîte à outils se transforme. Je fais aussi avec les ingrédients qu’on me donne. Quand je vais faire les courses au Carrefour, je n’achète pas les mêmes choses que chez moi. La première chose que j’ai faite en arrivant ici, c’est de m’acheter des lardons (rires). Et oui on n’a pas ça à l’épicerie au Québec ! Ces petits cubes qui sont ici très ordinaires, un classique. Je fais donc la recette avec les ingrédients c’est aussi simple que ça. Et ça finit par se voir à l’écran.
Plusieurs films sont signés collectivement. C’est le cas de Soliloques…
Ça c’est un film d’atelier et j’ai été payée pour le faire. Ce sont des jeunes à qui j’enseignais le cinéma expérimental sur un week-end, ce n’est pas de moi, c’est juste un film de formateur.
Un film comme Jessica démontre ta grande maîtrise à travailler avec des comédiennes. Le scénario était-il très écrit et comment préparais-tu le tournage ? Comment travailles-tu en général avec les comédiens?
As-tu vu aussi Écartée ?
Oui… et aussi le making of. (rire) J’ai été très étonné par l’attitude du comédien, beaucoup sur la défensive.
Mais oui, mais lui c’est un vrai détenu, il a vraiment fait 25 ans de taule !
Ah bon ?
Tout ce qu’il dit dans le film est vrai à 100 %, quand ça parle de sa vie en prison.
Je ne savais pas ça.
Oui, c’est juste la vérité entourée de bullshit !
Ça change tout.
Ben oui, quand il raconte son histoire, c’est sa vraie vie, j’ai juste changé son nom. Je lui ai dit tu vas croire en Métatron, tu vas faire des casse-tête 3D et tu habites ici. Mais quand il, parlait, il disait son vrai nom « Moi Ronald... » « Non, tu t’appelles Scott ! » Mais il n’a jamais été capable de dire « Moi Scott ! » donc j’ai du couper tous les « Moi Ronald ». Lorsqu’il montre des photos, ce sont ses vraies photos de prison. Quand il raconte ses vols de voitures, c’est vraiment sa vie. Pour en revenir aux comédiens, quand j’ai le choix de mes acteurs et qu’ils sont disponibles, j’essaie d’aller chercher des gens sur lesquels je vais pouvoir travailler avec leur essence. Purs… Je n’aime pas faire du « off casting », j’aime travailler avec la vérité des gens. Je vais chercher ce qu’ils ont de plus vrai. Je dirige donc vraiment beaucoup les acteurs. Je les regarde comme un instrument. Je suis très sensible à leur jeu. Mes meilleurs films sont donc ceux où j’ai le mieux accordé, ajusté mes acteurs. Quand je suis à la réalisation, mais que je ne fais pas la caméra en même temps, il m’arrive même de fermer les yeux pour écouter la musicalité des voix. « Ah, ce mot là ne sonne pas bien ! L’accent tonique n’est pas à la bonne place »… Je trouve que les acteurs ne sont pas tous dans le même film, ça arrive assez souvent. Pour Jessica, j’étais allée chercher le côté ordinaire de ces filles là. J’essaie toujours d’éteindre les gens.
 Guillaume Cyr et Sonia Cordeau dans Bungalow (2023) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Guillaume Cyr et Sonia Cordeau dans Bungalow (2023) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Éteindre ?
Oui. Moi je surjoue tout le temps, je bouge beaucoup, je parle fort. Quand je vis tel quel devant une caméra, je suis trois degrés au dessus et j’ai l’air d’un mauvais comédien de théâtre d’été. Tu sais, claquer des portes (elle hurle en trafiquant sa voix) « Ah mon dieu! ». J’ai donc toujours l’air de surjouer ma propre vie donc j’essaie de les éteindre parce que je trouve que plus on les descend, plus on les connecte avec leur vérité. Oui, j’aime diriger les acteurs ! Dans ma vie, j’ai majoritairement travaillé avec des non-acteurs. Pour Bungalow, j’avais des comédiens et c’est aussi un vrai plaisir ! Je travaille toujours de la même façon mais là tu ne fais pas huit prises, tu n’en fais que deux. Et ici, plus les couleurs montaient, plus je baissais les acteurs.
La place des femmes dans la société est donc un de tes chevaux de bataille et on peut dire que sur le sujet tu ne mâches pas tes mots ni ne censures tes images…
Mon cinéma est l’extension de ce que je suis. Je suis une personne « dans ta face », un peu vulgaire. Je sacre beaucoup, je n’ai pas un gros vocabulaire. Je ne connais pas de grands mots. Je suis quelqu’un de militant, j’ai beaucoup manifesté donc ça aussi ça se voit dans mon cinéma.
Même si on est toujours obligé de prendre un peu de distance avec ce qui nous est montré, tu as quand même travaillé la matière documentaire. Parmi ceux-ci, un film simple et touchant tourné à l’île d’Hoedic en Bretagne…
Le truc avec la cornemuse là ? En fait, j’ai fait le Rallye Müve Médias en 2007. C’était diffusé à Télé Québec. C’étaient quatre québécois en France et quatre français au Québec. On avait dix semaines pour faire dix documentaires ou reportages de trois à cinq minutes et au bout, il y avait un grand gagnant. Et c’est moi qui ai gagné, ce qui fait que j’ai gagné ma caméra, mon micro et mon ordinateur, ce qui m’a permis d’avoir du matériel pour travailler. Ça a été mon premier vrai kit à moi pour faire mes propres trucs. Quand j’ai commencé, je travaillais avec le stock du travail mais après ce rallye, j’arrivais à Kino avec tout mon matériel. J’étais autonome. D’ailleurs Julie Lambert, l’autrice du film sur les femmes des bois qui est là cette semaine, elle aussi a fait le Rallye Müve Médias la même année, c’est comme ça que je l’ai connue. Sinon, je suis une grande amoureuse de la Bretagne, c’est ma région française préférée. J’ai fait les îles bretonnes et j’ai passé beaucoup de temps à Hoedic qui est la plus petite île, la dernière à avoir été électrifiée. Ils sont passés de la lampe à pétrole à la télé couleur. à cette époque je consommais beaucoup. J’ai beaucoup bu avec des vieux pêcheurs, anarchistes, braconniers. J’en ai passé du temps sur cette île là… J’avais été financée par la SODEC en Recherche et développement pour un documentaire sur la mort d’une île. Et des pêcheurs qui s’accrochent, à l’alcool, aux récifs. Bref j’ai passé des mois à Hoedic. À Ouessant, Yann Tiersen y habite et c’est mon musicien français préféré. J’espérais l’y rencontrer. Quand j’aime les gens, j’ai toujours envie de le leur dire. Je suis un peu passionnée. J’étais allée au café où Yann Tiersen aime prendre un verre et il n’était pas là. Je lui ai écrit une lettre que j’ai laissée au barman. « Vous la donnez à Yann s’il vous plaît ! ». Le Musée d’Ouessant, c’est celui des Phares et Balises et la toute première Fresnel, la même que celle qu’on utilisait en cinéma, elle se trouve dans ce fort là.
 En tournage pendandt le Rallye Müve Médias 2007- Photo issue de la collection personnelle de l'Auteure
En tournage pendandt le Rallye Müve Médias 2007- Photo issue de la collection personnelle de l'Auteure
C’est quoi la Fresnel ?
Une Fresnel, c’est la lentille utilisée pour projeter très loin des faisceaux de lumière. Les phares ont des Fresnel. La première à avoir existé se trouve dans ce Musée des Phares et balises dans le fort d’Ouessant. Les lumières des phares ont fini par servir pour le cinéma. Tout se rejoint. J’aime aussi la violence des vagues en Bretagne. Des fois, le vent est tellement fort que tu peux te coucher dans le vent et tu ne tombes même pas ! D’ailleurs, la première chose que je viens de faire en arrivant ici est d’aller m’acheter du beurre breton au sel. (rires) J’ai donc passé beaucoup de temps en Bretagne.
Ça n’est pas forcément très bon pour la santé… Plus cru, Loulou et Clooney, un portrait à la strip tease d’une relation quasi fusionnelle entre une femme et son cochonnet. C’est presque trop décalé pour être vrai !
Ah, c’est un vrai film. C’est encore pour un concours. Moi j’en ai toujours fait. Comme je n’ai pas fait d’école, que j’avais du mal à percer dans les festivals et que je travaillais en télé, je me disais que plus je gagnais de prix, plus beau serait mon CV ! J’ai tellement fait de concours que je me suis mise à gagner plein de prix. Ma première page de CV, c’est juste des prix (rire). Et puis ça m’a ouvert plein de portes. J’ai beaucoup misé sur ces concours vidéo. Là, il fallait faire un reportage sur un sujet « What’s the fuck ?! », un peu bizarre à Montréal et c’était organisé par Urbania. Aujourd’hui, c’est une grosse boîte de diffusion mais à l’époque, c’était juste une revue culturelle avec son petit site web. Une amie m’avait dit « J’aide une dame qui a un cochon à Montréal ». J’avais trouvé ça vraiment drôle et je me suis ramenée chez cette dame avec Jules Saulnier qui a monté tous mes films jusqu’à Bungalow. C’est mon meilleur ami, mon ex aussi… on était en couple. Donc Jules et moi on s’est retrouvés chez cette Louise Makovsky qui sauvait des animaux. Chez elle, ça sentait le vieux placenta mort. C’était dégueulasse tellement ça puait dans cette maison là ! On a fait ça en une journée. C’est un vrai cochon, une vraie histoire à 100 %.
Tu as donc beaucoup travaillé cette veine documentaire.
En fait, ce que je préfère c’est le théâtre. Ensuite, c’est le documentaire, ensuite la télé-réalité (rire) et enfin le cinéma de fiction.
Ah bon, si loin le cinéma de fiction ?
Hmm Hmm. Oui.
Je distinguais plutôt deux pôles dans ton travail, selon la distance de chaque projet par rapport à la réalité parce qu’entre Bungalow et un faux documentaire qui a l’air vraiment vrai - ou un vrai documentaire qui sonne faux - comme par exemple Le cinquantième qui est presque lui dans le format du reportage télévisuel le plus carré…
Encore une fois, Le cinquantième c’était une commande pour laquelle j’étais payée, comme pour Soliloques. C’était un week-end avec des jeunes, j’étais formatrice comme pour l’atelier que j’ai donné ce matin pour des enfants de 10 ans. Donc Le cinquantième, je ne l’ai présenté nulle part mais les jeunes ont gagné des prix avec en Abitibi. Donc ça c’est hors filmographie. Par contre, Écartée est vraiment un mélange fort de vrai et de faux. C’est tellement plein de vérité que quand on était en tournée avec Ronald, la première chose qu’il disait au public au micro, c’était « C’est pas vrai que je bande mou ! » (rires) Il se sentait insulté et puis il ajoutait « Je hais ça les crisses de casse-têtes, je voudrais tous les brûler ! » Donc lui ressentait ce besoin de dire ce qui n’était pas vrai car il raconte vraiment sa vie dans le film. Pour lui, les mensonges du récit devenaient confrontant.
C’est un personnage. D’ailleurs on voit bien la limite dans le making of. Ça n’avait pas l’air très facile de lui donner des indications...
Il faut aussi préciser que la veille du tournage, son père est décédé. Je lui ai dit « si tu veux quitter le projet, je comprends. » Il m’a dit « Donne moi cinq jours, je vais aller enterrer mon père et je reviens. » Au départ, j’étais sensée tourner Écartée dans l’ordre chronologique pour tous ces non-acteurs qui n’étaient pas habitués à jouer dans leur vie afin de les aider dans leurs émotions. Mais là, le père de Ronald meurt, on était en Abitibi, à huit heures de Montréal. Il est donc parti et j’ai alors tourné toutes les scènes avec les filles, celles du balcon, la scène de la piscine, plein de trucs. Puis Ronald est revenu et on a commencé à tourner avec lui. C’est un ex détenu qui a fait 25 ans de prison. Du fait d’avoir en plus perdu son père, il avait très soif. Ronald est un vrai alcoolique qui avait arrêté de consommer. Je l’avais connu dans des cercles de rétablissement pour alcooliques. C’est aussi pour cela que je suis beaucoup en prison pour aider des détenus. Mon père est aussi un alcoolique sobre depuis 37 ans car il a arrêté de boire quand j’avais trois ans. J'ai donc beaucoup évolué parmi eux. Beaucoup de ma créativité vient de ce que j’ai trouvé dans les cercles de rétablissement. Donc c’est là que j’ai recruté Ronald (rires) et lorsqu’il nous raconte comment il a arrêté la boisson, c’est entièrement la vérité. Quand on connaît l’ampleur de la vérité dans Écartée, on se rend compte qu’il y a plus de vérité que de faux.

Lawrence Côté-Collins et Whitney Lafleur, Making-of d'Écartée (2016)- Capture d'écran
Pour Jessie, sa compagne, il s’agit plus d’un personnage écrit ?
Je pars des gens tels qu'ils sont mais je vais bien sûr grossir tout ça à la loupe, chercher leur essence.
Ce qui rend leur rapport si fort à l’écran…
Oui. Les filles racontaient de la merde mais avec de la vraie drogue et de la vraie boisson. Comme moi, elles sont bisexuelles et se sont connues avant le film.
Tu questionnes beaucoup la place du réalisateur, du cameraman, celle de la caméra aussi. Il y a cette scène de coït en caméra cachée qui est un peu une provocation et qui représente aussi le côté fantasmatique, donc qui apporte de la beauté à la scène.
N’oublie pas qu’aujourd’hui, on est toujours filmés. Il y a toujours quelqu’un pour filmer avec son téléphone. Il y a des caméras à côté des sonnettes et on y voit les livreurs d’Amazon. Tous les magasins ont des caméras. On est en permanence filmés à notre insu. Des fois on s’en rend compte, d’autres on ne le sait pas. Les caméras sont aussi de plus en plus cachées, l’atteinte à la vie privée est donc réelle. J’aime jouer avec cette idée dans mon cinéma. Ça fait très longtemps que nous avons dépassé 1984. On est beaucoup plus loin. Nos téléphones nous écoutent et si des publicités y apparaissent, c’est parce que Siri nous écoute. La vie privée, ça n’existe plus beaucoup.
Pour revenir encore sur tes débuts, parmi tes plus beaux films, Fuck that est un portrait documentaire mais hors norme de ton père.
Ça en vaut la peine car Fuck that, c’est super vrai. C’est sans aucun doute mon court-métrage le plus important. Il a été réalisé à Kino à l’occasion d’un cabaret spécial 16mm. Il fallait avoir déposé une candidature. Nous étions 8 réalisateurs et on avait droit à deux bobines de cinq minutes qu’en plus on devait développer à la main nous-mêmes. C’est la seule fois de ma vie où j’ai touché à la pellicule. Non, c’est pas vrai ! J’avais fait du Super 8 avec Ode (2007), mais pour le 16, ma seule expérience a été Fuck that, parce que je suis une enfant de la vidéo, des caméscopes et des cassettes.
 Lawrence Côté-Collins en plein développement, tournage du film Fuck that (2010) photo issue de la collection particulière de l'Auteure
Lawrence Côté-Collins en plein développement, tournage du film Fuck that (2010) photo issue de la collection particulière de l'Auteure
Chimère, c’était de la pellicule ?
C’était de la photo et les moments « de pellicule », de la fausse pellicule. On a pris des chutes de pellicule qu’on a mis en transparence sur de la vidéo. Ces moments là sont donc des faux. Ce n’est que de la pixilation et du stop-motion. Pour Fuck that, le résultat n’était pas sensé être celui-ci. De l’âge de 15 ans jusqu’à mes 21 ans, je n’ai presque pas parlé à mon père. Il était dans une relation de violence conjugale mais dans son cas, c’est la femme qui était violente. Je sais que c’est tabou de parler de ça, on ne sait pas grand-chose mais des femmes violentes et qui veulent exercer leur contrôle, ça existe. Il a été pris dans cette relation de violence où elle a créé le vide autour de lui et m’avait sortie de la vie de mon père. Une crisse de folle. Au moment de Fuck that, ça ne faisait pas très longtemps que mon père et moi avions recommencé à nous voir pour des soupers ou de façon informelle. Je voulais faire un film sur ma grand-mère qui était en CHSLD (équivalent des EHPAD français) et qui était sur le point de mourir. Je voulais faire un film sur la solitude des personnes âgées avec des enfants, pour faire ressortir le contraste entre elles et les enfants. Ma grand-mère a décidé la veille du tournage de ne pas participer au film. Elle m’a appelée pour me dire « ça ne me tente pas finalement ! ». Jules, mon copain de l’époque au moment où nous vivions ensemble, m’a suggéré de faire le film avec mon père. Il avait eu une vie tellement remplie. Je me suis dit que c’était une bonne idée et j’ai demandé à mon père si ça le tentait. Il a dit oui.
Ce jour là, on n’avait pas prévu la boue, qu’il pleuve autant donc quand je parle de composer avec les éléments et avec l’adversité et de l’utiliser comme tremplin pour créer, là on a tout tourné quand même. La maison où on le voit dans la cour et à l’extérieur, c’est vraiment la maison où il a grandi et où j’ai passé mon adolescence avant qu’il ne rencontre cette femme et qu’elle ne rentre dans sa vie. Quand il glisse dans les escaliers, ce sont les mêmes que ceux de son enfance, la cour et ses flaques d’eau. À un moment, il est dans un champ et lance une chaise. C’est parce que durant sa jeunesse c’était l’endroit où se tenait la taverne et l’endroit où il la lance, c’est la place où son père s’asseyait pour boire au lieu de s’occuper de lui. Pour la conversation avec mon père, on a fait ça dans une ruelle et moi je pleurais, je buvais beaucoup d’alcool car je n’étais pas capable de parler avec lui sans boire. Jules prenait le son. Moi je pleurais et je buvais, j’étais sur la brosse (bourrée), alors que mon père, à jeun, lui se confiait. Quand il m’a demandé « Et toi, as-tu quelque chose à me dire ? », moi qui avais plein de problèmes, j’ai dit « non, non, j’ai rien à dire » ! (rire) Ce film a fait une grosse tournée car ils se sont identifiés à cette histoire là et plein de gens sont allés pleurer dans les bras de mon père. (la voix tremblante) Je suis même émue d’en parler, c’est le film qui a réparé notre relation. Sinon mon père apparaît dans Bungalow. C’est un des messieurs aux machines, un des clients, celui qui n’est pas de la police, c’est mon père !
 Lawrence Côté-Collins et son père dans Fuck that (2010) -Capture d'écran
Lawrence Côté-Collins et son père dans Fuck that (2010) -Capture d'écran
À l’opposé, tes comédies les plus débridées semblent artificielles, par exemple Geisha Québec (2011) et son look aussi décalé que son thème...
Ma maison est colorée, tous les plafonds le sont donc moi je suis une personne colorée et ça transparaît dans mes films. Je trouve aussi que le décor, les vêtements et les objets racontent les non-dits des personnages. Par exemple, André-Line Beauparlant a beaucoup fait la direction artistique des films de Robert Morin ou Stéphane Lafleur. Dans le problème d’infiltration, la fille est devant son miroir et derrière elle il y a des souliers Et sur chaque tablettes, il y a d’autres souliers, exactement les mêmes mais de couleur différente. On se dit donc que cette femme là ne prend pas de décisions dans la vie et qu’elle a tellement d’argent que quand elle aime une paire de chaussures, elle achète toutes les couleurs. Donc le décor raconte beaucoup les traits de personnalité. Quand tu rentres chez moi c’est très excentrique et il y a des gens qui ne tolèrent pas ma décoration, qui trouvent ça anxiogène et angoissant. Moi j’aime les gens colorés, les gens différents, la folie. Comme je suis une enfant de la télé, il y avait au Québec l’émission Caméra 87, Caméra 88, Caméra 89 qui faisaient des reportages sur des gens flyés (surprenant). Il y avait eu un reportage sur le pape de Verdun, un monsieur d’un quartier de Montréal qui se prenait pour le pape et qui plus tard est mort du sida. Il y a eu ce reportage, j’étais avec un ami à Québec, on était bourrés et on parlait du pape de Verdun, moi je me suis mise à crier « Geisha… Québec ! ». C’était drôle et je me suis dit que j’allais tourner un film de Geisha. C’est toujours des intuitions, une sorte d’hommage au Pape de Verdun. j’aime les gens hauts en couleur et bizarres, les mettre en scène, les amener au cinéma. J’aime aussi beaucoup les gags visuels, les jokes comme « Manger du chinois » alors que c’est de la nourriture en boite. Ça me fait rire. Et puis je suis très cynique. Fondamentalement, je suis une punk. Je suis « Fuck the police ! », « No future ! ». On s’en va dans un mur, je hais l’humanité, je hais la société, je hais le capitalisme et donc toute cette haine paraît dans mon cinéma parce que j’en ris. J’ai beaucoup d’autodérision vis à vis de moi, de ma dysfonction et de mes problèmes. Si je ne ris pas, je vais mourir. J’aime rire de tout, je trouve que rire est important, ça fait partie de la survie
Parmi tes autres films de cette veine, Purple pourpre (2017).
Ce qui est drôle c’est que cette maison existe et son extérieur était mauve. Elle était à vendre sur le site de RE/MAX. C’est à Laval, dans le quartier de mon enfance. Pendant mon temps libre, au lieu de regarder la télévision, moi je préfère regarder des intérieurs de maison parce que j’adore regarder la décoration chez les gens. Ça me fascine, c’est comme une obsession. J’ai donc découvert cette maison et à l’intérieur, tout était zébré, c’était épouvantable ! C’était une maison horrible avec son extérieur mauve, et des fleurs en plastique mauves dans tous les bacs autour. J’appelle ma copine Sylvie « Crisse, va voir la maison que je vais t’envoyer par internet ! » J’appelle donc l’agent immobilier, l’idée d’aller y tourner me rendait folle. J’étais en plein processus de financement de Bungalow.
 Purple pourpre (2017 ) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Purple pourpre (2017 ) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
J’ai aussi plein de photos d’intérieurs de télé-réalité parce que j’ai fait Des soupers presque parfaits. En France, c’est Un dîner presque parfait, des gens qui sont en compétition pour se recevoir à souper et à la fin de la semaine il y a un gagnant. On a racheté la licence de la France pour avoir cette émission au Québec. J’en ai réalisé pendant six ans, ce qui m’a permis d’entrer dans plein de maisons. J’ai donc fait un gros fichier de photos pour défendre mon projet à la SODEC, pour dire « Tout ce que je vais mettre à l’écran sont des choses qui existent ». Je copie des décors que j’ai vus, sauf que je les mets tous dans la même maison (rire), tout ce que j’ai vu de plus laid, ensemble. Donc quand j’ai vu cette maison toute mauve et zébrée, dégueulasse, j'ai dit « Oh mon Dieu, il faut tourner là ». Je voulais montrer à la SODEC que c’était en vente, là, maintenant ! Mais je n’avais pas d’histoire, ni rien à raconter, je voulais juste rentrer dans cette maison et aller y faire des niaiseries ! (rire) Grâce à l’agent immobilier, les propriétaires m’ont dit oui. Je leur ai donné 50 dollars de chèques cadeau pour aller au cinéma et rester trois heures dans leur maison. Je n’ai touché à rien. J’ai pris mon actrice, j’ai acheté une nappe, des cupcakes, un chien électrique. J’ai pris des vêtements zébrés. Quand on est arrivés, la dame qui habitait là m’a ouvert la porte était toute habillée en zébré, comme sa maison. J’étais avec Sylvie et on se disait « Voyons donc ! La réalité dépasse la fiction ! ». C’était juste pour dire à la SODEC « ça existe donc j’ai le droit de faire ça ! » (rires) Il a juste été projeté deux fois sinon. Mais c’était toujours cette volonté de prouver son existence parce que je fais toujours du « Copy/Paste ». Je copie colle la réalité, je la compile ensemble pour en faire quelque chose de nouveau. Dans Bungalow, excepté le mort dans le sous-sol, sinon ce sont toutes de vraies affaires. Même quand la fille donne sa petite culotte, c’est encore une histoire vraie. Finalement, je ne fais juste que prendre des vraies choses pour les mettre en scène ensemble. Dans le fond, c’est pas original ! (rires)
La manière de le faire, si quand même… En réalité, la vraie spécialité de l’Abitibi et de Rouyn Noranda, c’est le documenteur. Peux-tu revenir sur tes collaborations successives avec le festival ?
Alors le Documenteur en fait car le festival d’Abitibi, je n’y suis jamais allée. Mais j’ai fait chaque année le festival du Documenteur. Par exemple, Un exemple de succès (2012), ça c’est un film que j’ai juste fait pour aller au festival. C’est celui où le comédien joue tous les rôles. C’est parce qu’à Rouyn Noranda, l’animateur du festival est un acteur et il joue dans tous les films en Abitibi, mais aussi dans toutes les publicités, dans toutes les pièces de théâtre et aux matches d’impro, tout ça parce qu’il n’y a pas beaucoup d’acteurs en Abitibi. Ça c’est drôle donc j’en ai fait comme un pastiche de l’acteur en Abitibi. (rire)
D’ailleurs j’ai cru que c’était un pastiche d’Alexandre Castonguay ! (rire) Finalement, lui aussi c’est un peu cette situation là. Il va peut-être être « Artiste de l’année » tous les ans !
Mais c’est vrai qu’on les voit tout le temps faute d’autres acteurs. En plus d’Alex, ils doivent être 4 et ils vont partout ! Ça fait aussi que si on traîne beaucoup en Abitibi, on se retrouve toujours avec la même gang. C’est toujours la même équipe d’impro qui fait les spectacles de théâtre, qu’on voit à la télé. C’est le même monde. Le cameraman des nouvelles de TVA Abitibi était le fondateur du Documenteur et il était aussi le coach d’impro ! Tout le milieu culturel de l’Abitibi est un microcosme. Avec Un exemple de succès, je voulais tester deux choses. En cinéma ou en télé, on fait toujours du son pur. Il n’y a pas de bruits, le bruitage est rajouté postérieurement. Or pour Écartée, je voulais vraiment avoir de vrais bruits. Je voulais que le frigo fonctionne, que les ventilateurs pivotent, que tous les bruits soient réels et même en rajouter, parce que la vie c’est bruyant. Un exemple de survie m’a servi pour rire de l’Abitibi et j’ai en même temps testé la balayeuse, parler avec la hotte de poêle qui fonctionne. Tu sais, le truc qui tire la vapeur et la fumée au-dessus de la cuisinière? Ça fait un bruit d'enfer. J’y faisais donc des tests son pour me rassurer en tournant Écartée que le son allait fonctionner même s’il est parasité. C’était un exercice qui validait l’idée que je pouvais jouer avec le son.
 Un exemple de succès (2012) de Lawrence Côté-Collins -Capture d'écran
Un exemple de succès (2012) de Lawrence Côté-Collins -Capture d'écran
Pas de pain pas de gain (2009) repose sur une complicité avec le spectateur. Encore une fois on pense qu’au début on est dans un reportage. Certaines exagérations instillent du doute jusqu’au passage du dealer…
C’est encore mon ami Alexandre, qui est toujours dans tous mes films, toujours celui qui arrête Guillaume Cyr à la fin de Bungalow. Je suis en train de faire un documentaire sur lequel je travaille depuis six ans et que je vais sortir l’année prochaine. Donc le gars qui joue dans Pas de pain pas de gain s’appelle Billy Poulin et est un de mes bons amis. Il est schizophrène et est en prison maintenant. Il a tué deux personnes en pleine psychose. Ce n’était pas avec des armes. Ce sont des bagarres qui ont mal tournées. La personne a reçu un mauvais coup de poing. Dans la même soirée, il s’est battu avec deux personnes différentes et les deux sont décédées. J’ai tourné ce film en 2009 et Billy, on l’a fait jouer tel quel, dans l’essence de ce qu’il est. J’ai toujours aimé les gens spéciaux et Billy, c’est un gars spécial. Mais on ne savait pas qu’il était schizophrène, déjà très avancé. Et c’est fin 2012 que ces personnes sont décédées Il est donc parti en prison et je suis la seule personne qui ait accepté d’entrer en contact avec lui, sauf que Billy m’a attaquée moi aussi. Il fait partie des gens qui m’ont agressé dans la vie. Je l’ai retrouvé en prison parce que je voulais comprendre.
En état de psychose là aussi ?
Et bien je ne le savais pas à ce moment là mais je l’ai compris après quand je l’ai retrouvé en 2017. il a tué en 2012, Pas de pain pas de gain est tourné en 2009 et il m’a agressée en 2010. Je l’ai sorti de ma vie et perdu de vue. Fin 2012, une psychose terrible a laissé deux morts et en 2017, sa sœur m’a retrouvée pour me dire « Mon frère essaie d’enter en contact avec des gens et personne ne veut lui parler ». Comme je faisais déjà beaucoup de bénévolat en prison et j’avais déjà une relation d’amitié avec Ronald à cause d’Écartée donc j’ai dit « Moi je veux y aller en prison ! Je veux comprendre pourquoi Billy m’a attaquée. » Quand j’ai retrouvé Billy, j’ai alors retrouvé mon ami très handicapé, très malade. Il est aujourd’hui en psychiatrie, au dernier stade de la schizophrénie, quand tu as fait tellement de psychoses que tu en gardes des lésions cérébrales. Il est en psychiatrie depuis son incarcération et je fais un film avec lui sur la schizophrénie. Donc le prochain film que je sors est un vrai documentaire. C’est l’histoire de Billy et moi et j’y dévoile tout mon alcoolisme, mes agressions sexuelles et (elle bégaie) je soude mon histoire à celle de Billy pour raconter l’histoire de sa schizophrénie. C’est l’histoire de Lawrence et Billy qui se reconstruisent dans la confidence. Ça va être un film super trash, très lourd. Je suis donc quotidiennement en contact avec la schizophrénie depuis maintenant six ans. ça fera sept ans quand mon film va sortir en 2024. Ça risque de chambouler ma vie, peut-être même ma carrière de cinéaste...
Pour l’instant tu n’as pas tourné ?
Oui. C’est un film basé sur nos archives personnelles et sur du tournage en temps réel donc par exemple il y a des choses que je tourne cette semaine qui vont se retrouver dans mon documentaire. C’est Billy qui raconte sa schizophrénie. Il a compris avec moi qu’il était responsable des morts. Jusque là il pensait que c’était un complot ou que ça ne pouvait pas être lui. C’est tout le chemin de la guérison, du rétablissement, de la médication et le film se termine quand il demande pardon aux familles des victimes parce que maintenant il est handicapé, il a honte… C’est très chargé, très vrai et je vais être toute nue devant le monde entier, au sens propre et figuré. Ce qui fait que ça passe ou ça casse. Soit ce film fait plein de festivals et ça propulse ma vie ou au contraire, ça me ferme toutes les portes. Je joue le tout pour le tout. Quand je disais que j’aime beaucoup la folie, je fais vraiment équipe avec un schizophrène qui a une sentence à vie. (grand rire) Ma vie est intense !
Dans ce cas précis, tu arrives quand même à travailler en parallèle avec d’autres projets. D’où la nécessité d’équilibrer ça avec des projets plus légers.
Ben oui, j’ai fait Bungalow dans cette période là, de la télé-réalité. Ça fait juste un an que je ne m’occupe que de Billy. C’est nouveau pour moi de me consacrer plutôt à la sortie de Bungalow. J’ai essayé de continuer les deux en même temps mais je n’en étais plus capable, c’était trop. J'aime pas beaucoup les sujets légers. J'aime brasser des affaires. Pour moi, l'Art ça doit provoquer. Choquer. Brasser le monde. Ouvrir au dialogue. J'ai souvent fait des contrats où je laissais mes valeurs chez moi. Maintenant, je veux juste créer selon mes convictions profondes.
Billy, c'est un film que j'ai fait avec du courrier de Billy, nos archives, des extraits de son interrogatoire de police de 2012 et des animations en stop-motion. C'est comme un gros bricolage pour expliquer sa maladie et ses crimes et ça dit aussi pourquoi j'ai eu envie de l'accompagner et de l'aider. À travers ça, je suis devenue pas mal experte des prisons, de ce que ça implique et comment ça fonctionne. Par la suite, mes créations vont beaucoup toucher le milieu carcéral. Ça me passionne !
 Billy Poulin dans Pas de pain pas de gain de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Billy Poulin dans Pas de pain pas de gain de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Puisque tu en parlais tout à l’heure est-ce que le travail d’André-Line Beauparlant en documentaire t’inspire quelque chose ? Son travail sur la famille...
Beaucoup ! Trois princesses pour Roland est un film que j’ai beaucoup aimé. J’aime beaucoup le travail d’André-Line, Pinocchio sur l’histoire de son frère. André-Line comme Robert (Morin) ont tous les deux quelque chose de très brut.
On pourrait parler de Petit Pow Pow Noël.
Dans celui-là, il a réglé ses comptes avec son père comme moi je l’ai fait dans Fuck that.
Il est très noir...
Oui, mais sa relation avec son père, il me semble que c’était de la merde. Robert, il est comme moi, il dit ce qu’il pense. Il va au bout de ses idées. j’ai me le côté brut, le côté cru, le côté très « Dans ta face ». Les choses sont telles qu’elles sont et André-Line a ça quand elle fait son cinéma. En tant que directrice artistique, son travail est impeccable et elle plonge dans les univers des autres. Mais quand c’est son cinéma à elle, c’est... (elle crie) « Wroa ! » J’aime les artistes qui osent exister tels qu’ils sont.
C’est au moment d’Écartée que tu as travaillé avec Robert pour le scénario ?
Oui, j’ai rencontré Robert aux Rendez-vous du cinéma québécois après une conférence. Une de mes amies le connaissait et m’a poussé vers lui. Non, elle m’a littéralement poussé sur lui ! (rires) « Robert, parle à cette fille là, elle t’aime et vous vous ressemblez ! » On a donc parlé, il m’a trouvé sympathique et il m’a dit « donne moi une copie de tes rushes ». Je lui ai donc mis dans sa boite aux lettres une copie dvd de plusieurs de mes films dont Mr Smith, un de mes films préférés.

Écartée (2016) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran.
Il n’apparaît dans aucune filmographie. C’est un court ?
Oui, je t’enverrai un lien. Donc deux jours après, Robert m’appelle « T’es drôle tabarnak ! T’as bien du talent, on va aller prendre une bière. » On est donc allé boire une bière et il m’a dit « Je vais te faire entrer à la Coop vidéo, on va produire ton premier long ». pour Écartée, il lisait mes copies de scène à scène parce qu’il n’y avait pas de scénario et puis au début c’était écrit « 100 % de ce que vous avez lu pourrait ne jamais être tourné ! » (rire) donc je n’ai pas vraiment eu de financement ! J’ai eu 50 000 du CALC (Conseil des Arts du Québec) que j’ai entièrement claqué au tournage. Après ça, on a pris un an avec Jules pour faire une Version 1 du film en montage et j’ai fait un autre dépôt à la SODEC pour leur demander de me sauver en postproduction pour avoir de l’argent. C’est aussi Robert qui m’a dit d’amener plus de caméras que la caméra principale. « ça t’aiderait si tu avais d’autres caméras pour raconter ton histoire ».
En multi caméras, donc en simultané ?
Non, simplement d’avoir d’autres caméras.
Pour avoir un autre régime d’images ?
Oui, le téléphone, la caméra qui espionne et qui va dans l’eau. Robert ne m’a pas dit « Fais ça ! » mais m’a plutôt donné des pistes de réflexion. Mais il n’a jamais lu de version dialoguée, il n’y en a jamais eu pour Écartée ! Ça a fini que je prenais des notes au tournage sur des serviettes en papier. La journée de la fête de Jessie dans le film, en réalité c’était ma fête et je voulais qu’on la fête. j’ai alors décidé que pour le film c’était celle de Jessie. Les fleurs qu’elle a reçue sont les miennes, le gâteau de ma fête… Après ça, Robert a vu une version 2 montée, beaucoup plus tard dans le processus. Dans Bungalow, c’est lui qui fait la voix quand on enterre le mort, c’est son apport. Il a donc été un conseiller mais il est aussi important dans ma vie.
Est-il impliqué sur le prochain projet ?
Non, mais l’autre jour, je lui ai parlé d'une nouvelle idée de film. Il m’a donné des pistes de réflexion. Il m’a dit : « Si tu m’écris trois pages, je vais te lire et te parler ». Je lui ai demandé « T’aimerais pas ça coscénariser avec moi ? » « Non ! Si je coscénarise, je vais finir par écrire à ta place, je vais m’approprier ton histoire. Écris et ensuite je te donnerai des opinions. Moi je n’aime pas être en équipe en écriture, ça me dérange. » À Robert aussi, j’ai écrit une lettre d’amour que j’ai lue à Radio Canada, une lettre d’amour de cinq pages qu’il n’avait jamais entendue et cet hiver, j’avais pris une copie et je lui ai donné. Il m’a dit (ton bourru) « C’est quoi ça, une lettre d’amour ? » « Ben oui. J’ai lu ça il y a trois ans à la radio, je t’ai envoyé un lien mais je ne pense pas que tu l’aies écoutée. » « Non je veux pas écouter ça » « Tu la liras. » (rires) Quand j’aime beaucoup les gens, je trouve ça important de le leur dire. Autant j’exprime la violence, autant il me semble important d’exprimer aussi l’amour quand on en ressent, ce qui fait que Robert, il est toujours un peu dans les parages. Je pourrais dire que c’est devenu un ami.
Parmi les choses que nous n’avons pas encore abordé, que t’a apporté ta collaboration avec le Wapikoni mobile ?
Rien. Pour moi, faire du Wapikoni, c’était comme faire des formations dans les écoles. La seule chose, c’est que j’ai pu voir un peu les réserves et ça, ça, m’a juste mis plus en tabarnak, contre le gouvernement, le colonialisme. Je traîne dans les prisons fédérales et provinciales et je fais du bénévolat depuis maintenant dix ans, lorsque moi j’ai arrêté de consommer. Je me disais que c’était le seul endroit où je pouvais exister sans honte parce que les détenus, eux ont vraiment honte. Au Canada, 40 % des détenus fédéraux sont des autochtones alors que la population autochtone canadienne est de 5 %. Donc c’est énorme !
Déjà on les a scolarisés de force dans des pensionnats…
Oui c’est ça mais après on les a isolés, on a coupé toutes les forêts autour. Les gens qui ont des opinions méchantes contre les autochtones, ça me met en tabarnak parce que ce qu’on leur a fait, c’est inacceptable. De ce fait, ils sont en surpopulation dans les prisons.
 Geisha Québec (2011) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Geisha Québec (2011) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Mais est-ce que ça t’a au moins amené ça ? Parce qu’avant le Wapikoni, la prise de conscience des québécois était faible. Si elle est forte aujourd’hui, elle est avant tout très récente.
L’histoire des pensionnats, ils nous enseignaient ça dans les formations Wapikoni. J’ai fait ça en 2008. Ça ne fait pas si longtemps qu’on en parle dans les médias, ça a ajuste augmenté ma conscience des torts faits aux autochtones. C’est aussi à ce moment là que je me suis apostasiée. J’ai renié mon baptême et tu sors de l’Église catholique. Déjà, moi j’aimais pas l’église mais quand j’ai découvert ce que l’Église avait faite aux autochtones, j’ai demandé l’apostasie. J’ai d’ailleurs réalisé un film expérimental qui s’appelle Apostasie baby suite à ça. (rires)
Ça donne envie de le voir ! Je sais que certaines personnes considèrent que le Wapikoni peut être vu comme une autre forme de paternalisme, mais quand même, est-ce que cet échange avec les autochtones a influencé ta création ou ta poétique de quelque manière que ce soit ?
Ben non. Je dirais que ça m’a donné un regard nouveau, ça a élargi mon regard sur l’Église, ça m’a radicalisée dans mon opinion. J’ai beaucoup parcouru le territoire au-delà de Wapikoni parce que j’ai milité contre l’uranium, je suis allée visiter des sites miniers abandonnés, les coupes à blanc parce que j’ai vu L’erreur boréale de Richard Desjardins à vingt ans et avant je ne savais pas ce qui se passait. À un moment donné, je me suis dit « waouh, tout ce qu’on nous cache, tout ce qu’on ne sait pas ». Plus j’ai découvert des choses, plus je me suis radicalisée dans mon opinion et plus je suis partie en voiture à la conquête du territoire pour aller voir de mes yeux vus. Je me suis alors mis à faire beaucoup de photos que j’ai données au journal Le Devoir. Aujourd’hui encore, quand ils parlent des mines ou des coupes à blanc, ce sont encore mes photos qu’ils publient. Ces photos du territoire massacré, je les ai données aux journaux, sans être payée pour cela. Ça a servi pour pleins d’articles sur l’environnement. Pour moi, Wapikoni s’inscrit juste dans mon éveil sur la tragédie du colonialisme, de la religion et du capitalisme, ça fait partie de tout cela.
 Lawrence en tournage avec le Wapikobi mobile - Collection particulière de l'Auteure
Lawrence en tournage avec le Wapikobi mobile - Collection particulière de l'Auteure
Quand le film Mesnak est sorti et que j’aime beaucoup, la critique québécoise était mauvaise, on lui reprochait entre autres d’être excessivement noir dans sa peinture de la réalité sociale des réserves alors que la sortie ultérieure de Québécoisie va susciter l’engouement. C’est très curieux et difficile à saisir d’ici comment l’éveil de la population québécoise a eu lieu.
Ben non, c'est comme pour le sexe avant Me too#. Il y ba beaucoup de recisme, de stigmatisation, de jugements et d'idées méchantes envers les autochtones. Personne n'était encore vraiment au courant pour les pensionnats.
Tu importes la science-fiction et la fantaisie dans le Mockumentary avec Summerdome (2009), qui est un genre de Dystopie documentaire sur fond d’utopie économique et environnementale.
Summerdome a été fait pour le concours du Documenteur à Rouyn Noranda. Chaque année, il y avait cinq équipes en compétition et le festival durait trois jours. Chacune avait un faux documentaire à faire en 72 heures. La soirée de clôture était toujours consacrée à la projection des cinq films par les cinq équipes. Quand on est arrivés, le festival prenait des MRC de la région Abitibi et on était obligés d’aller dans la région qu’on avait tirée au sort.
C’est quoi les MRC ?
L’Abitibi-Témiscamingue se divise en cinq zones comme Val d’or ou le Témiscamingue donc ce sont des morceaux de région. Toutes les radios locales et tous les habitants étaient au courant. J’étais logée chez l’habitant. J’ai fait deux fois le concours de création. Là, c’était ma deuxième participation. Encore une fois, je faisais équipe avec Jules. On était donc parti pour refaire le concours et on savait déjà qu’on voulait faire l’été éternel. J’ai plusieurs obsessions dans la vie dont Dubaï. D’ailleurs dans Écartée, Scott est obsédé par Dubaï, quand il dit je vais aller au sommet de Burj Khalifa.
J’avais vu ça comme un délire à la Elvis Gratton.
Non ça c’est moi, toutes mes obsessions s’allument dans mes personnages. Je suis une personne très obsessionnelle, ça va avec la maladie de la dépendance, l’alcoolisme et l’excès. Pour moi, Dubaï est l’icône de la démesure et de l’imbécillité du néolibéralisme poussé à l’extrême et de l’industrie du pétrole. Le seul hôtel sept étoiles au monde est à Dubaï et il est dans Summerdome. On s’était dit que quelle que soit la MRC qu’on tire, on fera l’été éternel. On avait déjà une idée de ce qu’on allait faire donc on avait déjà acheté plein de stock niaiseux dans un magasin de farces et attrapes : des colliers hawaïens, des noix de coco, tout un kit de fête estivale et on est partis avec ça dans la voiture. Le monsieur qui dit « C’est Noël à l’année ! » et qui tape sur ses lumières, et bien là c‘était le chalet où on habitait et lui en était le propriétaire. Tous les gens du village savaient qu’on était là pour faire un film et ils ont tous participé bien volontiers. C’est volontairement débile avec l’ajout de tous les buildings.
 Summerdome (2009) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Summerdome (2009) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Le discours, lui, est tout à fait clair…
Oui car c’est une critique de Dubaï, cachée en Abitibi. (rire)
Il me semble que les québécois portent aussi cette obsession de toujours vouloir aller au soleil, ce besoin en fait…
Il y en a beaucoup.
Aujourd’hui où les gens devraient moins prendre l’avion, du côté des québécois on continue à voyager pas mal. N’est-ce pas une nécessité biologique ?
C’est sûr que l’hiver, ça ne plaît pas à tout le monde. Moi c’est ma saison préférée ! Je pourrais vivre en hiver les douze mois par an. Je déteste l’été ! J’aime pas avoir chaud, je n’aime pas beaucoup le soleil. J’aime le noir, le froid, le vent, faire un feu, m’enfermer.
Et tu ne préfères donc pas l’hiver en ville puisque tu t’es achetée une forêt…
Non, j’aime vraiment plus la campagne. J’habite en ville juste pour le travail, c’est comme ça.
C’est curieux parce que comme le film d’hiver est un genre typiquement québécois, tu refuses d’en faire un. c’est ton côté rebelle…
Pour tout dire, Bungalow a été tourné en hiver mais on était en studio. Et pour la scène finale, c’était l’hiver mais sans neige. Il avait plu la semaine précédente alors que le finale était sensé se passer dans la neige. C’était le mois de mars et d’habitude au Québec, c’est plein de neige. On a fait la préparation en décembre-janvier et on a tourné en février-mars, c’est donc totalement un film d’hiver !
Tu as aussi assuré la direction photo pour d’autres cinéastes de Kino...
Ça, je ne le fais plus !
… Par exemple dans Skinny love (Karl Farah) où justement la photo est très belle.
Ah mon Dieu ! Pour Pas de pain, pas de gain, Jessica, Summerdome ou Écartée, c’est moi qui l’ai faite aussi.
J’avais aussi vu le truc de télé-réalité qui se passe Grèce où tu faisais la post production.
Occupation double ? Mais c’est moi qui l’ai réalisé. Il y a deux équipes de réalisation sur la télé-réalité, celle qui tourne dans le pays qui avec des régies, aiguille les caméras des maisons et envoie ensuite tout ce matériel à Montréal et là à Montréal, il y a une réalisatrice qui réalise l’émission de gala du dimanche qui dure 1h30. Moi je recevais une cinquantaine d'heures de matériel dont je devais tirer trois épisodes de 30mn. C’est moi qui briefait tous les monteurs, qui bâtissait toutes les émissions.
En effet, il y a comme un drôle de second degré là dedans, presque un truc un peu monstrueux.
Mais c’est un gros boulot et j’ai du signer 36 épisodes en trois mois. C’est beaucoup mais pourtant, j’en ai fait encore plus sur Un souper presque parfait avec 175 demi-heures. J’ai aussi fait une série documentaire Classée XXX sur l’industrie de la pornographie au Québec, bref plein d’autres choses, du magazine aussi. Moi je fais de tout ! Mais c’est vrai que tout ça finit toujours par avoir un peu d’humour. Il s’agit toujours de prendre les gens et de les grossir à la loupe, comme dans mon cinéma.
On peut aussi aborder le très produit Score qui compense un emballage classique par un humour mordant et un visuel explicite. Avais-tu plus de temps de tournage ?
Pas vraiment mais c’était la première fois que j’avais de l’argent. C’est mon seul court-métrage qui a été financé avec 50000 dollars du CALQ.
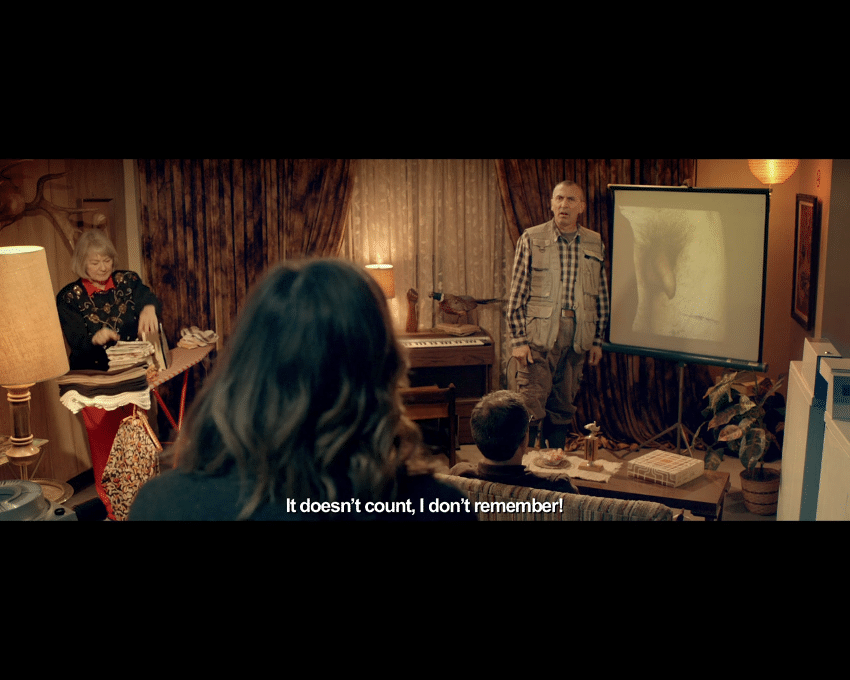 Score (2011) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Score (2011) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Au niveau décors, c’est plus lourd.
Oui c’est ça, c’est Sylvie Desmarais qui a signé les décors. Pour moi ce qui était important, c’était d’abord de mettre des pénis à l’écran. C’est ma réponse radicale à l’hypersexualisation des femmes dans le cinéma. Toutes les femmes sont agressées et ont toujours les seins à l’air. Dans tous les films d’exploitation, les filles courent en jarretelles donc moi en réaction j’ai envie de mettre des pénis sur l’écran. C’est aussi pour ça que mon mort dans Bungalow est tout nu. Mon rapport au pénis est très important et mettre des pénis partout est un acte volontaire. Pas pour Écartée car Ronald n’était pas d’accord et il fallait que je respecte cette limite. Je ne l’aurais pas demandé à Guillaume Cyr non plus, il restait donc le mort. Mais la représentation du pénis est importante car c’est ma réponse au cinéma des hommes, fait par des hommes et pour les hommes. Pour Score, à je trouvais ça bien de réduire l’homme à son pénis quand on en parlait. Je l’ai défendu dans mon dépôt de dossier, c’était vraiment dans une démarche féministe. Je fais le parallèle avec Bungalow parce que le gars des effets spéciaux qui a fabriqué le mort a fait des corps morts au cinéma depuis 25 ans au Québec aux États-Unis et un peu partout. Et bien, en 25 ans de métier, c’était le premier pénis qu’on lui demandait ! Tout ce qu'on lui demandait dans son atelier, c’était des femmes nues, empalées, violées durant 25 ans d’effets spéciaux. D’ailleurs, il y a aussi Sophie Dupuis qui met des pénis dans ses films. Je crois que les femmes en ont assez. On va en semer les graines dans notre cinéma. (rire)
Ceci dit, ça fait quand même quelques temps que la tendance s’est inversée au cinéma, que dans les scènes d’amour on va filmer l’homme nu plutôt que la femme.
Je ne suis pas du tout d’accord avec ça, mais peut-être que je regarde trop de vielles séries B et de nanars, dans cette veine là aussi je suis un peu excessive.
Je ne parle pas du cinéma bis en effet !
Je n’ai pas une grosse culture en cinéma intellectuel international. Je suis fille du cinéma d’exploitation. Là, la femme est très exploitée. Ce que je consomme n’est pas très intellectuel.
En gros historiquement, on a libéré le corps de la femme pour pouvoir ensuite l’exploiter, ça s’est presque fait dans un même mouvement !
Ouais !
Particulièrement au début de la pornographie aux États-Unis. Si 99 % de la production n’a aujourd’hui presque aucun intérêt, à l’époque quelques auteurs, et même des femmes, cherchaient aussi à aborder le sujet différemment. Ce qui me fait penser à une scène d’effeuillage forcé chez Jean-Claude Lord, est-ce que ses films ont eu une influence sur toi ?
Je ne connais pas son cinéma. Par contre tu connais Jodorowsky ? La montagne sacrée, ça c’est du bon cinéma !
Tu n’as pas vu Parlez nous d’amour (Jean-Claude Lord, 1976)?
Ah ! Le gars de la télévision qui abuse des femmes ? Oui ça j’ai vu ça.
Tu te souviens peut-être de la scène où des hommes en régie et derrière une vitre sans tin force une femme à se déshabiller. Il y a là une dimension particulièrement cruelle qui pourrait faire partie des ascendants de ton cinéma.
C’est d’abord que moi j’ai été très exploitée et très abusée dans mon travail. Je viens d’un milieu d’hommes où pendant dix ans on me parlait de mon cul au lieu de parler de mon talent. Pendant dix ans au travail, on me parlait de mon corps et de mes fesses ! Constamment… Quand j’ai commencé en télévision en 2004, à l’âge de vingt ans on ne me parlait que de mon cul. Et quand le réalisateur m’a poursuivi en cour, il m’a accusé de porter des vêtements trop serrés pour aller travailler. J’étais sur un plateau de tournage et j’enroulais des câbles comme ça (elle se lève, mime et se penche) et là on me dit que je provoque les hommes derrière moi et que je suis responsable de me faire agresser ! Que je dois me pencher comme ça (elle s’accroupit en gardant le dos bien droit) pour enrouler des câbles parce que sinon je cherche à me faire agresser. Voilà ce qu’on m’a dit au tribunal.
Décidément je ne me rends pas compte, je pensais que chez vous, tout était plus évolué, notamment la justice…
Non non non ! Donc ces dix premières années, c’est « l’opéra de la terreur », des commentaires sur mon anatomie, des blagues de cul, des hommes qui essaient de m’embrasser. C’est vraiment lourd ! Les femmes ont toutes beaucoup vécu cela.
Pourquoi continuer malgré tout ça à se battre pour faire encore de la télévision où le plaisir de la qualité est aussi bien mince ?
Mais ce comportement masculin que j’ai subi à mon travail, je l’ai aussi subi toute ma vie ! Dans les bars… et peu importe le métier que je fais. Dès que je souris à un gars ou que j’ai une belle conversation, la personne pense que je veux baiser. Toute ma vie j’ai vécu ça. Le travail était comme l’extension du reste de ma vie. C’est triste. La nuit, je ne sors pas. Je ne marche pas dans Montréal dès qu’il fait noir. J’ai toujours été en danger. Je me suis souvent fait suivre, j’ai souvent été agressée. C’est très lourd.
 Installation du "pénis mort" lors du tournage de Bungalow -Photo issue de la collection particulière de l'Auteure
Installation du "pénis mort" lors du tournage de Bungalow -Photo issue de la collection particulière de l'Auteure
En effet, j’ai presque l’impression d’être dans le revenge movie de la cinéaste et comédienne blackfoot Elle Maija Tailfeathers (A red girl’s reasoning, 2012) où une autochtone lacère au couteau des blancs, c’est sur le viol des femmes autochtones par les policiers blancs mais sur un ton à la Tarantino avec un montage en split screen, le tout dégageant une ambiance en permanence anxiogène.
Waouh ! … Mais tout ça fait partie de notre réalité. C’est triste. Moi j’ai arrêté de me faire agresser le jour où j’ai arrêté de boire et que je suis restée chez moi. C’est pas compliqué, ma vie a changé quand j’ai arrêté de sortir, aussi simple que ça. Je suis donc beaucoup en réaction contre tout ça dans mon cinéma, dans ce que je fais et dans ma colère en général.
Aujourd’hui, tu peux sortir et rencontrer des hommes avec qui ça se passe mieux ?
Oui mais je ne vais plus vraiment dans les grosses fêtes. Je vais plutôt voir les gens dans leur salon, fumer un pétard chez un ami, tranquille ou dans les festivals. Sinon je ne sors plus, je regarde des films, la télévision, je vais au théâtre. Je ne marche pas en soirée si je ne suis pas accompagnée. J’ai trop peur car j’ai eu trop de mauvaises expériences dans ma vie.
Tu n’as jamais fait d’atelier d’autodéfenses ou des choses comme ça ?
Non j’ai arrêté de consommer de l’alcool car j’étais plus en danger. Je n’avais plus peur de rien passé quatre bières et c’est là que je me mettais en danger. Je n’étais pas si différente de mon état normal mais ça suffisait à me faire baisser ma garde et c’est là que je me faisais attaquer, que je me faisais violer. On m’a mis du GHB dans ma bière dans le bar Les foufounes électriques à Montréal. Des amies m’ont trouvé dans la salle de bains et m’ont portée jusqu’à la maison. Quand je me suis réveillée le lendemain et que je me suis déshabillée, j’avais le corps couvert de morsures, de morsures noires. J’en ai encore des marques sur les seins alors que je n’avais que 22 ans à l’époque où ça s’est passé. Un ami garçon s’est aussi fait droguer et lui s’est réveillé dans les poubelles derrière ce même bar, dans le container des Foufounes électriques ! À l’époque, on avait appelé la police et deux jours après et la police nous avait dit « N’y allez plus, on ne peut rien faire ». Ils n’ont même pas voulu prendre notre déposition. Donc des histoires dégueulasses d’agressions, j’en ai trop vécu et j’ai plein d’amies filles qui sont dans la même situation. Ce n’est pas pour rien que je n’ai pas de relation de couple, aucune relation qui ne dure... Je pense que je suis un peu une personne brisée. Mais ça va, je fais du cinéma avec ça, j’en parle ouvertement, je donne des conférences, j’aide des gars en prison, je m’investis dans la schizophrénie, je me trouve d’autres chemins… Mais je regarde encore du cinéma d’exploitation. (éclate de rire)
 Bungalow (2023) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Bungalow (2023) de Lawrence Côté-Collins - Capture d'écran
Incroyable...
Parce qu’il faut en rire. Il n’y a pas de tabou autour de tout ça, j’aime mieux en rire, être capable de le raconter.
Je ne suis pas sûr qu’on puisse guérir de ses pulsions. Peut-être qu’il faut les accepter pour essayer de les contrôler au lieu d’être dans le déni et d’enfouir des choses sous le tapis. Je n’ai pas l’impression qu’avec cette méthode la société va avancer, sans prendre en compte aussi la parole des agresseurs et en privilégiant uniquement un système punitif qui renforce les tabous, en tout cas en France.
Moi je suis en relation amicale avec des agresseurs sexuels. J’ai fait de la justice réparatrice. Parler avec eux de mes agressions pour qu’eux me parlent de leurs blessures, de pourquoi ils ont commis ces agressions. Tout ce travail que je fais en prison, je le fais pour me guérir moi même. Mais le gars que j’accompagne depuis six ans a quand même tué deux personnes ! Et comme je le disais, tu peux aimer la femme, être misogyne et l’agresser, tout ça est tellement proche. Je pense que l’acte de guérison, de rédemption et de pardon se fait en équipe et qu’il faut parler de ces choses là. C’est la vie !
Merci à Lawrence pour sa disponibilité fort tardive et à l'ensemble de l'équipe du festival Vues du Québec de Florac !