Crédits images
Arcpixel (Freddy Arciniegas)
Vous êtes une citoyenne du monde : des origines multiples et de nombreux pays d’accueil : Belgique, Uruguay, Québec… Quant à vos histoires, elles se déroulent soit dans des pays étrangers, soit racontent la vie de personnages étrangers.
Citoyenne du monde, c’est beaucoup dire parce que le monde est vaste, mais je ne suis certainement pas quelqu’un qui est resté à la même place. j’ai vu différentes cultures, j’ai habité dans des pays avec différentes langues. Alors oui ça fait partie de qui je suis et inévitablement des films que je fais.
Pour autant vous vous sentez 100 % québécoise…
Je ne me sens 100 % rien… Il y a d’autres éléments. Je suis très québécoise, surtout culturellement, parce que ça fait quand même vingt huit ans que je suis là-bas. Je suis arrivée à 18 ans donc ça m’a vraiment formé comme adulte. C’est là que j’ai étudié et que j’ai développé toutes mes compétences professionnelles et comme on le sait, elles ne se transfèrent pas facilement d’un pays à l’autre. Même si une partie de moi vient d’Uruguay et que j’y ai des attaches affectives fortes, je ne pense pas que je pourrais débarquer là-bas et commencer à travailler, y mener une vie plus ou moins fonctionnelle parce que ça change beaucoup d’un pays à l’autre. J’ai aussi vécu sept années en Belgique qui ont été aussi importantes dans ma vie, d’abord parce que j’y ai appris le français, c’est ma première scolarité. J’ai gardé des amis là-bas. D’ailleurs, j’essaie de retrouver une amie belge à Paris parce que je n’ai pas le temps d’y passer durant ce voyage-ci mais souvent quand je passe en Europe, j’essaie de m’arrêter quelques jours là-bas. Je trouve que c’est un pays à la culture attachante.
 Katherine Jerkovic au micro lors du festival Vues du Québec de Florac en avril 2023, en compagnie de Lawrence Côté-Collins - photo Dominique Caron
Katherine Jerkovic au micro lors du festival Vues du Québec de Florac en avril 2023, en compagnie de Lawrence Côté-Collins - photo Dominique Caron
J’imagine que vous pensez plutôt à la Wallonie…
Oui, la Belgique francophone, j’allais le dire. Le cinéma belge m’intéresse aussi.
Dès vos vidéos et installations multi écrans (elle rit, surprise), on sent que le cinéma peut-être en soit un pays, l’exil un état. On passe de la Côte Nord à la frontière urugayo-argentine presque dans une même tonalité, sous le même regard…
Il est juste de dire que j’ai adopté le cinéma comme patrie. C’est le premier lieu où j’ai réussi à comprendre, à construire quelque chose de stable. C’est aussi le filtre avec lequel j’appréhende les choses autour de moi, où qu’elles soient. Pour ce qui est de l’état d’exil, je pense m’en être affranchie un peu.
Il faut préciser que ces vidéos datent un peu…
Oui c’est ça. Je pense que ça peut être un état permanent pour pas mal d’émigrants. C’est un risque je crois. C’est sûr que ça peut être une source infinie d’inspiration et de ressassement mélancolique. Mais j’ai connu ça assez longtemps pour pouvoir être contente et me dire que je suis passée à autre chose. Je pense que le film Les routes en février est celui où j’ai fait cette traversée là. Je dis souvent que j’avais le deuil du lieu d’origine à enterrer, celui du retour à la patrie, de ces fantaisies là qui ont quand même une importance. Si ce deuil là était un fleuve, Les routes en février était comme un bateau que j’ai fabriqué pour pouvoir le traverser. Je pense que quand je l’ai terminé, je suis un peu sortie de cet état là, avec ce que ça impliquait de pertes mais aussi de nouvelles possibilités. Et j’ai eu un peu peur… On pense parfois qu’on n’aura plus jamais d’inspiration après, que quelque chose va se tarir. Mais non. Le coyote a un ton un peu mélancolique parce que c’est mon style, beaucoup d’affinités en termes de poétique, de rythme et de langage cinématographique. Mais je pense que ce n’est pas un film d’exil, c’est juste un film humain, social. Et là le projet sur lequel je travaille est encore plus éloigné de tout ça, il n’est pas non plus en lien avec l’immigration.
Il s’enracine qu Québec ?
Oui. Le coyote a aussi été tourné à Montréal. Le prochain traite d’autres thèmes qui m’intéressent beaucoup. Quand j’en parle, je dis qu’il parle de spiritualité, mais là ça sonne un peu lourd, New age, même si c’est sous un angle ludique et différent. Mais oui il s’enracine au Québec parce que je vais aller tourner en région. Parce que s’il y a quelques moments à l’extérieur de la ville, Le coyote était beaucoup un film urbain, ce qui m’intéresse moins car comme on peut le voir dans mes vidéos, j’aime les grands espaces. Je vais donc aller dans les terres agricoles et les régions de grandes industries comme ça. Donc je pense que ça a été le cas pendant longtemps, l’exil, toute une réflexion sur la patrie, le voyage, le déracinement. Mais c’était très douloureux et ça m’empêchait de m’ancrer et de construire quelque chose de plus permanent. Ce que vous avez décrit de ma vie, c’est surtout la conséquence du cheminement de mes parents et ça a été quand même assez instable, parce que même en Uruguay, on déménageait quand même tous les ans ou tous les deux ans. Je changeais d’école… Là, je simplifie mais la vraie histoire est quand même assez instable.
 Platinium farewell de Katherine Jerkjovic (2004) -Capture d'écran
Platinium farewell de Katherine Jerkjovic (2004) -Capture d'écran
Du fait de bouger autant, aviez-vous déjà développé le goût pour la peinture ou la photographie ? Vos premiers films portent la trace d’une certaine picturalité.
Peut-être, oui. Les vidéos d’art, tout ça. Je me promenais avec une petite caméra vidéo. Rien de très cher, pas le dernier cri quoi. Et je prenais des images. Par contre, je me suis intéressée à la photo assez tard. Après, j’étudiais le cinéma dans une école universitaire à Montréal qui approche vraiment le cinéma comme un art. Bon, on apprend aussi comment écrire des scénarios et tout ça mais j’ai vraiment eu des moments d’épiphanie incroyables pendant mes cours parce que je n’avais jamais vu de cinéma expérimental, ni de vidéos d’art, tous ces cinémas radicaux qui m’ont vraiment influencée. Avant de commencer à raconter des histoires, pendant plusieurs années j’étais juste intéressée à explorer le langage cinématographique, l’image, tout ce qu’on peut dire sans raconter une histoire. Et même si maintenant je fais de la fiction, j’écris le déroulement du film et non l’action, les dialogues. Enfin il y a ça, mais je ne sépare pas l’histoire de la mise en scène et de comment ça va s’exprimer. Si j’écris une scène et que je ne peux pas visualiser une façon intéressante de la tourner, je vais la réécrire autrement. Des fois, quand je vois des scénarios de scénaristes, on n’arrive pas à visualiser, il n’y a souvent aucun langage. Moi je suis arrivée à la fiction autrement, donc j’imagine qu’il y a toujours quelque chose de pictural ou de visuel.
Chez vous le mouvement n’est jamais innocent, c’est déjà une invitation au voyage. Ce qui frappe dans les vidéos comme dans Les routes en février, c’est cette impression de road movie avec de longs travellings en bateau. Un des garçons dit « Tout le monde veut être ailleurs ». Pour autant et à l’instar de Ford, vous ne bougez la caméra que pour des raisons bien précises…
Je ne fais pas de travellings, pas de panoramiques, bref je ne bouge pas tant que ça la caméra mais par contre je filme le mouvement. C’est le déplacement. Je pense que j’ai quand même une grammaire cinématographique assez simple et assez calme. J’aime beaucoup la caméra à l’épaule pour accompagner les corps parce que je trouve que c’est une façon d’être proche du personnage principal., Sinon, j’aime bien les plans fixes…
Qui donnent du temps…
Oui qui donnent du temps et aussi qui permettent d’établir une relation entre le personnage et son environnement. Ou la relation entre plusieurs personnages dans un même cadre. Je trouve qu’on peut dire beaucoup de choses avec des choix comme ça, plutôt que de faire dire des choses au comédien. Mais sinon c’est ça, je me suis beaucoup déplacée. Donc je tournais dans des bus, sur des bateaux. Mes premières vidéos d’art où j’ai tourné le classique décollage ou atterrissage, je ne sais plus... (rire)
Vous avez quasiment refait le parcours de l’histoire du cinéma depuis les opérateurs Lumière ! À placer la caméra sur quelque chose ou à organiser le mouvement dans le plan…
Oui , je ne sais pas… C’est vrai que ça a quelque chose de pictural, comment on place un cadre et qu’on laisse les choses exister à l’intérieur. En tout cas, c’est moins intrusif vis à vis du spectateur que de toujours chercher à orienter son regard. Je pense que toute ma démarche cinématographique est un peu aux antipodes d’un cinéma que je considère intrusif et qui prédomine. Même au niveau des émotions, on nous force à ressentir des choses, on nous impose tout le temps « Pleure ! Rie ! Sois émue ! » avec des moyens qui ne nous laissent pas nous même habiter le film. On ne nous laisse pas le ressentir et le juger. Le spectateur doit avoir le droit de juger le film. Je ne cherche pas à le séduire. Je pense que j’essaie d’avoir une éthique et une cohérence à tous les niveaux du film : l’histoire qui est racontée et comment elle est racontée, les moyens cinématographiques employés… Que tout ça soit cohérent, qu’il y aie une cohésion. Je dis souvent que les choix esthétiques sont à la base des choix éthiques : comment on considère le spectateur, comment on considère nos personnages. Tout ça se rejoint un peu.
 Les routes en février de Katherine Jerkovic (2017 1976 productions), capture d'écran
Les routes en février de Katherine Jerkovic (2017 1976 productions), capture d'écran
Dans Le gardien d’hiver, vous livriez une tranche de vie, une atmosphère, nous installiez dans les pas d’un homme délaissé, dans l’attente impossible d’un retour. Votre dramaturgie était déjà basée sur le non-dit…
Le gardien est un immigrant qui attend une locale, une québécoise qui est partie en voyage. Il attend et il y a comme un effet miroir. C’est un film sur l’attente, celle qui ne se résout pas. Je ne pense pas avoir de talent pour le court-métrage de fiction, donc ces courts me servaient plus à développer un langage. Mais je n’ai pas l’impression qu’ils soient très réussis.
Ce sont presque des études…
C’est ça.
En même temps, on peut déjà comprendre ce qui vous intéresse et mesurer la progression de certaines choses. Après, vous allez beaucoup calmer la caméra, continuer de suivre les personnages mais différemment. La direction d’acteurs n’est pas la même aussi.
Oui, très naturelle, intérieure. Oui, on reconnaît, ça me permettait de montrer que j’en étais capable.
En effet, on sait qu’au Québec aussi, pour obtenir des financements, il faut montrer des choses
C’est ça, mais je pense vraiment que le court de fiction est un format qui ne me convient pas. Je ne crois pas pouvoir apporter grand chose à ce format là.
Tous vos personnages ont une origine hispanophone. C’est pour vous plus important que votre passé et vos origines européennes, même si votre approche du cinéma d’auteur s’en ressent et qu’on peut faire des parallèles avec certaines cinématographies d’Amérique centrale par exemple tout en conservant aussi quelque chose du cinéma d’auteur européen.
Je ne dirais pas que le cinéma latino-américain m’aie marqué.
Même le cinéma mexicain ?
J’ai beaucoup aimé Reygadas quand je l’ai découvert mais en général, je ne suis pas une grande consommatrice de cinéma latino-américain. Si je le regarde, c’est plus pour d’autres raisons, affectives ou culturelles. Mais sinon, il y a plein de sortes de cinéma qui m’ont intéressée comme le cinéma indépendant d’Europe de l’est ou des démarches comme Ken Loach…
Mungiu peut-être ?
Mungiu, Ken Loach, les premiers films des frères Dardenne, les débuts de Lynne Ramsay parce qu’il y a le côté drame social dans Ratcatcher mais qui ne cherche pas à imiter le documentaire. Il y a quand même une recherche visuelle et poétique qui m’a beaucoup plu. On m’a aussi souvent dit que ce que je fais ressemble aussi au cinéma japonais ; donc il y a beaucoup de choses là dedans. Je ne suis pas dans une démarche cinématographique très conceptuelle. Pour la grammaire, un peu, mais pas tant que ça. Rien de factice ou qui nécessite de tout contrôler. J’essaie de capter la vie, des petits moments de vérité.
Pourtant dans Le coyote, le cadre est vraiment très précis, très posé, d’où le parallèle avec le cinéma mexicain contemporain et même si ces cinéastes ont tendance à être plus crus, le cadre plus coupant, dur.
C’est culturel.
Oui, c’est lié aussi à une situation politique et sociale de pire en pire.
Les couleurs sont plus fortes, c’est plus appuyé.
 Jorge Martinez Colorado dans Le coyote, de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
Jorge Martinez Colorado dans Le coyote, de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
Oui, je pense à Amat Escalante. Je me suis donc demandé si c’était une référence ou si ça allait avec le bagage culturel du personnage et que vous cherchiez par la suite à adoucir tout ça, en travaillant à l’intérieur par petites touches.
Exact, c’est très juste. C’est comme ça que je travaille. Mais non, je ne dialoguais pas avec le cinéma mexicain à ce moment là. Après, il est très varié.
Haneke aussi, qui lui même a fait beaucoup de choses très différentes.
Je pense que déjà dans Les routes en février, le cadre est assez précis. C’était une approche esthétique un peu différente. Je travaillais aussi avec un chef opérateur différent, parce que l’histoire était différente, le lieu…
La lumière du film m’a beaucoup marqué.
Pour la lumière, ça faisait déjà partie du scénario. Tout ce qu’on voit était déjà dedans. Dans Le coyote aussi. La lumière faisait partie de la proposition des Routes en février. Le film se déroule en février, c’est le moment le plus chaud là-bas. Il y a une lourdeur. Je voulais qu’on ressente tout ça donc la lumière est forte, très contrastée. On en sent presque la chaleur. J’ai travaillé avec des directeurs photos très doués, sur les deux films. Sur Les routes en février, c’est Nicolas Canniccioni, c’est quelqu’un de ma génération.
Est-il uruguayen ?
Pas du tout ! Il est corse, mais ça fait très longtemps qu’il est au Québec.
Ah c’est parce que beaucoup d’uruguayens ont des noms avec des consonances italiennes...
Oui. Lui est totalement québécois et très connu dans le cinéma d’auteur, d’autant qu’il a une griffe visuelle forte ( En effet ! DOP pour Simon Lavoie et Mathieu Denis, Philippe Lesage, Myriam Verreault, Caroline Monnet…). Pour Le coyote, j’ai travaillé avec une jeune femme, Léna Mill-Reuillard (Geneviève Dulude de Celles, Mes nuits feront écho, Noémie dit oui, Pre-Drink…), qui est plus jeune que moi, à peine trente ans. Au Québec, il y a toute une génération de cheffes opératrices trentenaires vraiment intéressantes et qui ont pu accéder au métier en partie grâce aux technologies numériques, le digital, des caméras plus petites et plus légères.
Y a-t-il une parité obligatoire pour les chefs opérateurs ?
Non, il n’y en a pas. Mais quand on a de la parité pour les rôles titre, ensuite ça s’équilibre. Même chose pour la diversité puisqu’il y a ici une table ronde sur le sujet. Dès qu’à la production ou à la réalisation il y a une personne issue de l’immigration ou d’une communauté moins présente, toute l’équipe se diversifie naturellement. Moi je regarde toujours beaucoup les génériques et on constate un problème du cinéma québécois « pure laine » et même si j’apprécie beaucoup ces cinéastes, il n’y a que des noms de canadiens français dans leur équipe. Et ça c’est un problème parce que ça fait deux ou trois générations d’immigrants qu’on forme dans les écoles de cinéma. Léna Mill-Reuillard est québécoise et c’est un profil complètement différent de Canniccioni et ça allait bien aussi pour ce que je cherchais. Déjà le fait que ce soit une jeune femme, avec un enfant sur le plateau, ça adoucissait les rapports. C’est aussi quelqu’un de très discret dans sa façon de travailler, introvertie. C’est intéressant aussi sur un plateau avec un enfant, des gens de différentes cultures, d’avoir quelqu’un comme ça qui ne prend pas de place… C’était bien ! C’est aussi une artiste photographe, qui fait de l’installation photographique. Elle a donc une griffe différente, une beauté un peu plus éphémère, moins appuyée mais quand même présente, et ça, ça fonctionne très bien pour Le coyote.
 Jorge Martinez Colorado et Eva Avila dans Le coyote, de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
Jorge Martinez Colorado et Eva Avila dans Le coyote, de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
En plus d’utiliser la lumière naturelle, vous l’atténuez ?
Non, il y a toujours un travail sur la lumière mais une des qualités de Léna est de la travailler de sorte qu’elle ait toujours l’air d’être naturelle. C’est travaillé.
C’est très diffus…
Il y a beaucoup de diffusion. On trouvait que l’histoire du Coyote était déjà assez dure pour avoir en plus une approche cinématographique qui renforce cela. On s’est dit qu’on allait y amener des lumières bienveillantes, douces, diffuses justement.
En même temps, sans que jamais ça apparaisse tout à fait puisque vous êtes dans des tons plus sombres...
Oui mais je trouve qu’il y a néanmoins cette bienveillance de l’éclairage qui est toujours là et ça c’était particulièrement important, parce que je ne voulais pas que Camilo soit une victime ou qu’on perçoive son cheminement comme entièrement négatif.
Avant d’en venir à Camilo, revenons encore aux Routes en février, est-ce que le personnage de Sarah a quelque chose d’autobiographique ?
Ah, on m’a posé cette question plein de fois. Un peu, oui. C’est sûr que c’est une fiction et qu’il y a donc un travail d’écriture. Mais à la base, oui, c’est vraiment inspiré de ces jours que je passais chez ma grand-mère en Argentine, ma grand-mère croate. Au début, on voulait tourner en Argentine parce que j’ai aussi de la famille paternelle en Argentine, mais c’était plus cher, plus compliqué donc on a opté pour l’Uruguay et finalement c’était très bien parce qu’ il y a quelque chose de plus petit, de plus chaleureux, à l’échelle humaine. Et puis j’avais une super équipe. Donc oui je m’inspirais de ça. Au début c’était un film sur le thème « être quelque part », sur l’expérience sensorielle et après j’ai développé l’histoire vers quelqu’un qui va chercher quelque chose mais on ne sait pas très bien quoi. Elle finit par trouver quelque chose qui lui permette de continuer à avancer. C’est très mince, pas au sens péjoratif, mais très simple.
Ça se rapproche plus du cinéma asiatique. Hou Hsiao Hsien...
Exact, le sensoriel et tout ça. Je l’aime beaucoup. Kore-Eda aussi.
On ressent beaucoup ce détachement dans votre cinéma. Il est très important. La part laissée à l’ennui aussi.
Oui, ça c’est dans Les routes, il y a beaucoup de moments d’ennui. Le temps qui passe…
Le son m’a aussi beaucoup marqué par rapport à la tension qu’il crée. Le son est-il aussi écrit au scénario ?
Oui, il y a pas mal d’indications de son.
Le sound designer fait-il beaucoup de recherches ?
Je travaille avec le même sound designer et le même preneur de son (Bruno Pucella et Pablo Villegas) dans mes deux films. En général, ce qu’on fait c’est qu’avant de partir en tournage, on fait une rencontre tous les trois et on discute de ce qu’il y a dans le scénario. En général, mon concepteur sonore demande un certain son. Il y a toujours beaucoup de son qui se fait en post production, mais c’est vraiment intéressant d’avoir du son direct, d’avoir toutes ces textures, tout ce qu’on peut aller chercher durant le tournage. Le son est super important. Il y a une telle richesse dans le cinéma. Je trouve qu’elle n’est pas tellement exploitée, les gens regardent juste si l’image est belle, si elle attire l’attention...
 Les routes en février de Katherine Jerkovic (2017, 1976 productions), capture d'écran
Les routes en février de Katherine Jerkovic (2017, 1976 productions), capture d'écran
Alors qu’on sait que le son est beaucoup plus conducteur…
Il peut tout évoquer, être diégétique, hors champ, plein de choses. La grammaire aussi avec les ellipses. C’est un outil très intéressant et je réfléchis aux ellipses dès le scénario.
Et comment ça va travailler le spectateur…
Exact. Coupe-t-on dans cette scène ou laisse-t-on le plan séquence… ?
Une approche un peu bressonienne aussi…
J’adore Bresson ! (rire)
La question du montage est incontournable chez lui.
Je travaille aussi avec la même monteuse sur mes deux films, Sophie Farkas Bolla, qui est à mon sens très (elle insiste) douée et même s’il est déjà en partie écrit dans le scénario, elle va toujours apporter une idée, une solution créative, une inversion de l’ordre des scènes qui va mieux conduire à ce qui était déjà là. Donc j’ai une méthode de travail qui est à la fois très rigoureuse et aussi souple. Je travaille avec des acteurs qui sont très naturels, spontanés. Pas des comédiens qui cherchent à reproduire la même chose prise après prise, qui s’accrochent beaucoup à la technique. J’aime bien être avec des comédiens qui sont un peu imprévisibles, intuitifs, qui vont me surprendre, me donner des choses, des petits moments de vérité. Il y a quand même un travail d’écriture très rigoureux et long. J’ai écrit pendant plusieurs années chaque scénario, ce qui fait que ça semble justement très cadré, mais à l’intérieur du cadre la vie doit être là, l’imprévisible…
À ce niveau là, vous fonctionneriez plutôt par soustraction ? Avec une idée du début, de la fin…
Ça dépend, mon écriture est vraiment intuitive.
Il n’y a pas trop d’habitudes…
Ben j’ai des idées ou une idée. En général, ça commence avec des images, des personnages, une sensation, une situation. Ce ne sont pas des histoires mais ça dépend de chaque projet. Mais je travaille beaucoup le scénario. Il y a beaucoup de réécritures, d’épuration, de remises en question. Il n’y a pas deux scènes qui disent la même chose ou si ça arrive, j’en enlève une. Je le travaille ainsi jusqu'à ce que j’ai la version la plus aboutie, celle qui va vraiment à l’essentiel. Après, une fois que j’ai ça, j’ai une grande confiance en ce texte. Je sais qu’il va m’amener où je veux et à partir de là, je lâche beaucoup prise. Je tiens compte de l’avis de mes collaborateurs, je m’adapte aux lieux de tournage. Même si j’ai une location en tête, si je trouve quelque chose de différent et avec un potentiel intéressant, ça sera « Ok, on va travailler ici ! ». Comme je le disais, je travaille avec des comédiens qui ne sont pas du genre à qui l’on peut dire « Je veux que tu fasses ça, ça, tu respires ici, tu touches là, tu le déposes à ce moment là... »
À la Dolan…
Exact ! L’opposé quoi… Donc c’est comme un mélange de quelque chose de rigide, cadré, rigoureux et en même temps d’impureté, de chaos.
C’est que l’impressionnisme, ça se construit petit à petit. Renoir disait lui aussi qu’il fallait en effet toujours laisser la porte ouverte à l’imprévu.
Absolument.
 Le coyote de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
Le coyote de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
De quoi traitait Archipel votre court suivant ?
C’était un essai, une fiction essai. C’était après Les routes en février, j’avais envie de revenir à quelque chose de vraiment plus petit, d’explorer des choses. C’est un exercice où il y a trois ou quatre personnages qui se croisent, même si ce n’est pas un film choral. C’est comme une histoire qui s’écrit à travers plusieurs personnages. J’explorais l’idée que l’unité du film, c’est ce qui s’écrit et non pas le personnage qui le porte. En fait, ça a aussi été l’occasion de tourner avec Léna Mill-Reuillard. Je voulais voir comment marchait la collaboration avec elle. On a tourné en super 16mm parce que je voulais aussi tourner Le coyote comme ça. Sinon, je pense qu’on retrouve les mêmes thèmes que dans mes autres films, mais exprimés différemment.
Je n’avais pas remarqué ça.
Dans Le coyote ? Vous n’avez pas senti la texture de l’image ?
Je n’ai pas fait le lien avec les autres films tournés en super 16 qui étaient vraiment très différents. Mais j’ai bien vu qu’il y avait de la tessiture, mais sans pour autant deviner que ça venait de là.
C’est un choix qui apporte beaucoup de choses, un côté très amateur, indépendant. C’est aussi un choix de fragilité. Le super 16, c’est un grain qui danse et une profondeur de champ très mince. La mise au point n’est pas simple, elle est parfois imprécise, donc il y a quelque chose d’insaisissable, d’impur ou d’imparfait que j’aimais bien aussi. Dans les cinéastes que j’aime beaucoup et dont on n’a pas parlé , il y a Cassavetes qui au début a tourné en 16 puis ensuite en 35. Donc je trouvais que de tourner en Super 16 me rapprochait de ce cinéma indépendant là. C’est donc du vrai grain, pas du grain ajouté en post production ! (rires)
Pourquoi le choix d’un héros mexicain dans Le coyote ?
Parce que j’ai beaucoup voyagé au Mexique ces dernières années car ma mère s’est installée au Mexique il y a six ans. J’ai donc découvert cette culture et ça m’a beaucoup intéressé.
Y a-t-il beaucoup d’immigrés mexicains au Québec ?
Il y en a beaucoup et au cinéma ou à la télévision, ils sont presque toujours représentés comme des travailleurs saisonniers qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas ce qu’il se passe… Soumis, peu instruits. Mus par des préoccupations de base comme celle de nourrir leur famille…
Un peu comme les français représentent les portugais quarante ans plus tard.
Oui, c’est presque préhistorique comme perception des préoccupations humaines. Mais derrière, il y a la culture, la philosophie et toutes sortes de choses.
D’autant que la culture mexicaine est particulièrement riche…
C’est hyper fort, élaboré. Donc voilà, c’est à cause de ces clichés un peu chiants que l’on croise tout le temps sur les mexicains. Ça m’intéressait aussi parce que je voulais que le film se déroule à l’automne car j’aime la sensation, le feeling un peu mélancolique de l’automne, les couleurs chaudes des feuilles et la froideur de la lumière, tout ça ensemble. Au Canada, le 31 octobre, on fête Halloween qui est inspirée de la fête mexicaine des morts. Alors je voulais le mettre en perspective dans le sens où lui c’est l’immigrant, celui qui vient d’ailleurs et en même temps là où il est, on lui a piqué une fête de sa culture.
Vous n’êtes pas quelqu’un qui ajoute beaucoup de musique extra diégétique. Est-ce pour mieux coller à l’état intérieur de Camilo ?
Oui. Mais en fait, la musique c’est comme les coupes, il faut qu’il y aie une vraie bonne raison.
 Eva Avila dans Le coyote de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
Eva Avila dans Le coyote de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
Vous seriez presque comme les cinéastes du Dogme 95.
Ben je n’ai pas de dogme. Chaque film et chaque histoire a ses commandes. Déjà dans Le coyote, il y a plus de musique que dans Les routes en février. Elle est surtout intradiégétique, la musique que le travailleur met quand il nettoie et quand Camilo conduit la voiture. Il y a un moment pour lequel j’ai fait composer une musique un peu introspective pour accompagner un moment important, mais je pense que ce n’est pas une musique. En tout cas, ce que je veux éviter, c’est la musique qui appuie les émotions ou qui essaie d’amener une émotion qui aurait du être dans l’image mais qui n’est pas réussie à l’écran. J’aime vraiment cette idée d’être honnête avec le spectateur donc si la scène n’est pas aussi réussie que je le voudrais, alors tant pis « C’est ça la scène ! ». Mais ce que je ne transmets pas, elle ne va pas le transmettre mieux parce que je vais mettre une grosse musique larmoyante.
Au-delà du fait que la thématique est la résilience et que tout votre dispositif tend vers ça, la toxicomanie comme la gastronomie sont quasiment maintenus hors champ alors qu’ils sont des éléments importants de la vie des personnages.
Alors la toxicomanie plus que la cuisine…
Pourquoi cette nécessité ? Pour ne pas distraire le spectateur ?
Bonne question. La cuisine, on la voit quand même. On le voit préparer des mets au moins deux fois.
Oui mais vous ne vous attardez pas sur l’esthétique…
Ben, ça ressemble à une émission de cuisine. J’ai quand même fait des efforts pour qu’on voie les couleurs mais bon, ce n’est pas une émission culinaire. Il fallait trouver le bon équilibre. Mon comédien n’est pas non plus un cuisinier professionnel, donc si je mets l’accent là-dessus, ça va se voir, même s’il s’est un peu formé.
C’est aussi parce que vous vous focalisez plus sur le travail que sur la gastronomie en soi.
Absolument. Je parlais de Dardenne tantôt. Ce que j’aime beaucoup chez eux, c’est qu’on voit les gens au travail. On voit la précision, la répétition, la singularité des gestes de chaque travail. Ça j’aime beaucoup, ce qui fait que je suis un peu restée là-dessus, mais aussi le fait qu’un vrai cuisinier puisse voir que ça ne marche pas.
Donc presque par nécessité documentaire…
Genre ! Et puis pour la toxicomanie… Ce n’est pas un salaud mais ce sont ses affaires à elle. C’est sa vie privée. Ce n’est pas un film là-dessus mais c’est un élément du film donc je montre le minimum indispensable pour que le récit tienne et qu’on comprenne le personnage. Là aussi, je voulais éviter les clichés sur la représentation des toxicomanes. Je pense que c’est intéressant parce que c’est un risque que je prenais. Déjà dans le scénario, on me disait, « elle n’a pas l’air toxicomane ». j’ai côtoyé des gens qui prenaient des drogues dures, je sais qu’il y a des façons de consommer, que des gens consomment sans que ça paraisse super évident. Des fois, on ne le sait pas. Ils arrivent à ne plus en prendre mais après ils rechutent, ils en reprennent. Ils ont des cycles. J’avais envie de montrer ça mais c’était un risque parce que je savais que des gens allaient me dire « Ce n’est pas crédible ». Ce qui est très intéressant c’est que c’est plutôt le contraire ! Plein de gens réagissent et disent « Moi je consommais mais j’étais fonctionnel ». À Toronto, au TIFF, il y avait un jeune homme d’origine latine et sans doute venu voir le film à cause de cet élément là et il était vraiment content de voir le personnage de Tania, parce que sa mère avait été toxicomane et il me remerciait pour le portrait. Donc j’ai beaucoup reçu des gens le contraire de ce que je pensais ! Qui me disent que c’est bien, que ça peut être ça aussi mais qu’on ne le voit pas. Après ce que je trouvais important, c’était de maintenir la dignité de ce personnage, qu’on voit que oui c’est difficile, qu’elle en arrache, qu’elle ne va peut-être jamais arrêter de consommer définitivement mais que c’est sa vie et on n’a pas à juger ça. Il y a quand même d’autres choses, elle n’est pas que ça, il y a d’autres éléments à sa personne. Donc c’était difficile et je suis assez contente de ce qu’on a réussi parce qu’on marchait sur une mince ligne. En même temps, il faut qu’on s’attache à elle et qu’on comprenne que Camilo, lui, n’est pas content de la voir réapparaître, qu’on comprenne qu’elle n’est pas tout à fait fiable même si elle a l’air bien. C’était un personnage qui n’était pas évident à réussir. Mais la comédienne est très bonne et elle a vraiment bien compris ce qu’on voulait.
 Jorge Martinez Colorado et Enzo Desmeules Saint-Hilaire dans Le coyote, de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
Jorge Martinez Colorado et Enzo Desmeules Saint-Hilaire dans Le coyote, de Katherine Jerkovic (2022, 1976 productions) -Capture d'écran
Vous avez travaillé cette fois de la même manière que d’habitude avec les comédiens ou compte tenu que pour la première fois vous travailliez avec un enfant, est-ce qu’il y a eu autre chose que de la spontanéité, des temps de préparation, de répétition ?
On répète toujours. Je ne répète pas toutes les scènes. J’en choisis une poignée qui balisent la courbe du personnage. Donc je laisse toujours plusieurs scènes non répétées, surtout des scènes simples. Mais je ne répète pas de façon exhaustive. Je répète juste pour m’assurer qu’on est sur la même page, qu’on comprend ce qu’on veut. En général, quand le comédien ou la comédienne s’approche de ce que j’ai en tête, j’arrête la répétition parce que sinon après c’est trop figé et je n’aime pas ce que ça donne sur le plateau. Avec un enfant, on travaille différemment parce qu’il n’a pas besoin d‘aller trop en profondeur…
Sinon ça ne va pas paraître naturel ou sonner juste…
Ce n’est pas tellement ça. Gérer des enfants, soit il est naturel, soit il ne l’est pas et j’en ai eu des enfants qui font de la publicité depuis qu’ils sont petits, ils ont un jeu qui n’est pas naturel du tout et qui ne peut pas fonctionner. Ici, il est très spontané. On lui donne quelques éléments pour qu’il comprenne ce qu’il a à faire et voir comment il se sent dans cette scène là, mais on ne fait pas une exploration de la psychologie du personnage, on ne lui donne pas plein d’explications mais le minimum dont il a besoin pour comprendre la situation et la jouer. J’ai travaillé avec une coach d’acteurs enfants, une actrice qui s’est spécialisée dans ce travail et ça c’était vraiment très bien parce qu’elle préparait les scènes avec lui avant. Après il arrivait sur le plateau, il connaissait déjà ses lignes de dialogues, la scène et ce qui s’y passe. Il avait des outils et souvent il allait chercher dans sa propre vie des situations qui lui rappelaient la scène, donc on avait des outils qui pouvaient l’aider. Moi je m’attendais à plus de défis avec l’enfant et en fait, ça a très bien été. Ce n’était pas difficile de travailler avec lui. Il a beaucoup de talent, il est naturel, il est joyeux. On a fait tout notre possible pour qu’il soit bien : un horaire pas trop exigeant, qui ne lui bouffe pas trop de jours d’école, ni tous ses week-ends non plus. On ne l’a jamais fait travailler plus d’une journée par week-end, de ne jamais lui faire faire plus d’une scène forte par jour. On a tout fait pour qu’il soit bien et parce que s’il se démotivait, on était tous dans la merde. Eva, la comédienne qui joue Tania, a travaillé avec quelqu’un que je connaissais justement, qui avait consommé une drogue dure pendant sa jeunesse, qui avait arrêté et cette personne, Peter, a accompagné pendant plusieurs années d’autres personnes dans leur sevrage et s’était comme spécialisé là dedans. Il connaissait très bien tous les signes et sensations du sevrage et ce qu’on peut faire. Lui travaillait sans méthadone ou drogue de remplacement, donc tout ce qu’on peut faire avec ce qu’on trouve à la pharmacie en vente libre, des massages, des tisanes pour soulager les moments de crise. C’est quelqu’un que j’avais rencontré au moment où il aidait une amie à moi à se sevrer. Déjà, je lui avais fait lire le scénario. On a un peu travaillé ensemble pour imaginer la vie de Tania, pour que ce soit réaliste, comment grandit cet enfant, quel genre de personnalité il pourrait avoir. Il a aussi travaillé avec Eva, il l’a vraiment aidée pour lui faire comprendre et que le jeu fonctionne à ce niveau là. Je pense que ça a été une bonne chose puisqu’elle est bien, elle est crédible. Même pour Camilo, Jorge a fait un petit training, je suis allée avec lui. On l’a fait tous les deux avec une personne qui fait du ménage dans des tours de bureau. On est allés nettoyer pour comprendre les gestes, les routines, l’ordre dans lequel on fait les choses. Ils ont tous un petit peu fait leurs devoirs pour être crédibles.
Au niveau de la direction artistique, il m’a semblé que certains élément pouvaient avoir une valeur symbolique dans vos plans. Je pense à ce plan de téléviseur avec des objets de chaque côté.
Oui, dans Les routes. La direction artistique est plus élaborée dans Les routes en février que dans Le coyote.
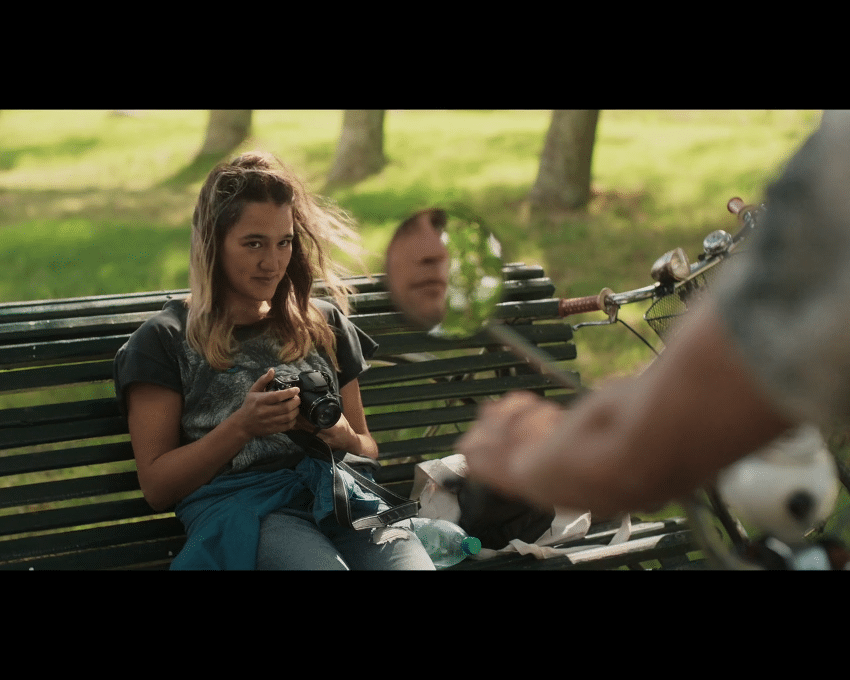 Arlen Aguayo-Stewart dans Les routes en février de Katherine Jerkovic (2017, 1976 productions), capture d'écran
Arlen Aguayo-Stewart dans Les routes en février de Katherine Jerkovic (2017, 1976 productions), capture d'écran
Mais chaque élément nous dit quelque chose…
Oui, toujours. La direction artistique du Coyote fonctionne dans l’austérité, dans le naturel du film, mais elle n’est pas aussi évocatrice ou élaborée et n’est pas autant porteuse de sens qu’elle l’était dans Les routes et c’est un peu dommage.
En même temps, ça sert les situations qu’il vit et tout ça.
Oui ça fonctionne. Par exemple, on voulait que la cuisine soit le lieu le plus chaleureux, le plus coloré, le mieux équipé, le plus agréable. Je pense que les lieux et les objets fonctionnent très bien. Il y a toujours moyen de faire une couche de plus qu’ici on n’a pas pu vraiment faire.
Compte tenu du fait que vous vous apprêtez à tourner en région.
Pas vraiment, je suis encore en écriture…
Enfin, j’avais prévu « Dans quel pays lâcherez-vous les amarres ?.. » ?
« Lâcher les amarres »... ouais. On est toujours un peu amarrés !
« Dans quelle région lâcherez-vous les amarres » puisque ça nous ramène au cinéma québécois…
Enfin, il est surtout urbain.
Je pensais à tous les drames réalistes, aux films d’hiver, ici à Arsenault et fils, au film de Philippe Falardeau, Guibord s’en va-t-en guerre, il y a quand même des films de province !
Oui, en région. C’est génial Guibord, c’est tellement drôle !
Comment comptez-vous aborder cette réalité sociale tout en vous démarquant, votre style étant vraiment aux antipodes et aussi par rapport à ce qui dans le cinéma québécois actuel n’est pas vraiment votre tasse de thé… ?
Je pense que le thème et l’approche ne ressemblent pas aux autres. Déjà, ce n’est pas un drame pur. C’est un drame qui glisse vers le film de genre. Pour le dire rapidement et de façon imprécise, vers le genre magique, mais en fait c’est plus mystique. Mon personnage principal est une grande mystique. On est plus surnaturels que magiques. Par exemple, je ne vais pas utiliser les éléments de la nature de façon folklorique. Ils sont plus là pour évoquer les grands cycles de la vie, les choses qui nous dépassent et leur portée spirituelle.
Vous parliez pourtant de paysages agricoles et industriels plus qu’autochtones…
Non je ne m’en vais pas vers l’autochtone parce que je ne connais pas et je maîtrise pas. J’essaie plutôt de créer le mysticisme original du film et lié aux éléments qui entourent le personnage, aux champs de pommes de terre. Je pense que l’environnement nous détermine beaucoup. Ce n’est pas la même chose de grandir dans une ville où on ne voit pas plus loin que cinquante mètres que dans un lieu où on voit les champs de maïs jaunes, éclatants, qui s’étendent à l’infini.
On peut imaginer qu’un cinéaste comme Bruno Dumont vous parle aussi.
Oui, j’aime bien mais je n’ai pas tout vu. C’est un peu rude. Il y a une forme de cruauté. Je n’aime pas la cruauté. Ce n’est pas ce que j’ai envie d’apporter au cinéma.
 Katherine Jerkovic lors de la cérémonie d'ouverture du festival Vues du Québec de Florac en avril 2023- Photo Christian Ayesten
Katherine Jerkovic lors de la cérémonie d'ouverture du festival Vues du Québec de Florac en avril 2023- Photo Christian Ayesten
Hadewijch ?
Non, je ne l’ai pas vu. j’ai vu L’humanité, celui sur la guerre … (Flandres) Ça ne va pas ressembler à ça mais il y a tellement de films que j’imagine qu’il n’est pas possible de ne ressembler à aucun…
Vous allez sans doute boucler la boucle, retrouver des choses déjà présentes dans vos vidéos, ce regard que vous allez porter sur la campagne…
Absolument, ça m’a vraiment rappelé l’Uruguay. On n’a pas de maïs mais on a des grandes rizières, beaucoup d’industries fermières, bovines… Il y a beaucoup de fermes laitières dans cette région là. Mais bon, il n’est qu’à moitié écrit !
Ça peut encore bifurquer…
Peut-être pas de lieux, mais la façon, exacte dont je vais les utiliser n’est pas encore arrêtée. Mais j’ai fait un repérage et j’ai trouvé des trucs très beaux. Il y a beaucoup de cours d’eau au Québec et ils ont été déterminants pour l’urbanisation, le transport, l’agriculture, tout ça. J’essaie quand même d’aller chercher des choses qui font partie du Québec profond, des éléments fondateurs du Québec. Après, fondamentalement, ce n’est pas un film sur le Québec, ni sur le mysticisme. C’est un peu plus flyé que les précédents. En même temps, enraciné et déraciné ! Ça vole par dessus le réel.
Il va donc attendre quelques années pour le voir…
Oui. Si on est chanceux, on peut peut-être tourner en 2025 ou peut-être 2024, il faut d’abord finir de l’écrire ! Il sera prêt en 2025-2026. mais ne vous inquiétez pas, plein de films vont sortir entre temps ! (rires)
as